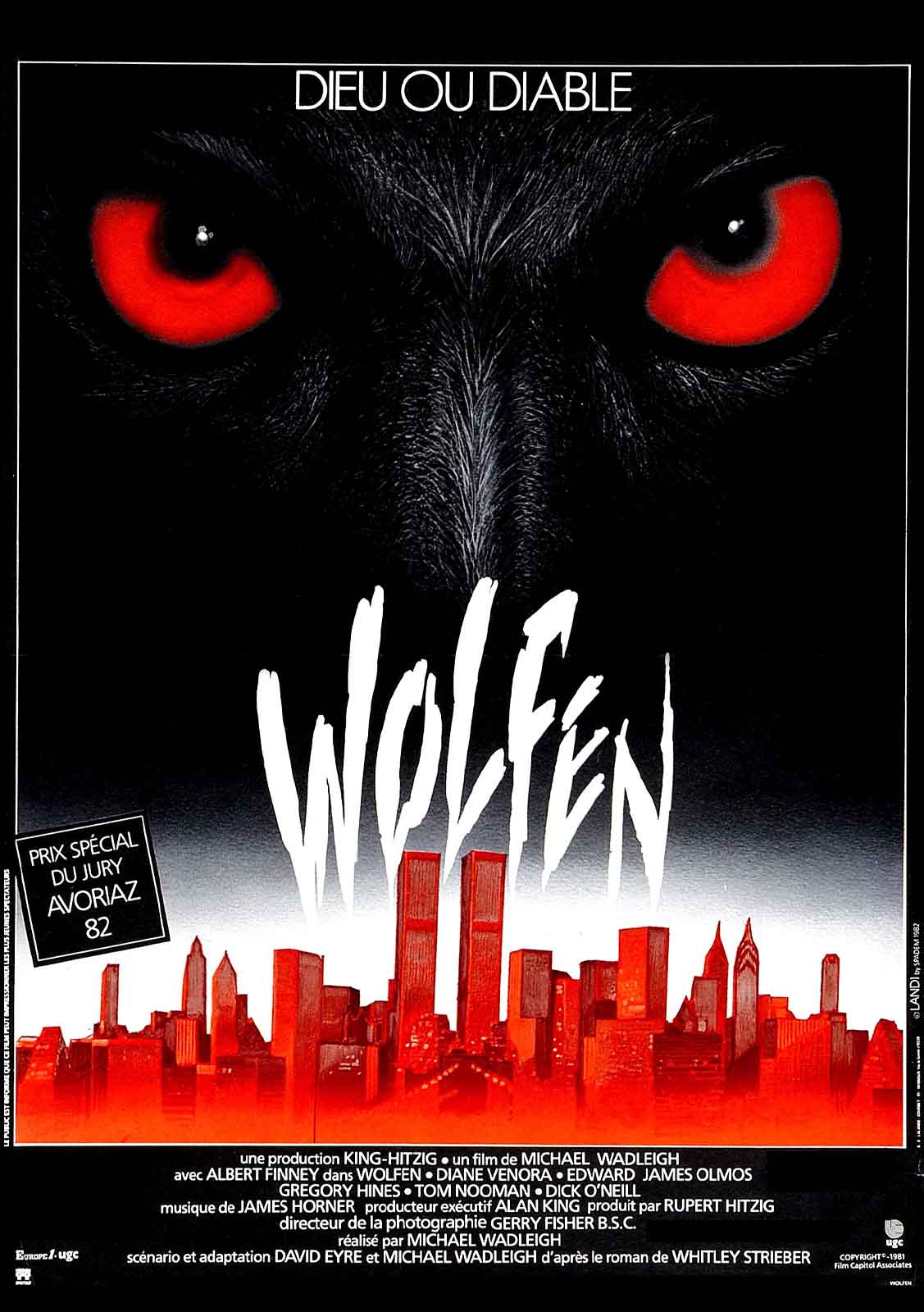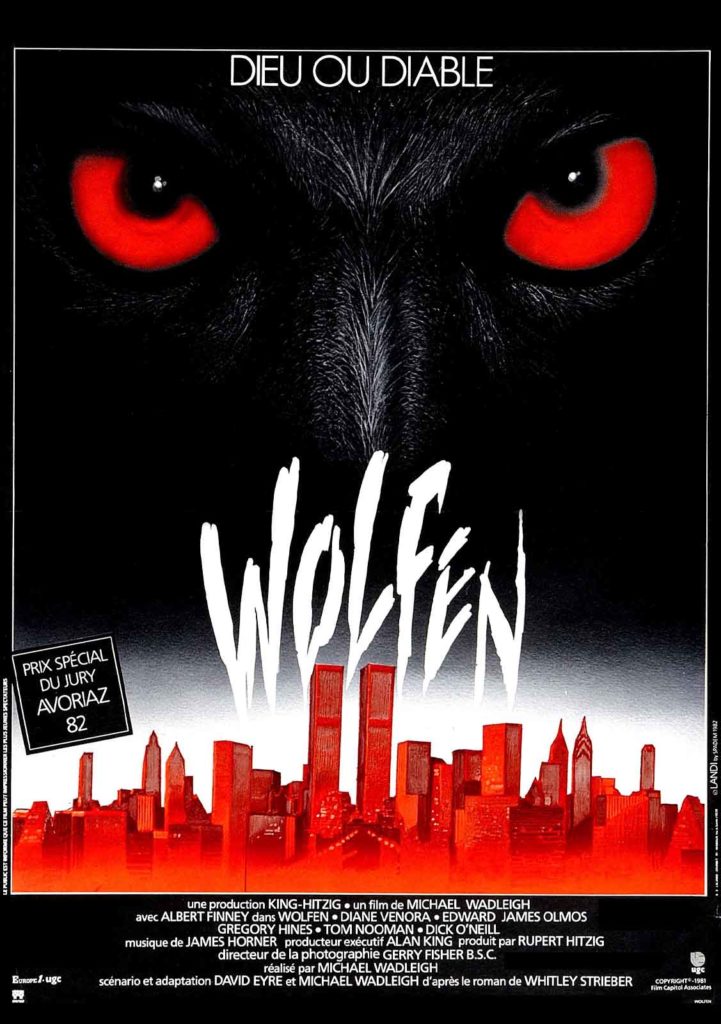Un train, mille voyageurs et un homme infecté par un dangereux virus qui menace de se propager à toute vitesse…
CASSANDRA CROSSING
1976 – USA
Réalisé par George Pan Cosmatos
Avec Sophia Loren, Richard Harris, Ava Gardner, Burt Lancaster, Martin Sheen, O.J. Simpson, John Philip Law, Lesley Ann Warren
THEMA CATASTROPHES
Dix ans avant de flatter les gros bras de Sylvester Stallone dans Rambo 2 et Cobra, George Pan Cosmatos signait cet excellent film catastrophe quelque peu atypique. Tout démarre à Genève, dans le bâtiment de l’organisation mondiale de la santé. Trois terroristes suédois s’infiltrent dans le but de faire sauter l’immeuble. Militant énergiquement contre la guerre bactériologique, ils veulent dénoncer les Etats-Unis qui cultivent là de dangereux bacilles. Deux d’entre eux sont abattus, mais le troisième parvient à s’échapper et à s’introduire clandestinement dans le Transcontinental Express qui relie Genève à Stockholm. Plus de mille voyageurs occupent ce train. Or notre homme est désormais atteint de peste pneumonique, une maladie mortelle et extrêmement contagieuse…


L'apocalypse aura-t-elle lieu ?
Partagez cet article