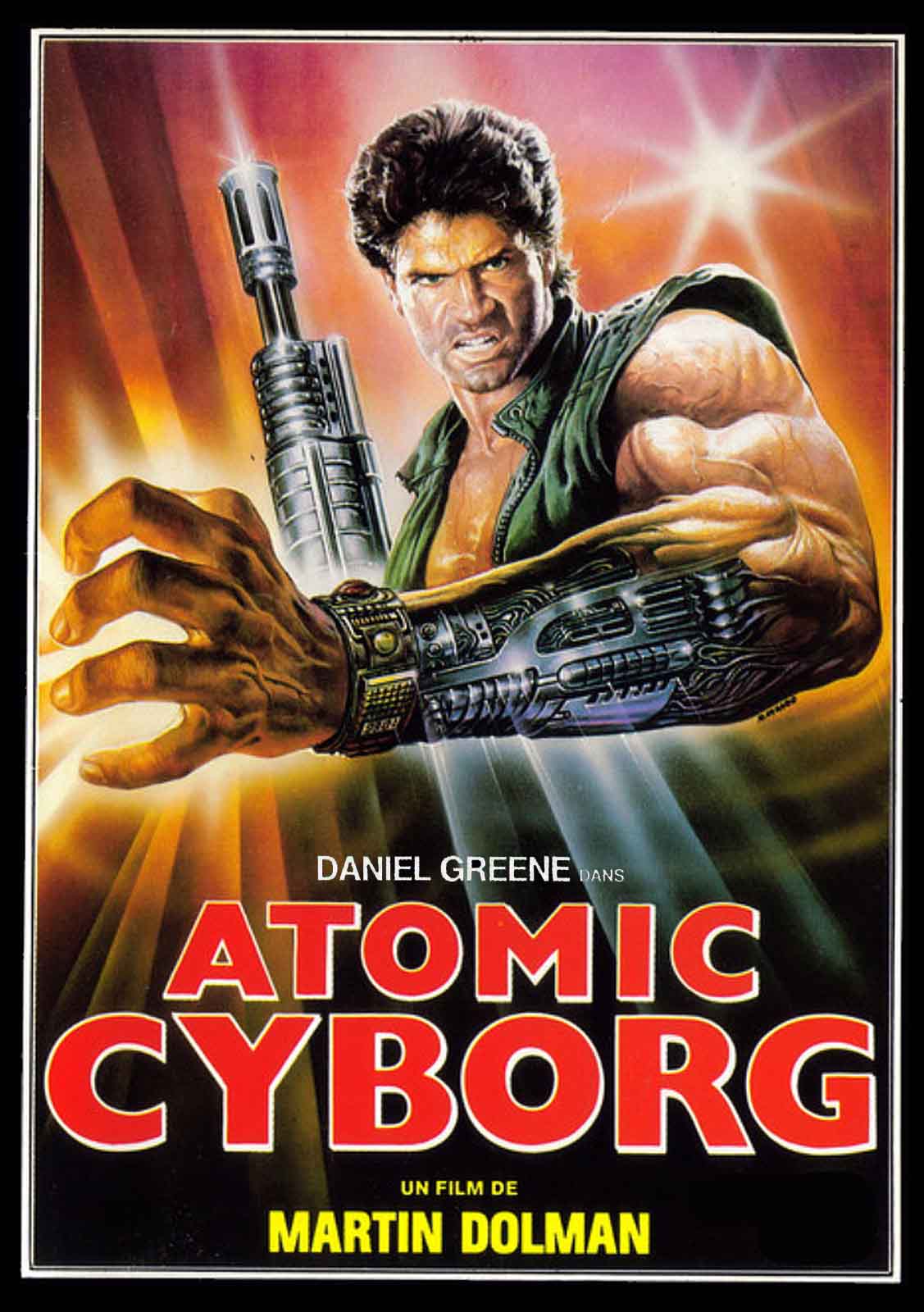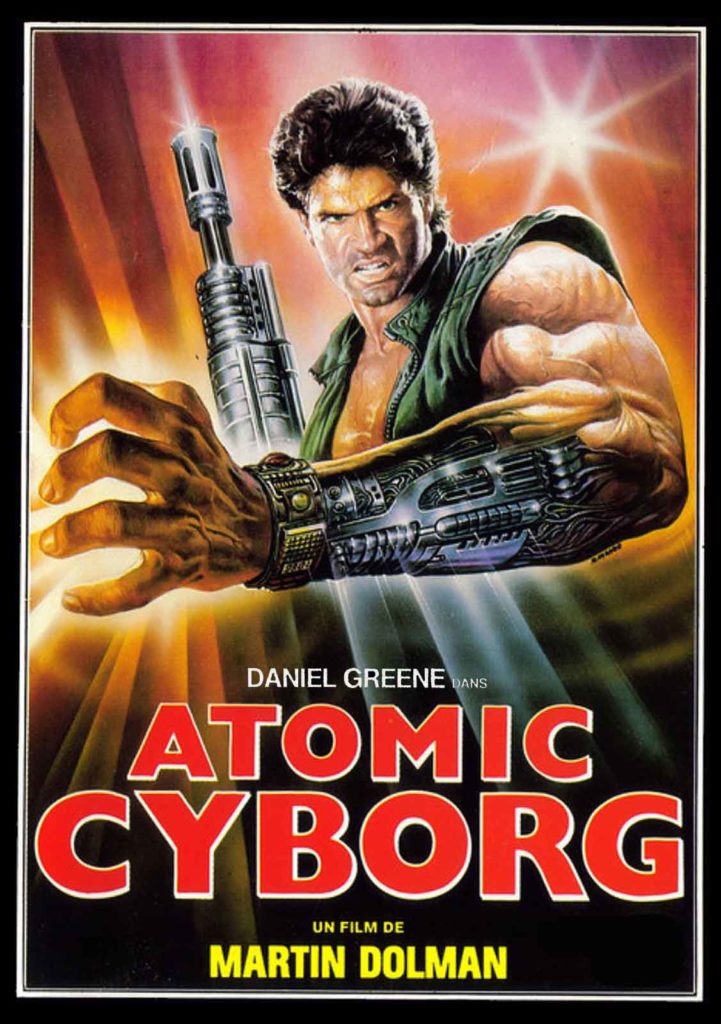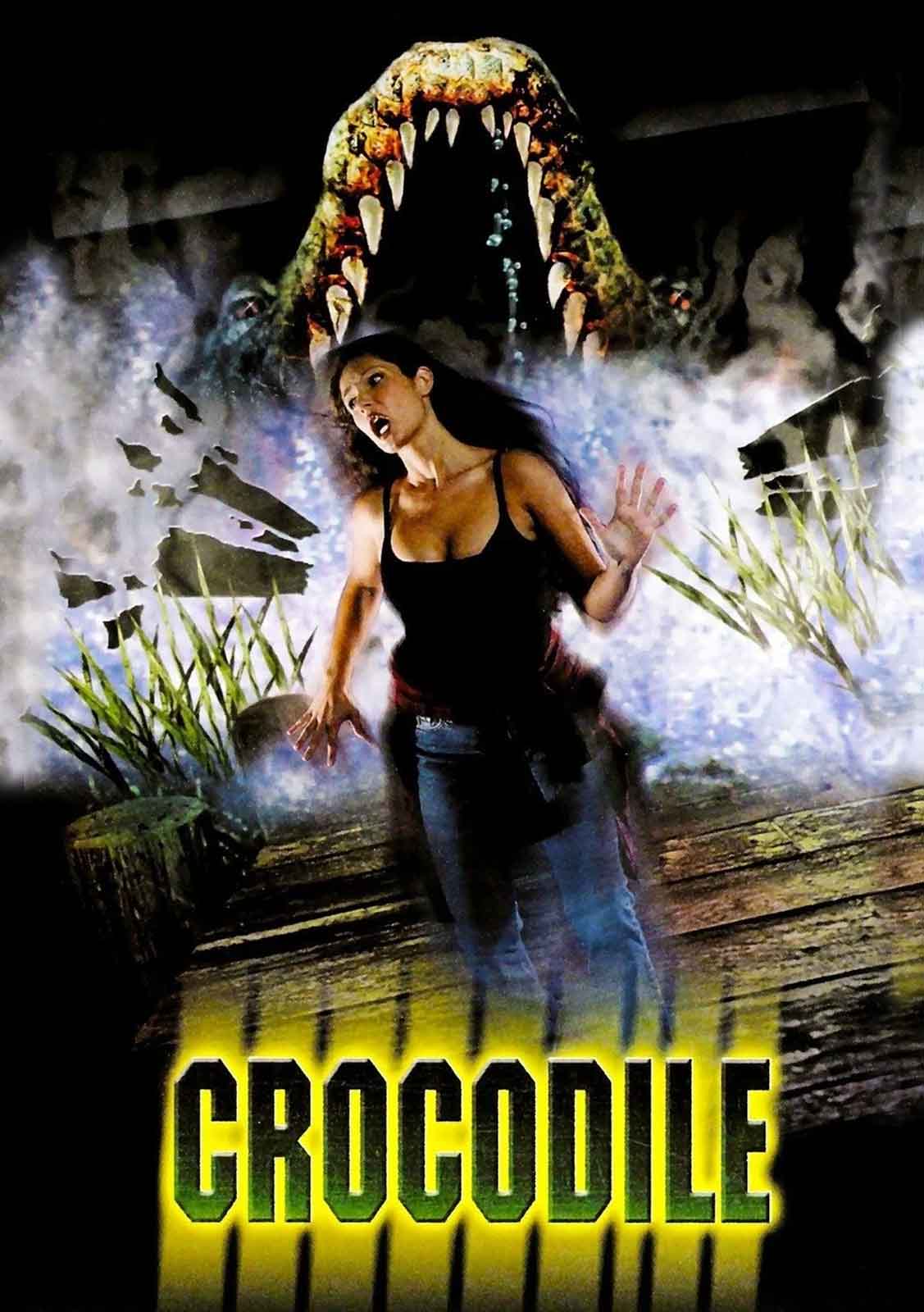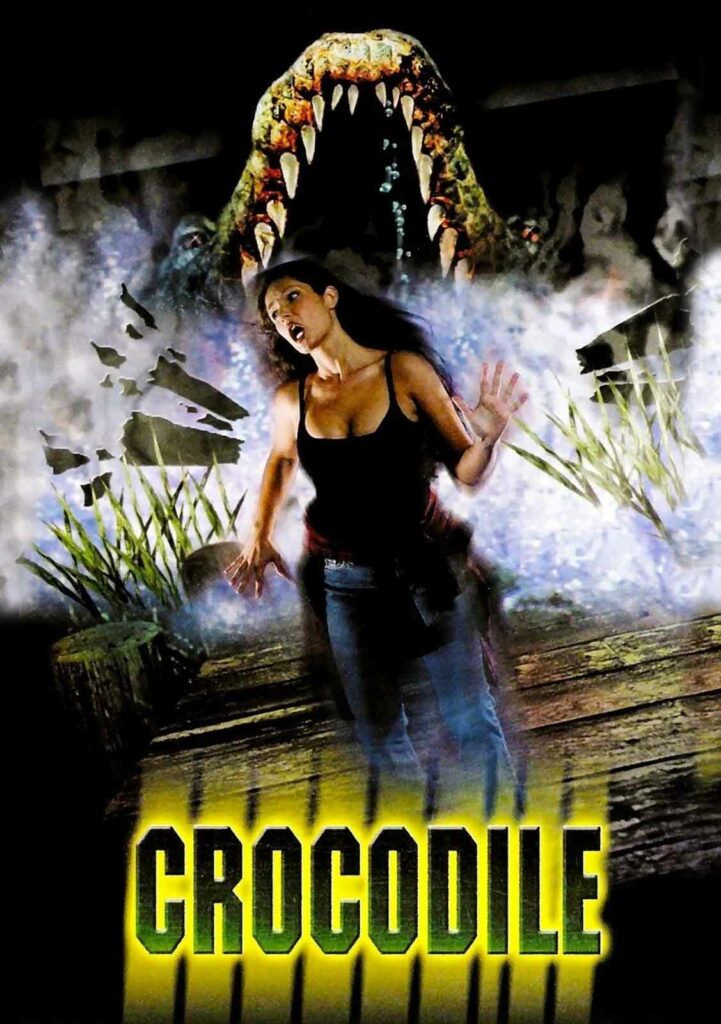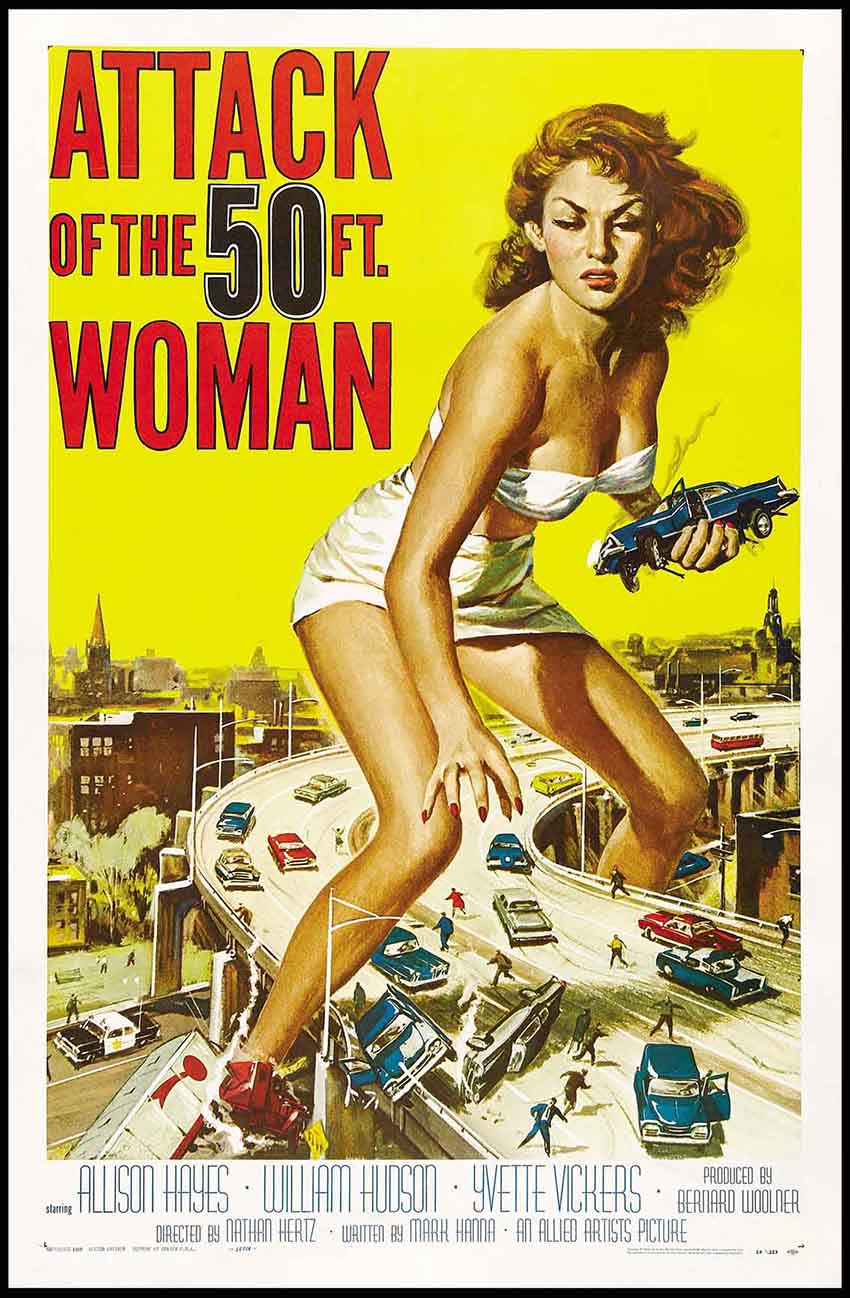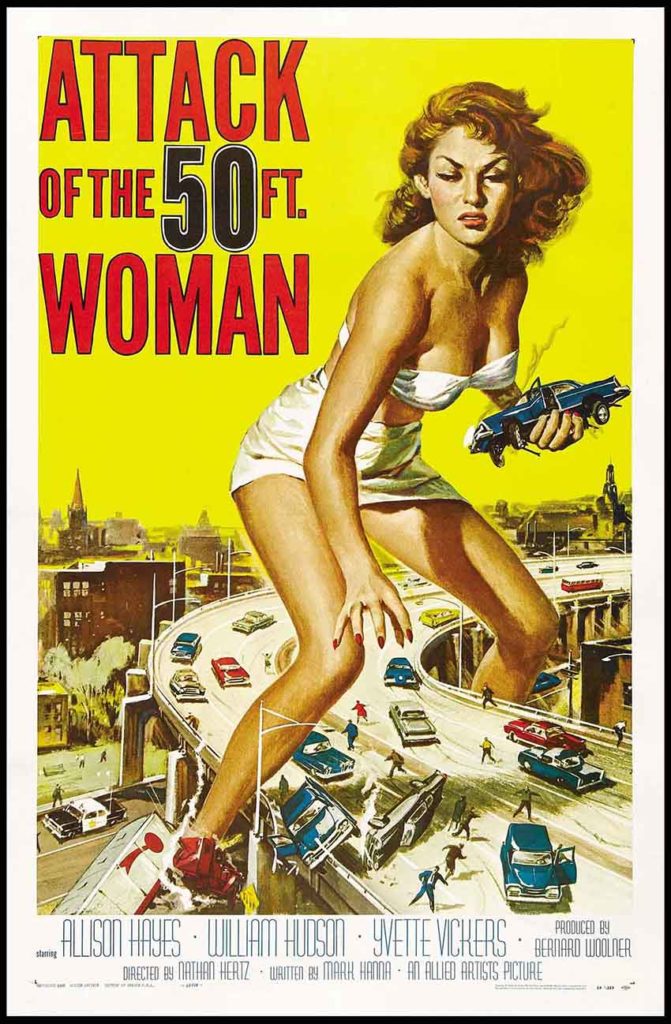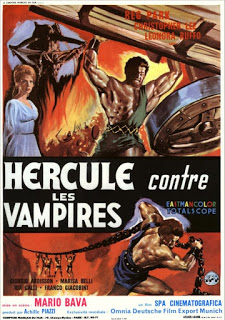Le film le plus rentable de l'histoire du cinéma est aussi celui qui a lancé la mode du « found footage »
THE BLAIR WITCH PROJECT
1999 – USA
Réalisé par Daniel Myrick et Eduardo Sanchez
Avec Heather Donahue, Joshua Leonard, Michael C. Williams, Bob Griffin, Jim King, Sandra Sanchez, Ed Swanson
THEMA SORCELLERIE ET MAGIE
Le manque de moyens peut être un excellent stimulateur de créativité, comme en témoignent dans le genre qui nous intéresse des œuvres aussi réjouissantes qu’Evil Dead ou Bad Taste. Dans le cas du Projet Blair Witch, la contrainte était de ne filmer qu’à l’aide d’un caméscope, à l’exception d’une poignée de plans en 16 mm. Daniel Myrick et Eduardo Sanchez ont donc élaboré l’idée d’un film amateur tourné par trois étudiants partis enquêter dans les bois avoisinant Burkittesville, dans le Maryland. L’objet de leur investigation est une sorcière tenue pour responsable de la disparition d’enfants dans les années 40. Les étudiants disparaissent à leur tour corps et biens, et on retrouve ce qu’ils ont filmé un an plus tard.


L'arbre qui cache la forêt…
Partagez cet article