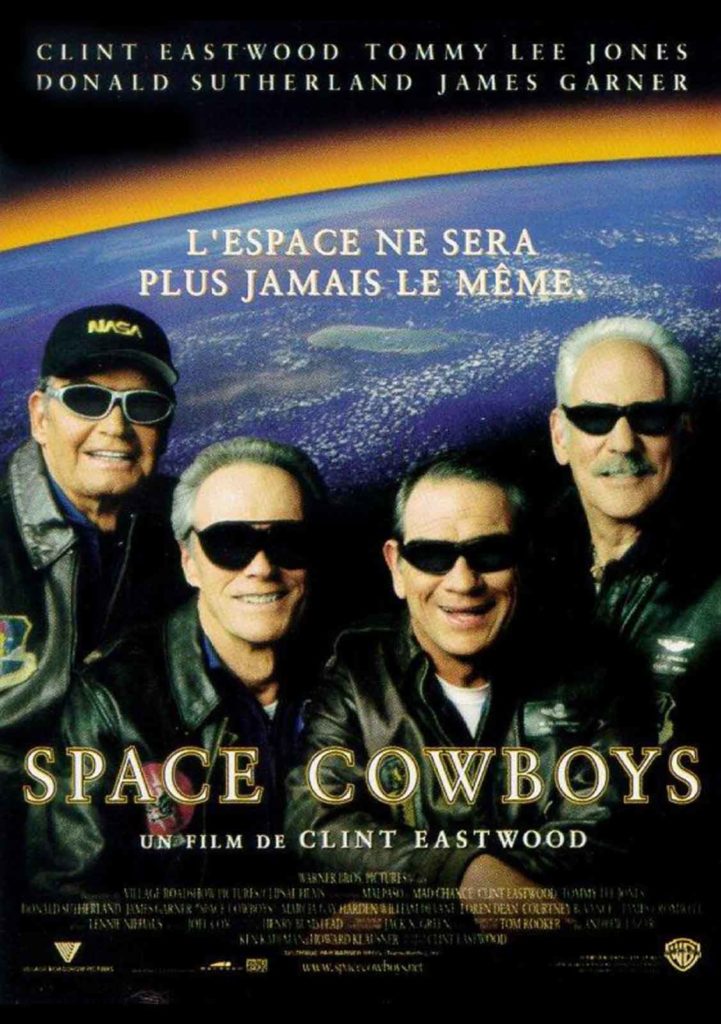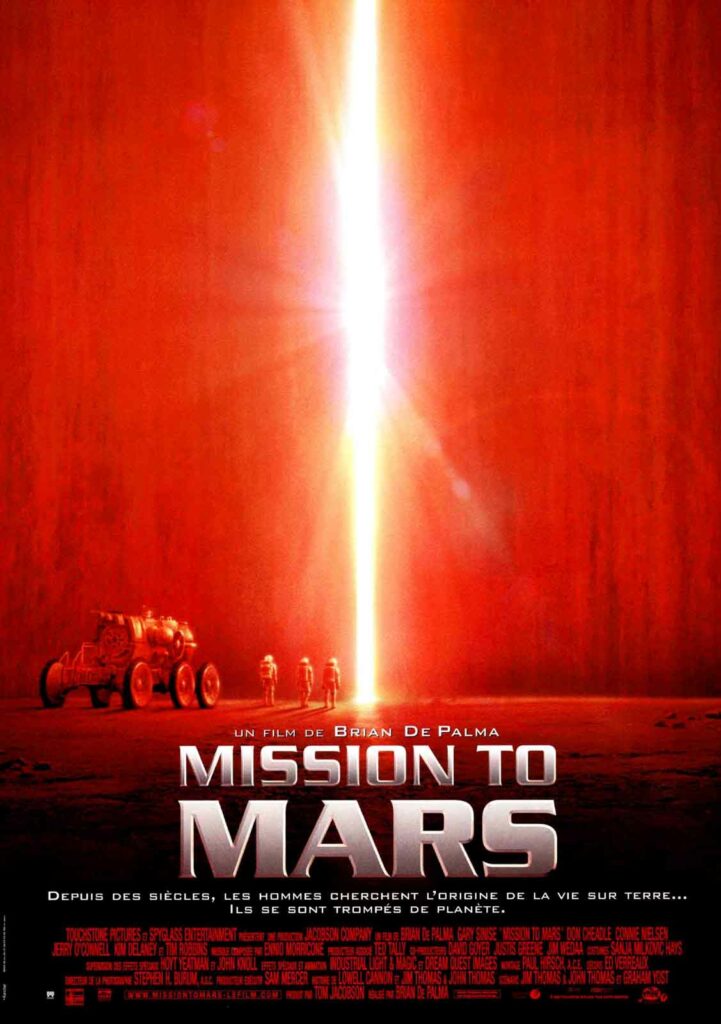Pour son premier long-métrage, Julia Ducournau utilise le cannibalisme comme parabole de l'intégration sociale
GRAVE
2016 – FRANCE
Réalisé par Julia Ducournau
Avec Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabah Nait Oufella, Laurent Lucas, Joana Preiss, Bouli Lanners
THEMA CANNIBALES
Véritable « aimant à récompenses » à travers les nombreux festivals dont il aura marqué sa sulfureuse présence, Grave est un exercice d’équilibre osé qui joue audacieusement avec les sentiments du spectateur en suscitant tour à tour le rire, l’émotion et la répulsion la plus viscérale. Alors qu’elle fait ses premiers pas dans une prestigieuse école vétérinaire, Justine (Garance Marillier), étudiante végétarienne, découvre les rites d’intégration auxquels sont contraints de se soumettre les étudiants et se laisse guider par un étrange instinct qui l’attire irrésistiblement vers la chair humaine. « Le bizutage est un élément clef du film, car pour moi il symbolise la manière dont les gens se traitent entre eux dans notre société », explique la réalisatrice Julia Ducournau. « Je voulais parler d’uniformisation des masses et de révolte. Selon moi, ce type de comportement ne peut qu’engendrer l’ultra-violence. Dans le film, le bizutage sert d’élément déclencheur. Pour le personnage principal de Grave, devenir cannibale est un geste de rébellion contre un establishment extrêmement formaté. » (1)


En cultivant des obsessions proches de celles du cinéma organique de David Cronenberg, Julia Ducournau fusionne les mutations psychologiques et physiologiques de sa jeune héroïne sans se laisser brider par le moindre tabou. Elle s’inscrit ainsi dans la suite logique de ses deux films précédents, qui donnaient déjà la vedette à la jeune comédienne Garance Marillier : le court-métrage Junior, dans lequel une jeune fille voit son corps se couvrir d’écailles, et le téléfilm Mange, où une ancienne obèse est hantée par le fantôme de la fille en surpoids qu’elle fut. « Ces deux films ont comme point commun le thème de la transformation physique radicale et de la dévoration », nous explique la réalisatrice. « En ce sens, Grave assure une certaine continuité avec eux. » (2) Généreux en séquences d’horreur graphique manifestement conçues pour provoquer le malaise et l’inconfort, Grave place cependant ses ambitions au-delà du simple effet d’aversion. Ici, l’anthropophagie sert de vecteur idéal pour évoquer le passage de l’adolescence à l’âge adulte, mais aussi pour s’interroger sur la destinée et sur le libre-arbitre. A fleur de peau, Garance Marillier se livre à une prestation étourdissante, tutoyant presque par moments les moments de folie furieuse d’Isabelle Adjani dans Possession.
Sur les traces de David Cronenberg
Partagez cet article