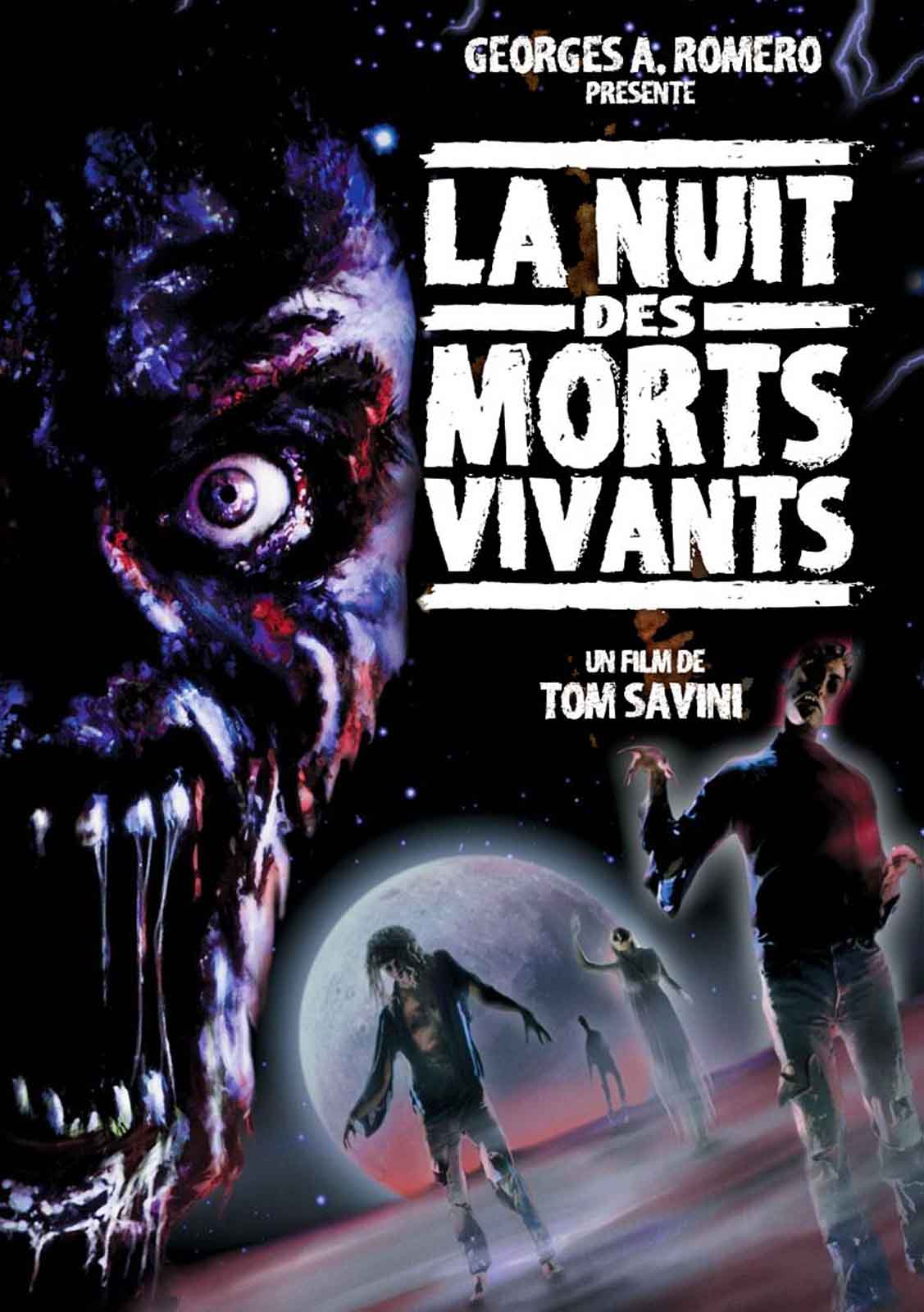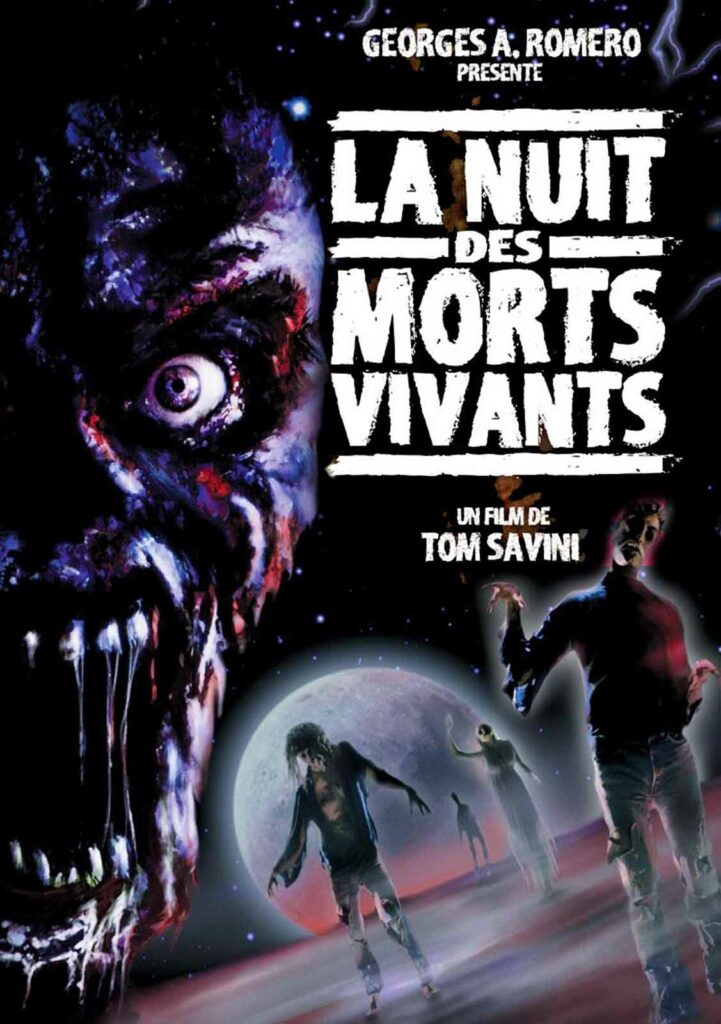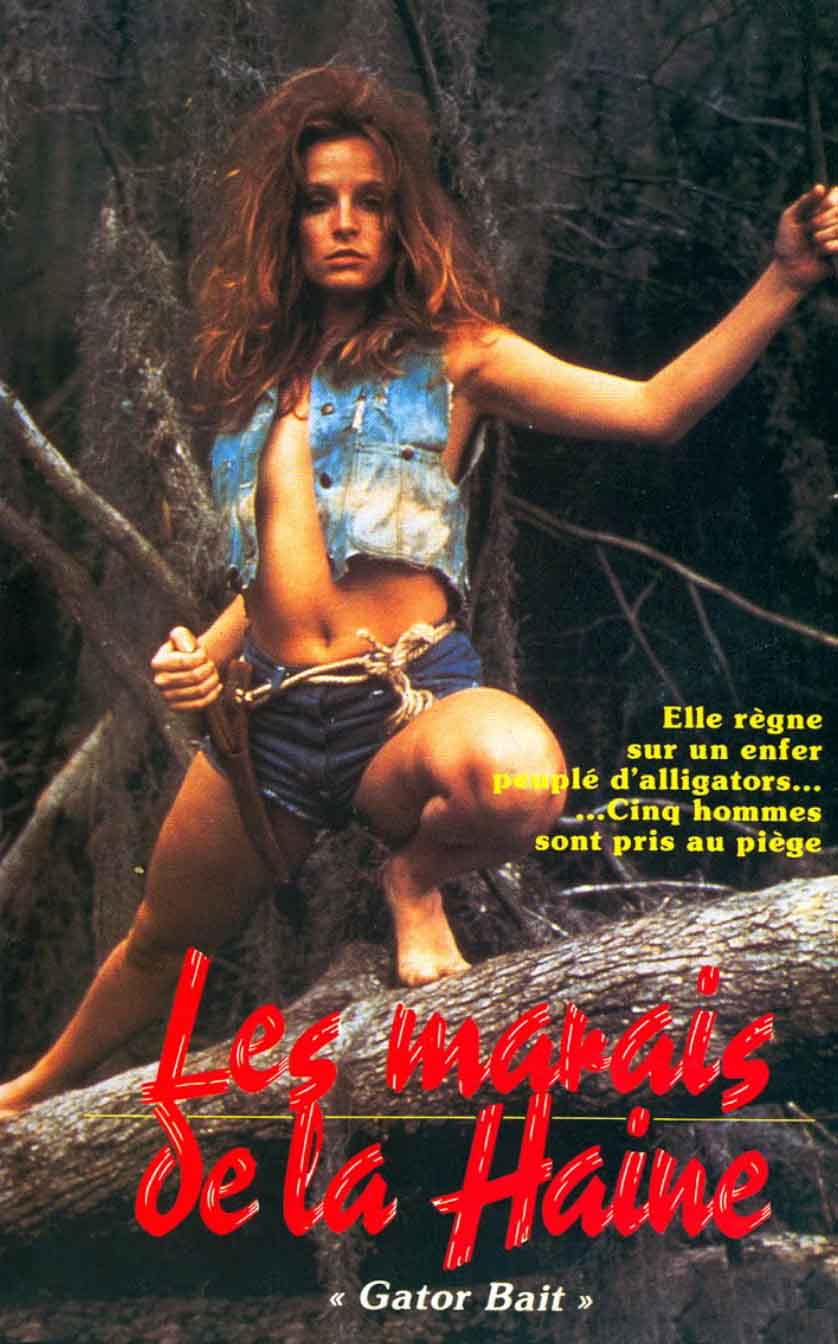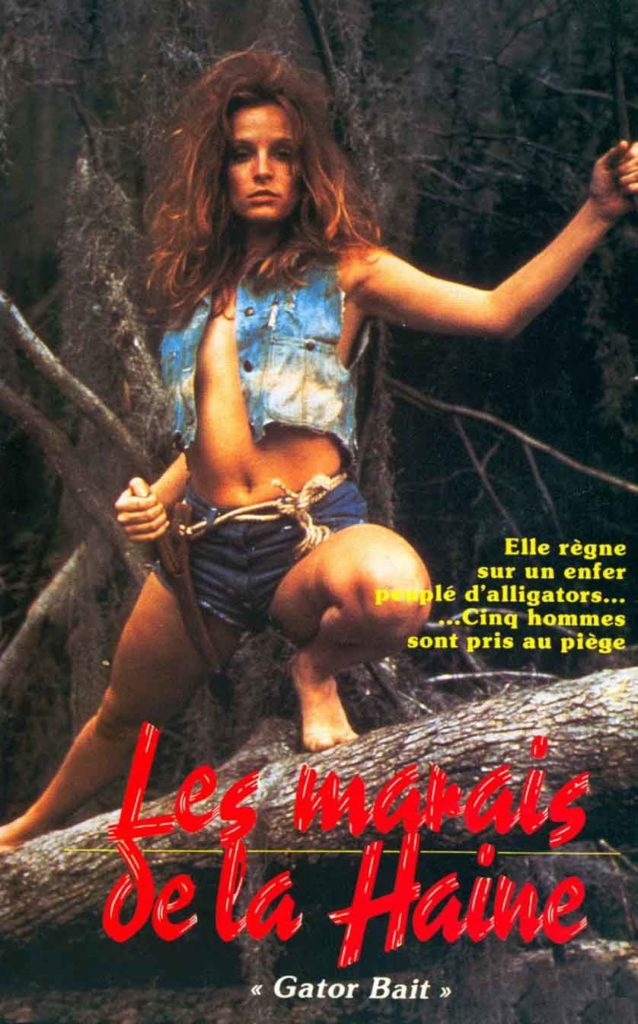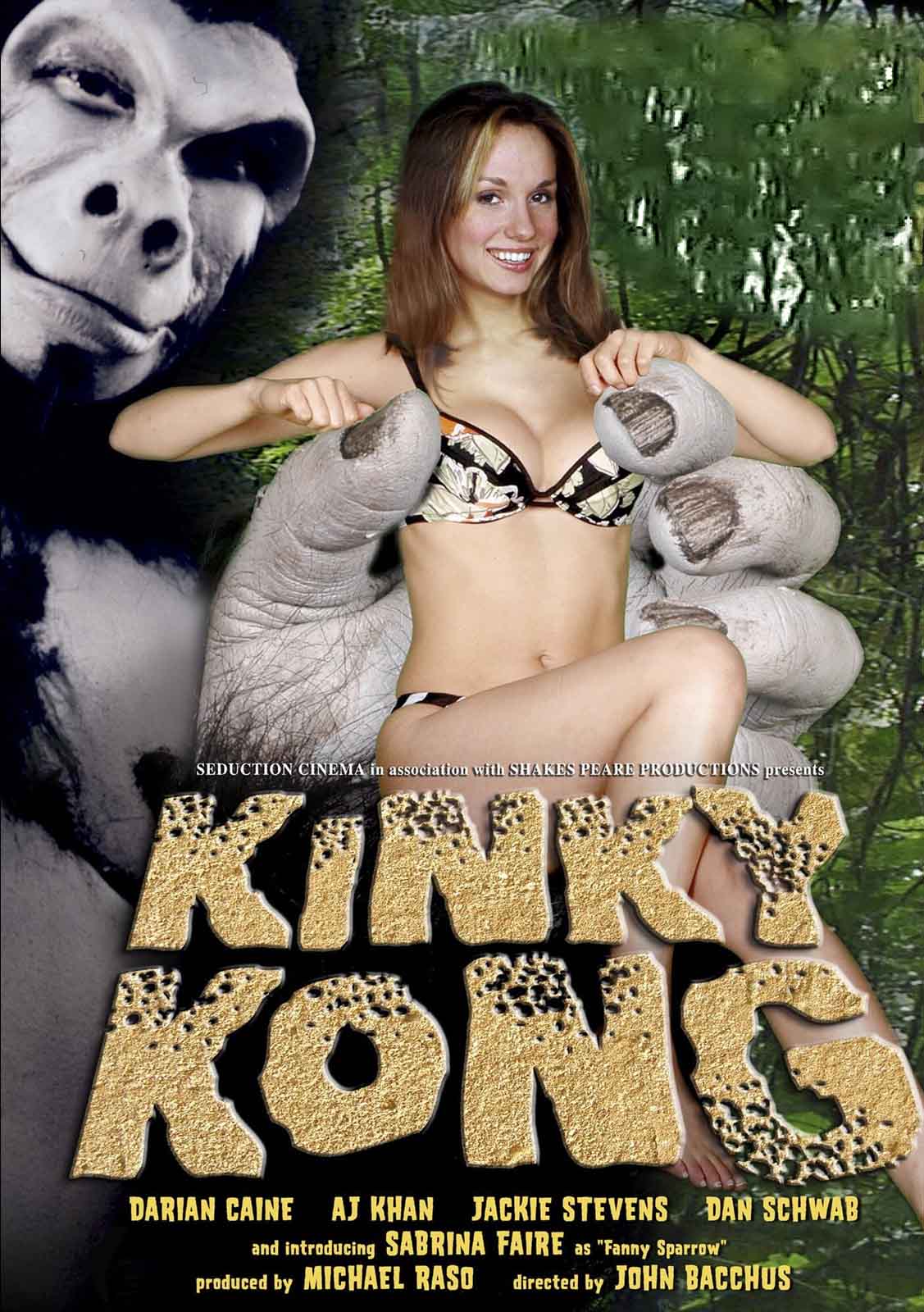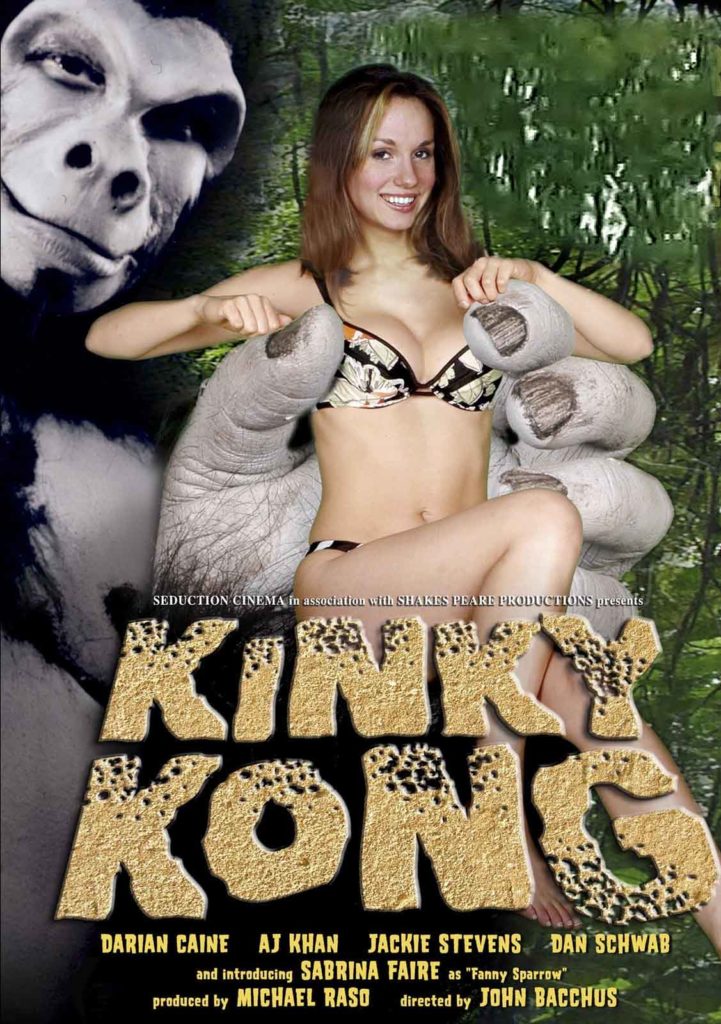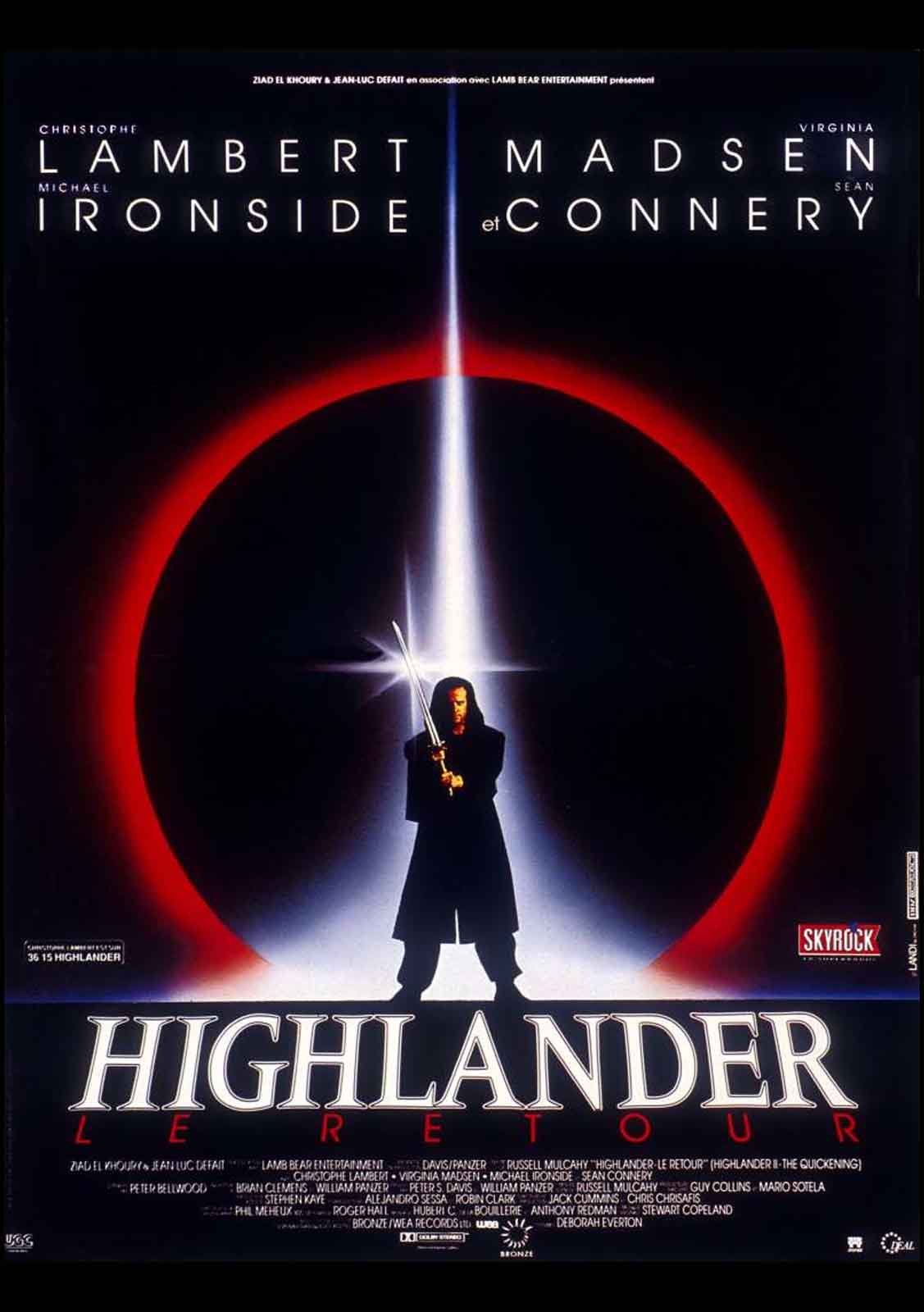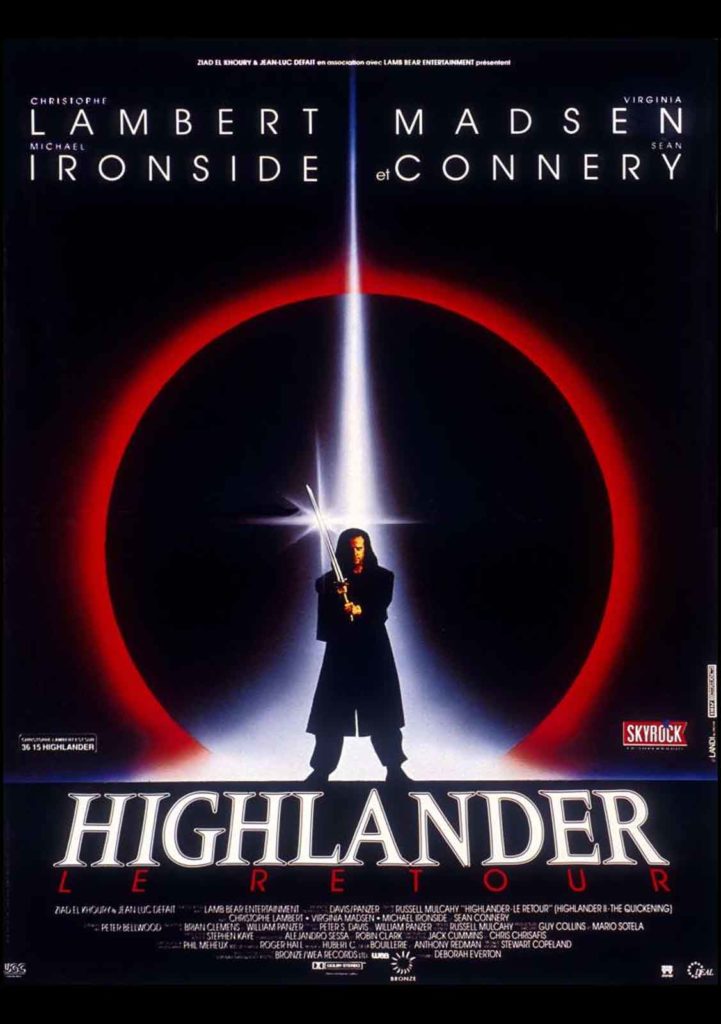Contrairement aux apparences, ce récit d'une fillette coréenne et de son gentil cochon géant n'a rien d'un conte pour enfants
OKJA
2017 – COREE DU SUD / USA
Réalisé par Bong Joon-ho
Avec Ahn Seo-hyeon, Tilda Swinton, Paul Dano, Jake Gyllenhaal, Byeon Hee-bong, Steven yeun, Lily Collins, Yoon Je-moon
THEMA MAMMIFÈRES
Bong Joon-ho n’est pas du genre à arpenter les sentiers gentiment balisés par ses prédécesseurs. Avec des œuvres aussi atypiques que The Host ou Le Transperceneige, il s’emparait d’univers extrêmement codifiés (le film de monstre géant et la fable post-apocalyptique) pour les dynamiter de l’intérieur et les revisiter de fond en comble. En toute logique, son approche du conte allégorique ne ressemble à rien de connu. A tel point que Okja prend vite les allures d’un OVNI un peu indéfinissable. Tilda Swinton incarne avec une jovialité teintée de duplicité Lucy Mirando, héritière de l’empire Mirando Corporation. Face aux médias, elle annonce fièrement la création d’une nouvelle race de cochons géants. Vingt-six d’entre eux seront élevés en pleine nature, à différents endroits du globe, pendant une dizaine d’années. A l’issue de ce délai, l’un d’eux sera couronné plus beau cochon du monde. Nous découvrons alors la petite Mija (Ahn Seo-hyeon), qui vit avec son grand-père dans une montagne de Corée du Sud, loin de la ville, et voue une amitié indéfectible au cochon femelle géant Okja. Les premières images de la fillette et son ami quadrupède (une incroyable réussite numérique conçue par l’équipe de Method Studios) évoquent tour à tour Mon Voisin Totoro, Peter et Elliott le Dragon ou même E.T. l’extraterrestre. Or si Miyazaki, Spielberg et les studios Disney semblent influencer partiellement le film, Bong Joon-ho brise une fois de plus tous les codes.


Lorsque la compagnie Morando vient réclamer son dû et que le Front de Libération des Animaux s’en mêle, les choses dégénèrent et d’époustouflantes séquences d’action scandent le film, comme la course-poursuite en camion dans les rues de Séoul ou encore l’évasion d’Okja qui sème une belle panique dans les rues de la ville puis dans un grand magasin. De tels passages nous coupent le souffle par leur ambition, même si l’on peine à comprendre où le film veut en venir. Cette salve manifeste à l’encontre de l’hypocrisie des grosses corporations, de certains « écolo-terroristes » extrémistes et de la bêtise humaine en général fonctionnerait sans doute si la quasi-totalité des protagonistes n’était pas traitée sous un angle aussi caricatural. La palme en ce domaine revient probablement à Jake Gyllenhaal, assez insupportable en présentateur d’émissions animalières complètement hystérique. Le message a donc du mal à passer, seule la jeune Ahn Seo-hyeon nous offrant une certaine sobriété de jeu.
Partagé entre le burlesque, le drame et le conte fantastique
L’autre problème majeur du film est son positionnement. A priori, l’histoire d’une petite fille et de son ami le monstre gentil est destinée aux enfants. Mais avec un « fuck » inséré toutes les deux minutes dans les dialogues et une séquence très éprouvante située dans un monstrueux abattoir, la cible visée n’est manifestement pas enfantine. Partagé entre l’humour burlesque, le drame, le conte fantastique, le film de monstre, la satire sociale anticapitaliste et écologique et la science-fiction pure et dure, Okja semble ne pas savoir sur quel pied danser. En peine de trouver le bon équilibre et le ton juste, le film nous intrigue et nous surprend, ce qui n’est déjà pas si mal, mais laisse un arrière-goût indigeste qui entrave notre pleine implication émotionnelle.
© Gilles Penso
Partagez cet article