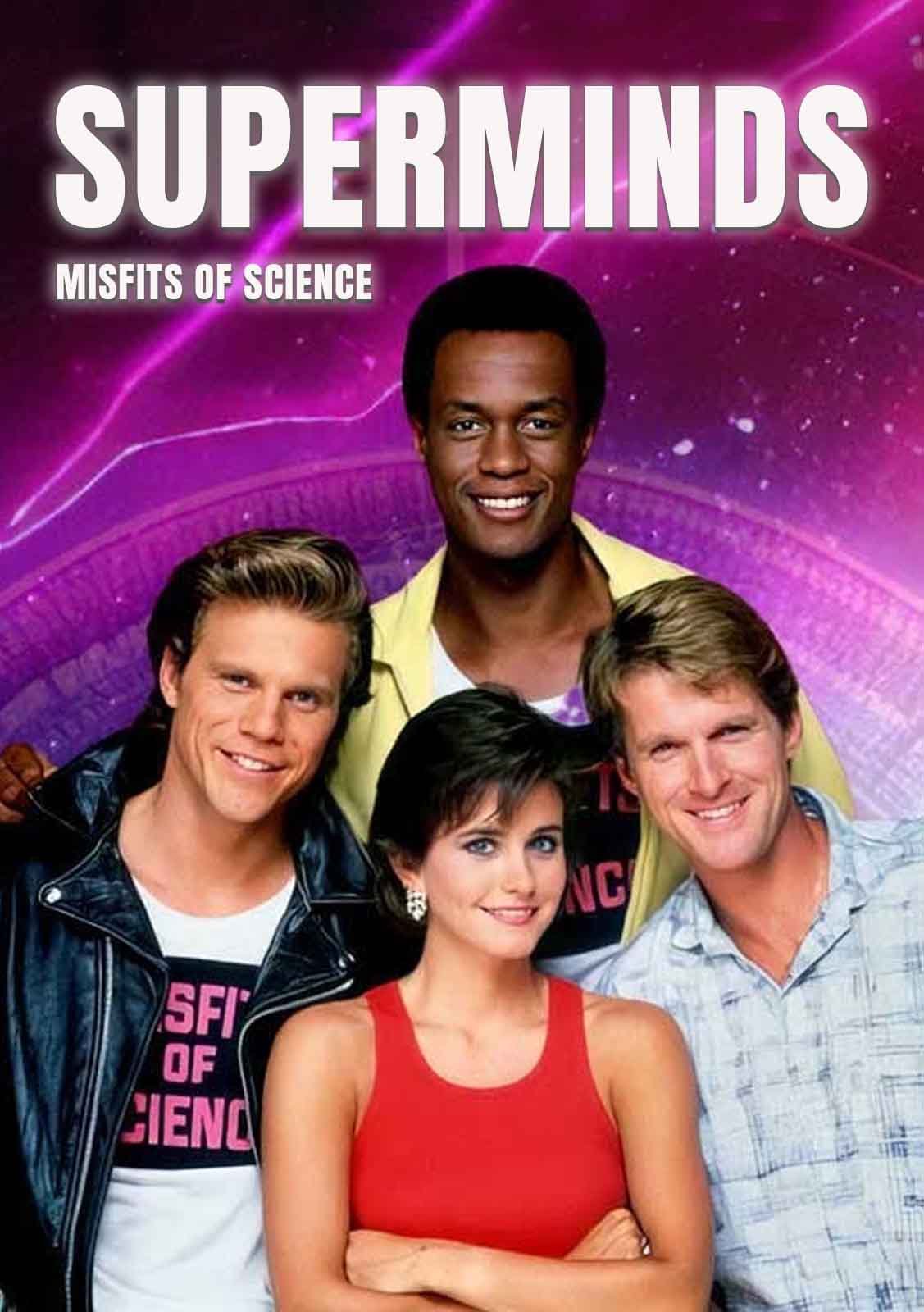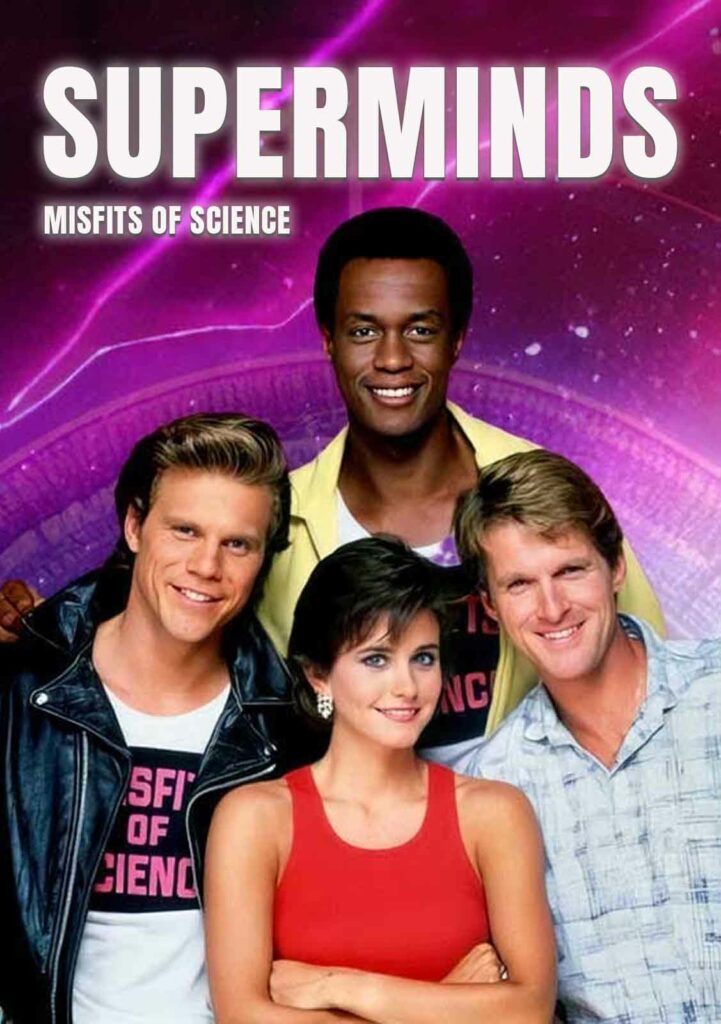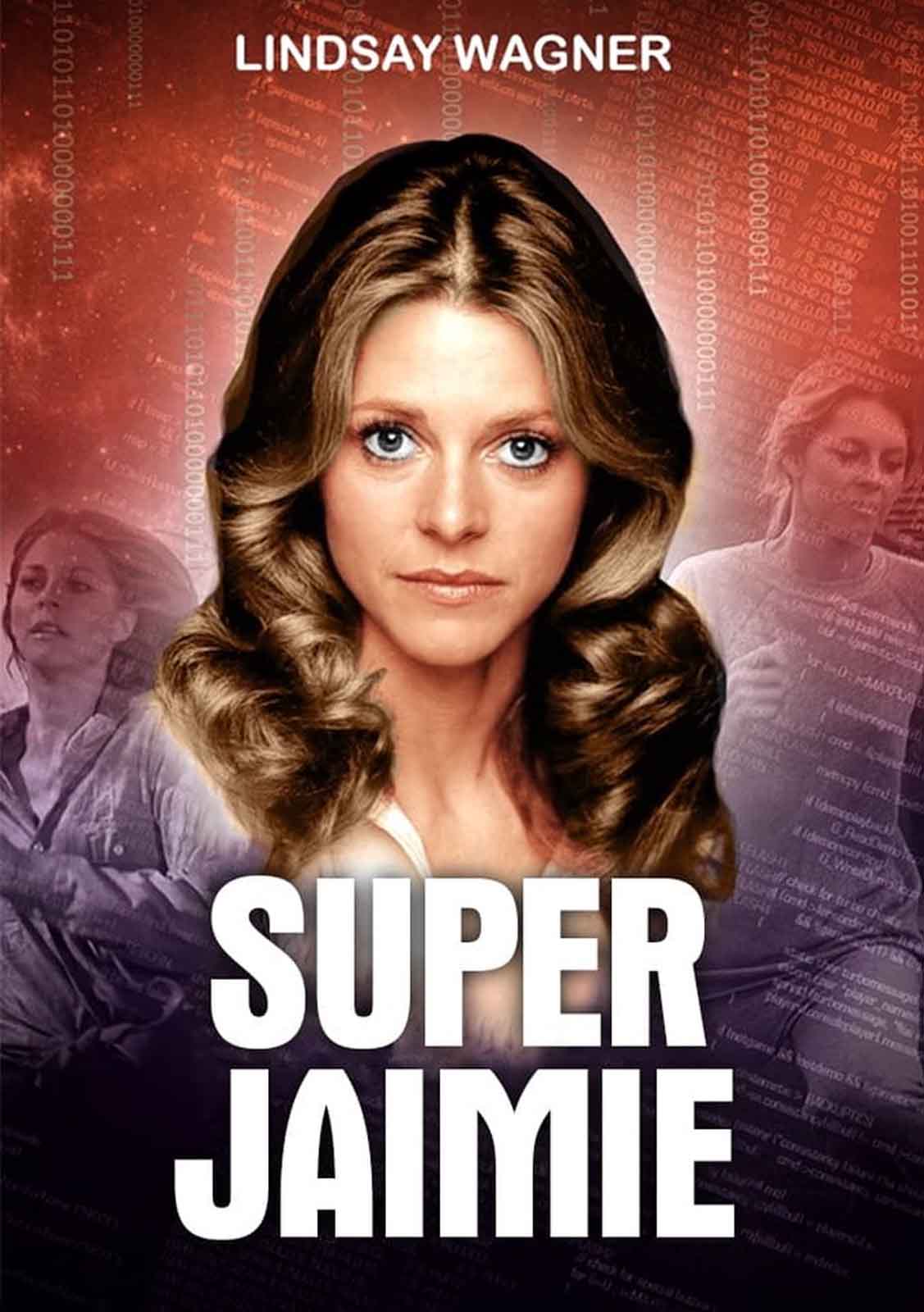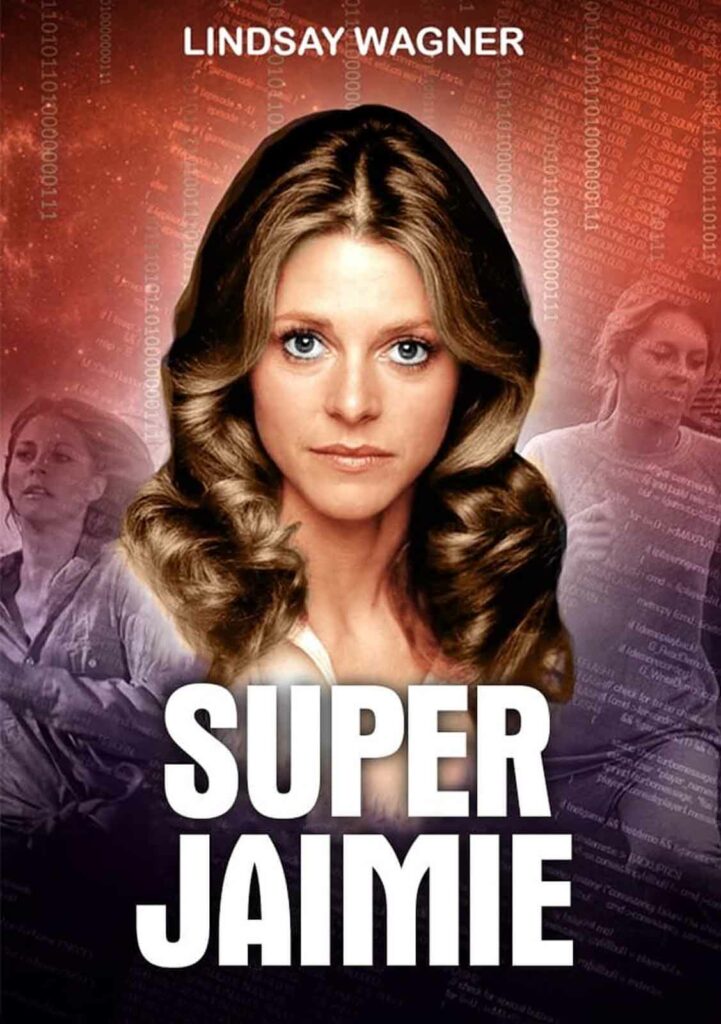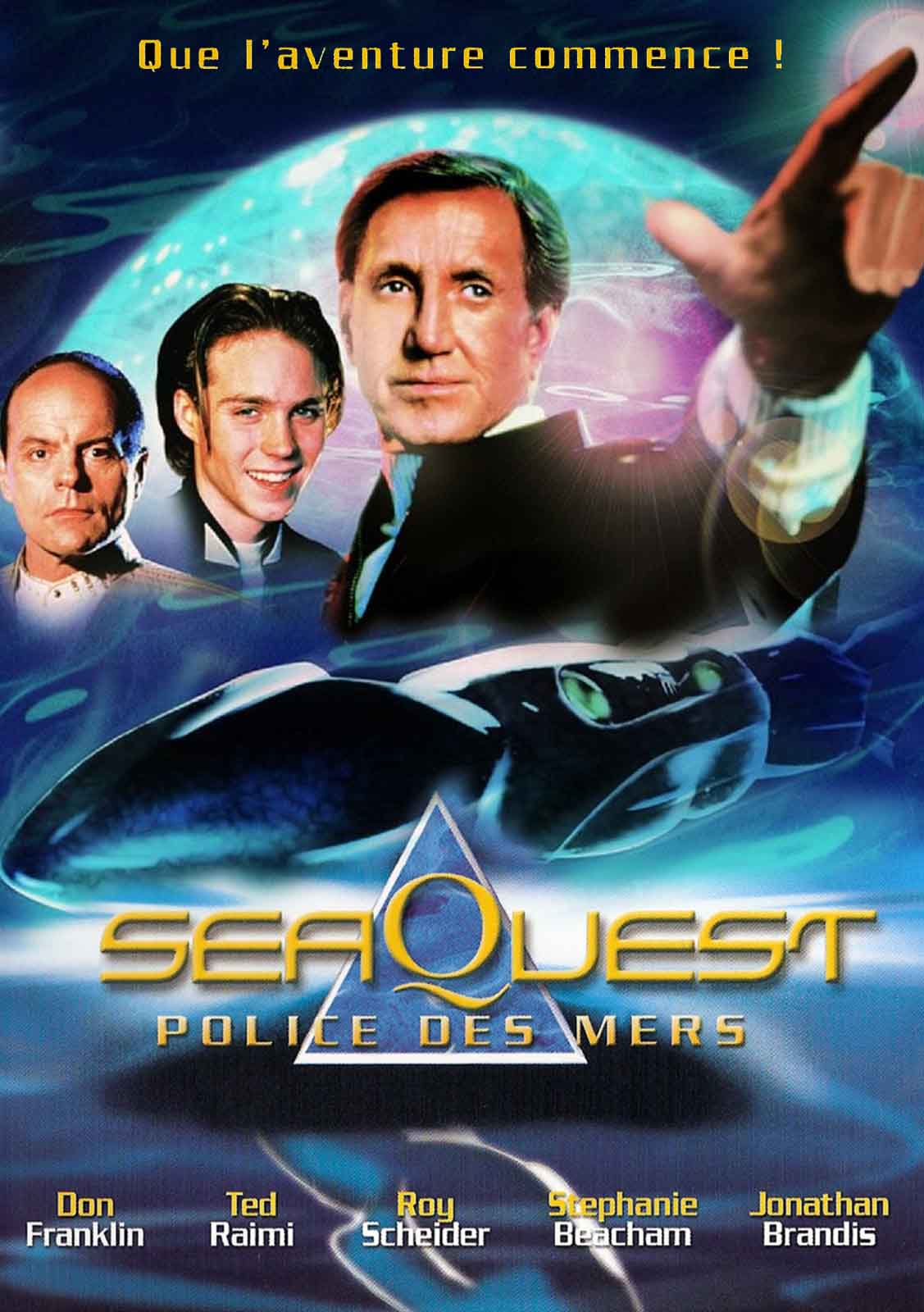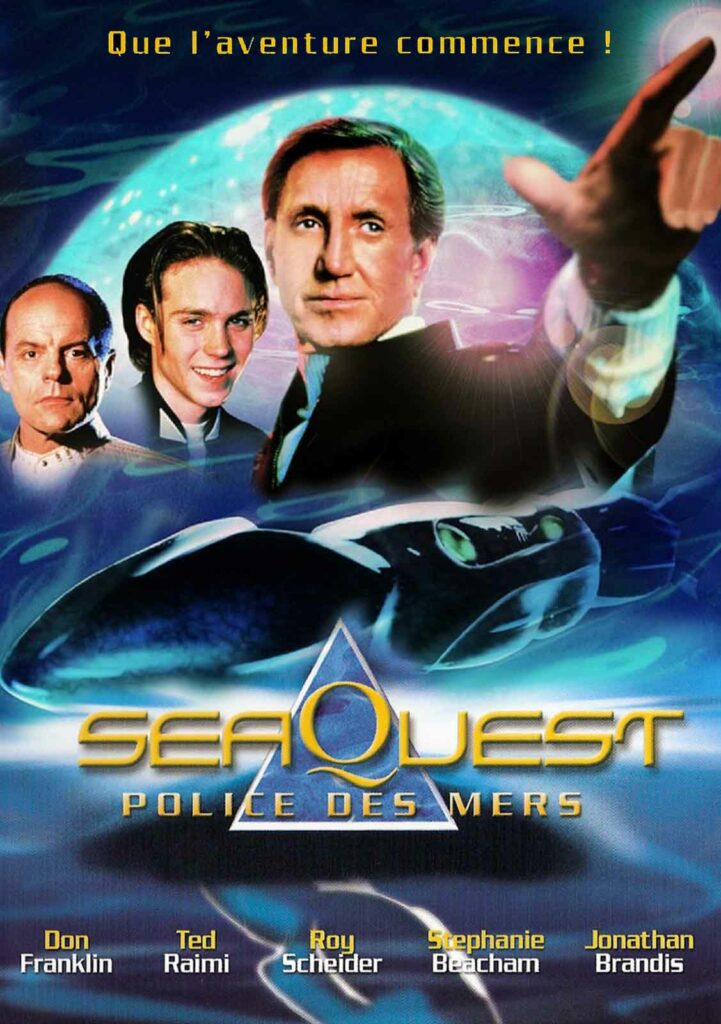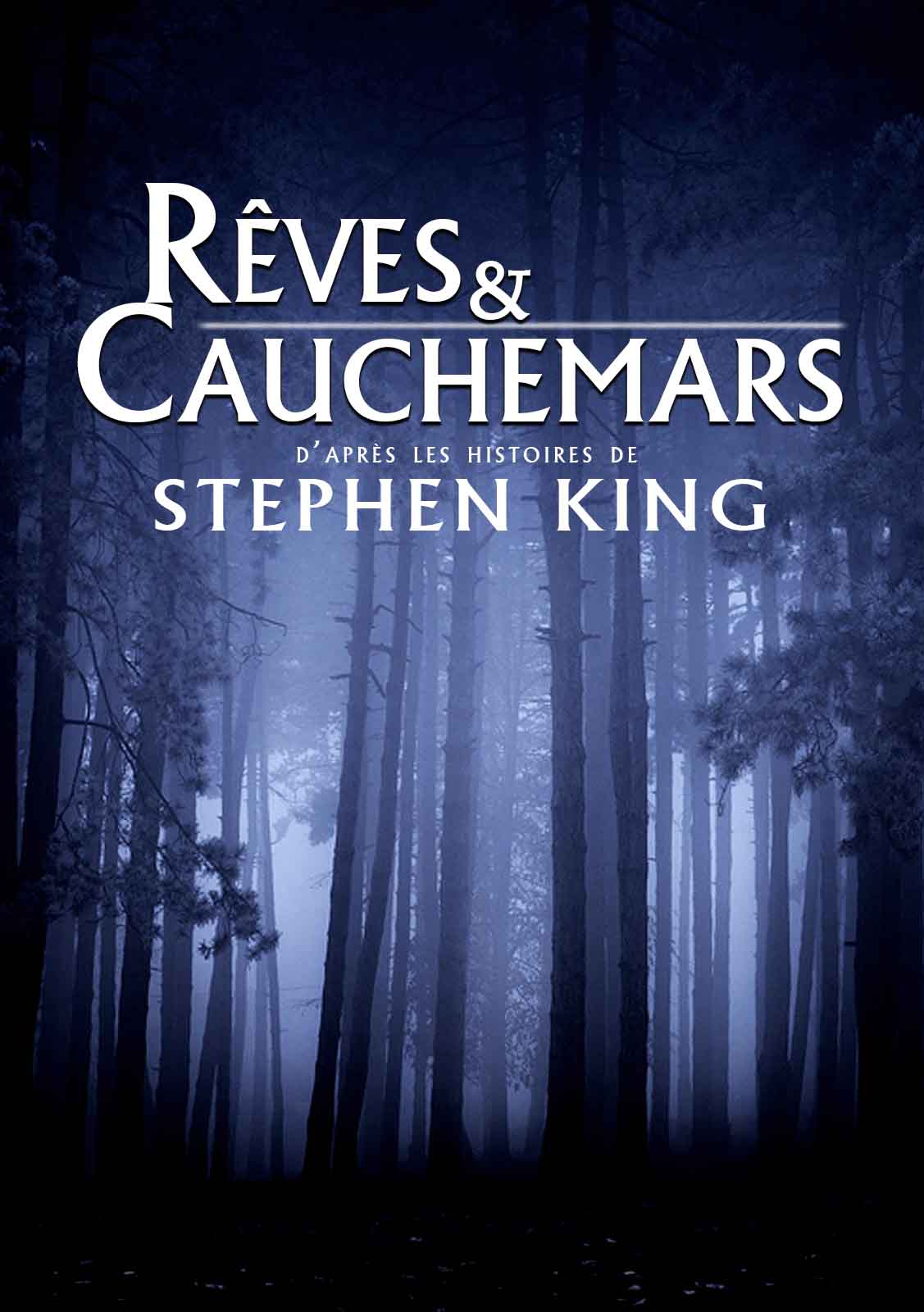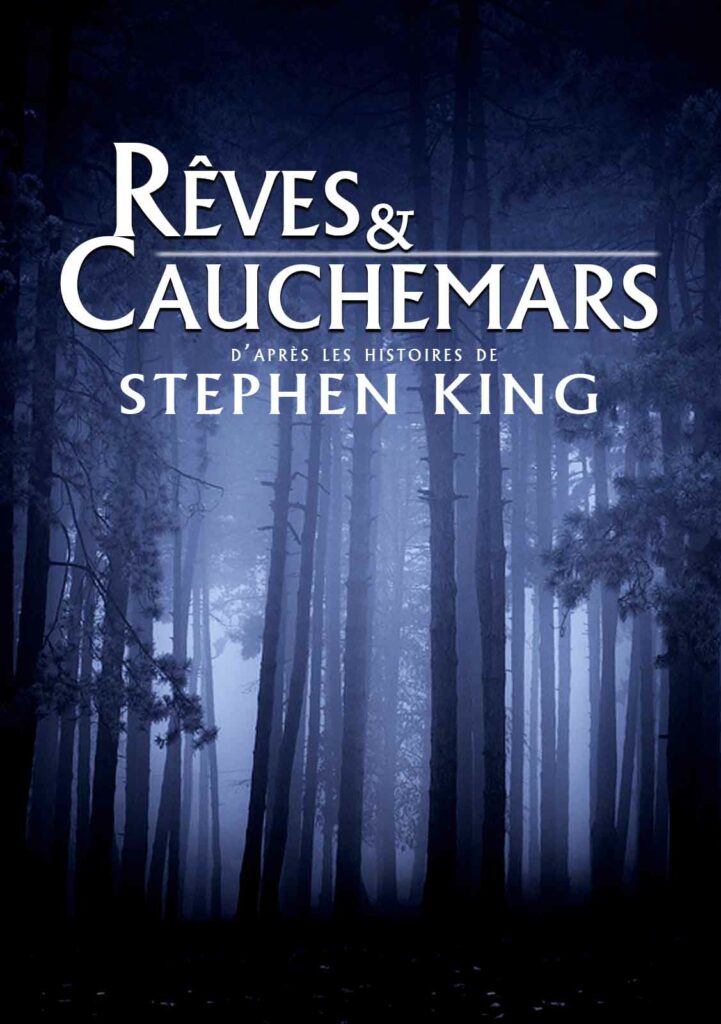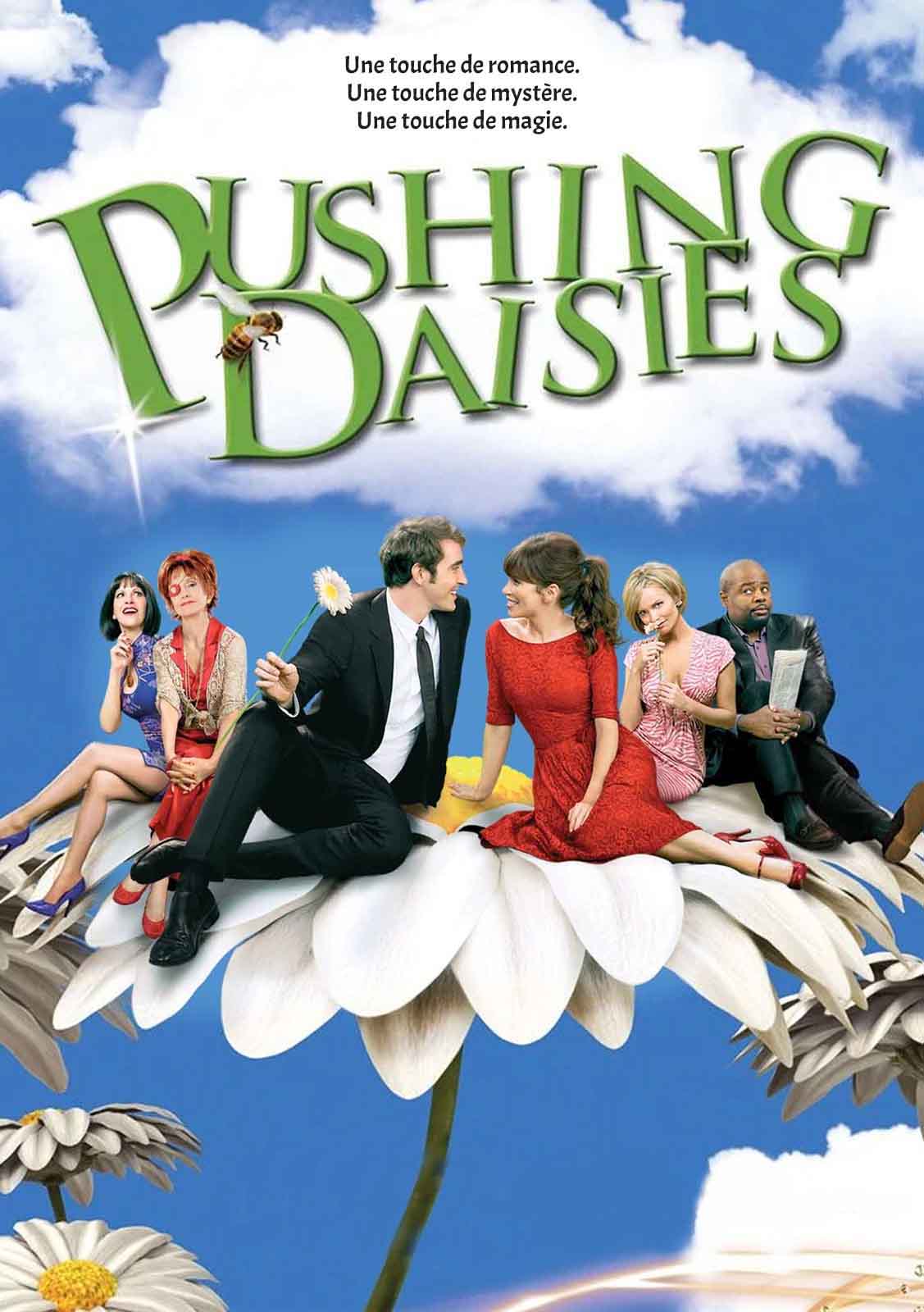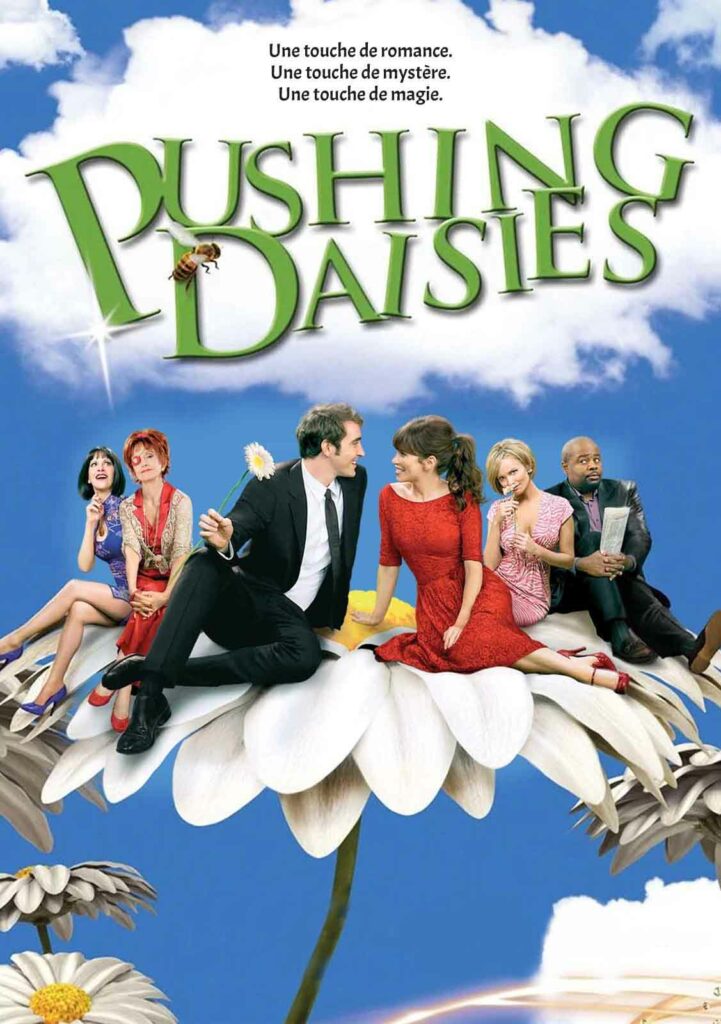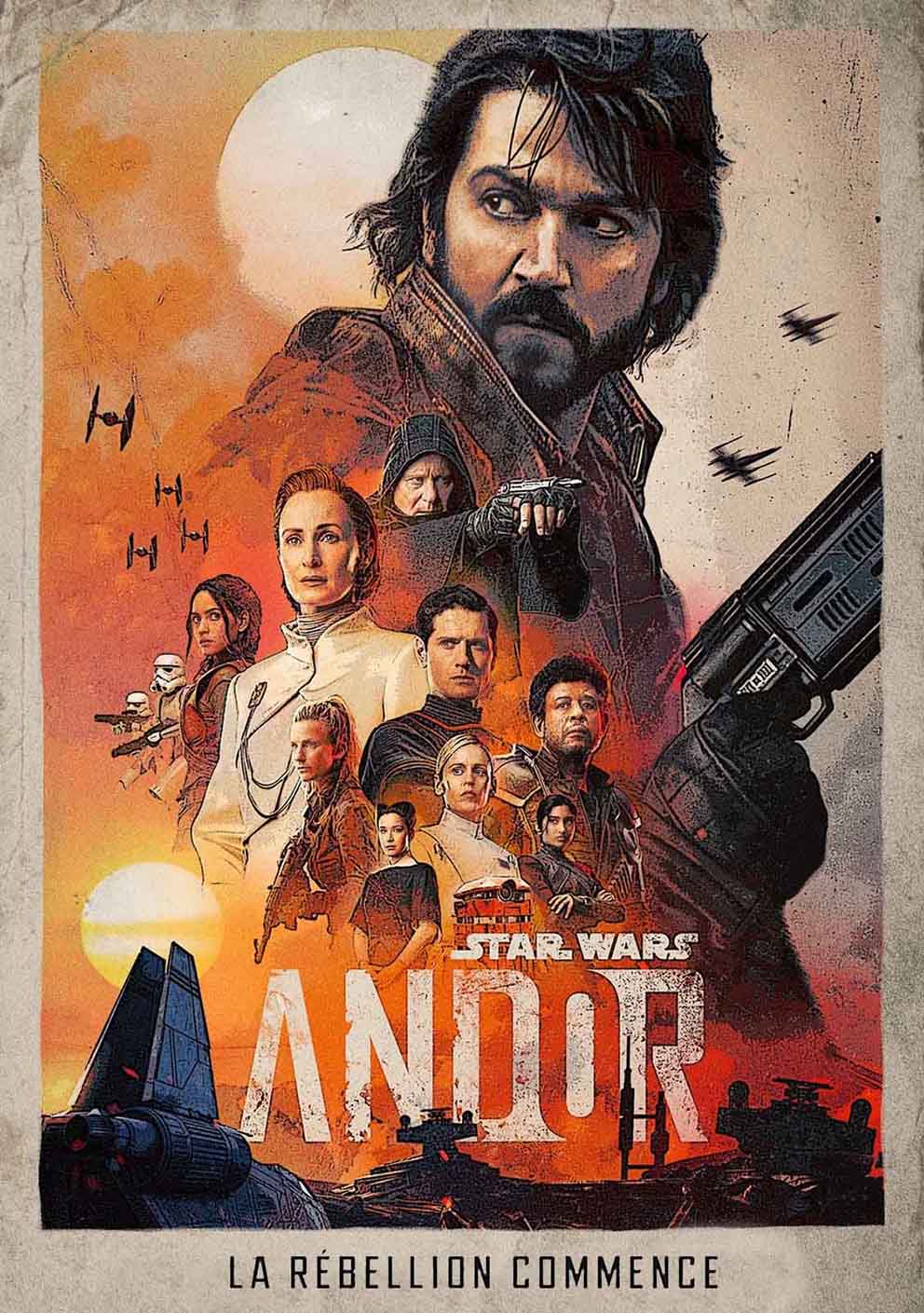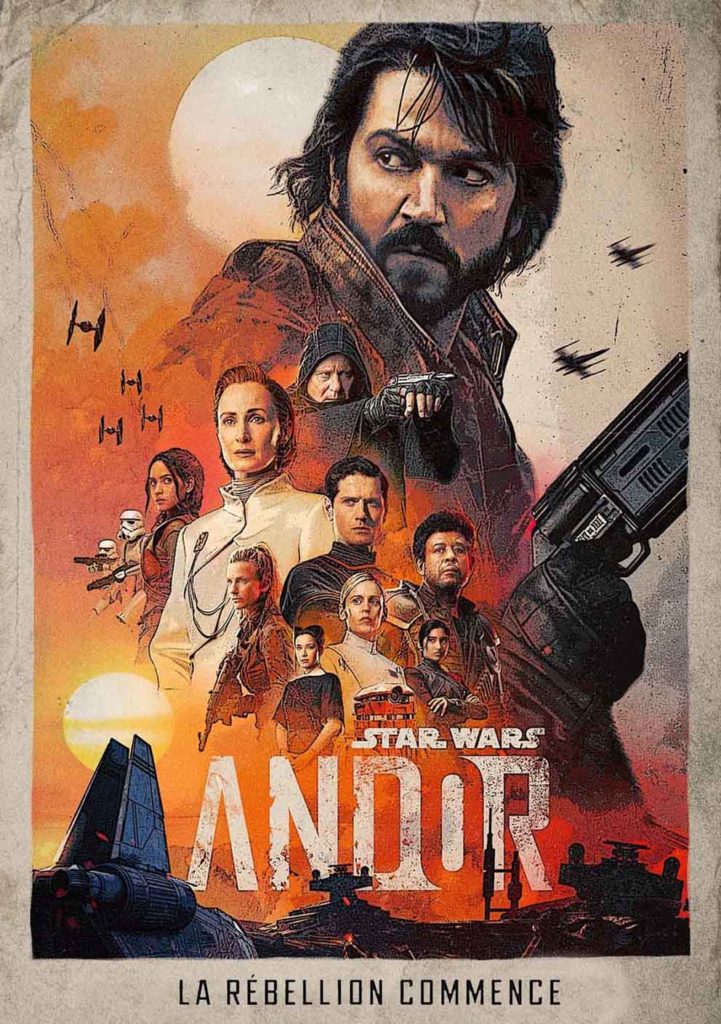Librement inspirée par un roman de Stephen King, cette série fantastico-policière plonge son héroïne dans un entrelacs de phénomènes paranormaux…
HAVEN
2010/2015 – USA
Créée par Sam Ernst et Jim Dunn
Avec Emily Rose, Lucas Bryant, Eric Balfour, Nicholas Campbell, Mary-Colin Chisholm, Michelle Monteith
THEMA POUVOIRS PARANORMAUX I SAGA STEPHEN KING
Suite au succès de la série Dead Zone, la même équipe se lance dans Les Mystères de Haven, adaptation du court roman « Colorado Kid » de Stephen King. Publié en 2005, le livre est lui-même librement inspiré des exactions d’un véritable tueur australien dans les années 40. Ce texte étant difficilement adaptable tel quel, les scénaristes s’en éloignent considérablement pour imaginer 78 épisodes n’ayant pas grand-chose à voir avec Stephen King, malgré de nombreuses références à son œuvre tout au long des cinq saisons de la série. Les villes imaginaires de Castle Rock et Derry, par exemple, y sont régulièrement citées. Sans compter les clins d’œil répétés à « Ça », « Shawshank Redemption », « Le Fléau », « La Tour sombre », « Christine », Maximum Overdrive et « Misery ». Engagés pour écrire le pilote puis pour développer l’ensemble de la série, les scénaristes Sam Ernst et Jim Dunn envisagent d’abord un show policier teinté de suspense et d’épouvante mais dénué de tout élément fantastique. « Où sont les éléments surnaturels ? » s’empresse alors de réagir Stephen King, les poussant de fait à revoir leur copie.


L’héroïne du show, Audrey Parker (Emily Rose), agent du FBI, traque un fugitif dans la petite ville de Haven, au cœur du Maine, dont la rue principale parait échappée d’un western et où l’activité principale semble être la pêche. Elle y rencontre un policier local, Nathan Wuornos (Lucas Bryant), qui la sauve dès son arrivée dans Haven, une fissure créée soudainement dans le sol précipitant sa voiture au bord d’une falaise. Wuornos a une particularité physique pour le moins inhabituelle : il ne ressent pas la douleur. Sur place, Audrey trouve le cadavre du fugitif qu’elle poursuivait, mort dans des conditions inexpliquées, ainsi qu’un duo de vénérables journalistes du Haven Herald, rescapés du roman de Stephen King. Elle apprend alors qu’elle est personnellement reliée aux secrets enfouis dans les tréfonds de cette ville côtière. Au bout d’un moment, elle finira même par quitter le FBI pour rejoindre la police locale et réaliser que son arrivée à Haven a peut-être été organisée à l’avance. Et si son nom et ses souvenirs ne lui appartenaient pas ?
Catastrophes (sur)naturelles
Dès le premier épisode, les extravagances saturent les lieux. Des aberrations météorologiques (un brouillard extrêmement épais qui surgit de nulle part puis disparaît aussi sec, une soudaine pluie de grêle, une chute de neige furtive) semblent être liées à une femme dont les émotions provoquent des intempéries. Ce n’est que le prélude d’une foule de phénomènes paranormaux qui frappent Haven d’épisode en épisode, comme ce fut visiblement le cas autrefois, longtemps avant l’arrivée d’Audrey dans la ville. « Quand on a tout écarté, il faut accepter ce qui reste » affirme-t-elle, comme si elle mixait à elle seule les personnalités de Fox Mulder et Dana Scully. De fait, X-Files semble être l’une des sources d’inspiration majeures des Mystères de Haven, tout comme Twin Peaks, les séries de Chris Carter et David Lynch figurant parmi les shows télévisés préférés de Stephen King depuis la fin des années 80. Mais la spontanéité n’est pas vraiment de mise et l’humour lié au tempérament désinvolte d’Audrey Parker et à ses répliques cinglantes semble un peu forcé. La série est tout de même un succès, puisqu’elle est diffusée pendant cinq années consécutives sur la chaine SyFy aux États-Unis et sur Showcase au Canada. On note un thème musical envoûtant de Shawn Pierce qui n’est pas sans évoquer celui de Candyman composé par Philip Glass.
© Gilles Penso
Partagez cet article