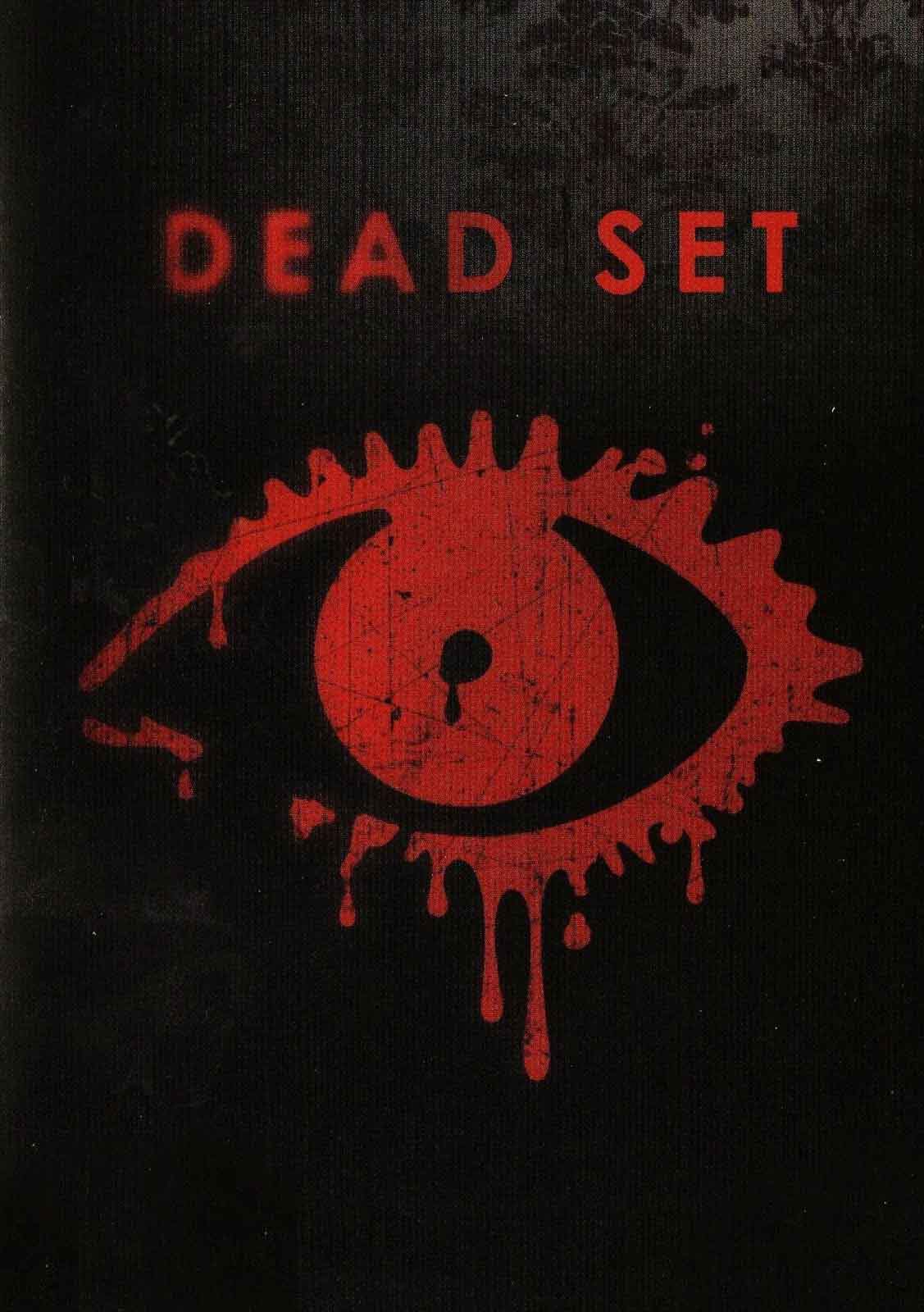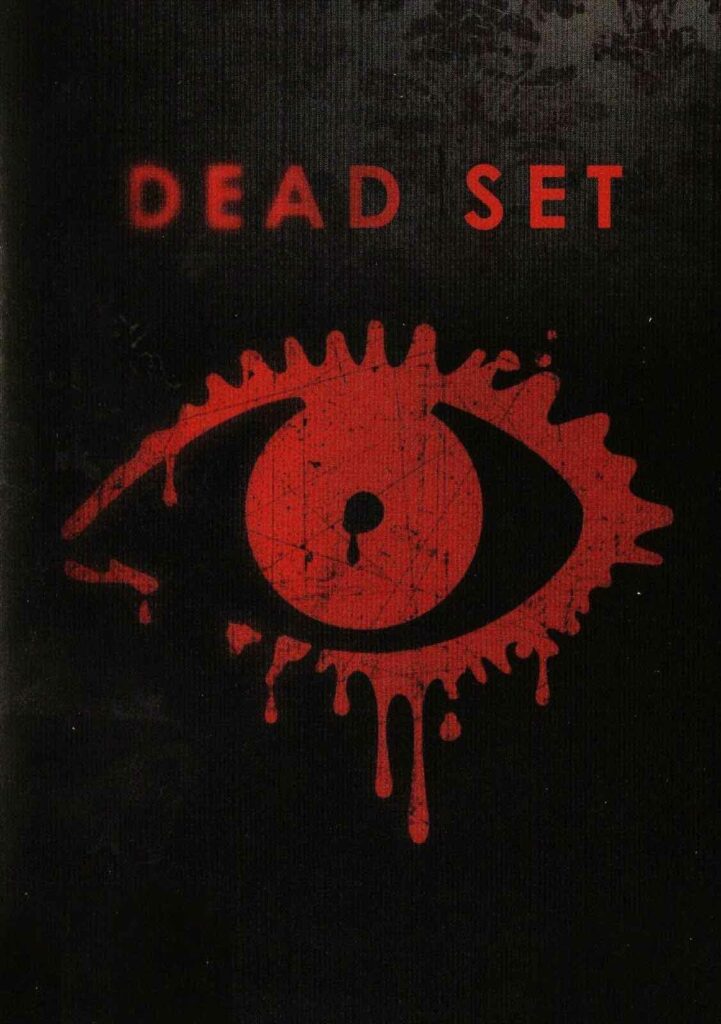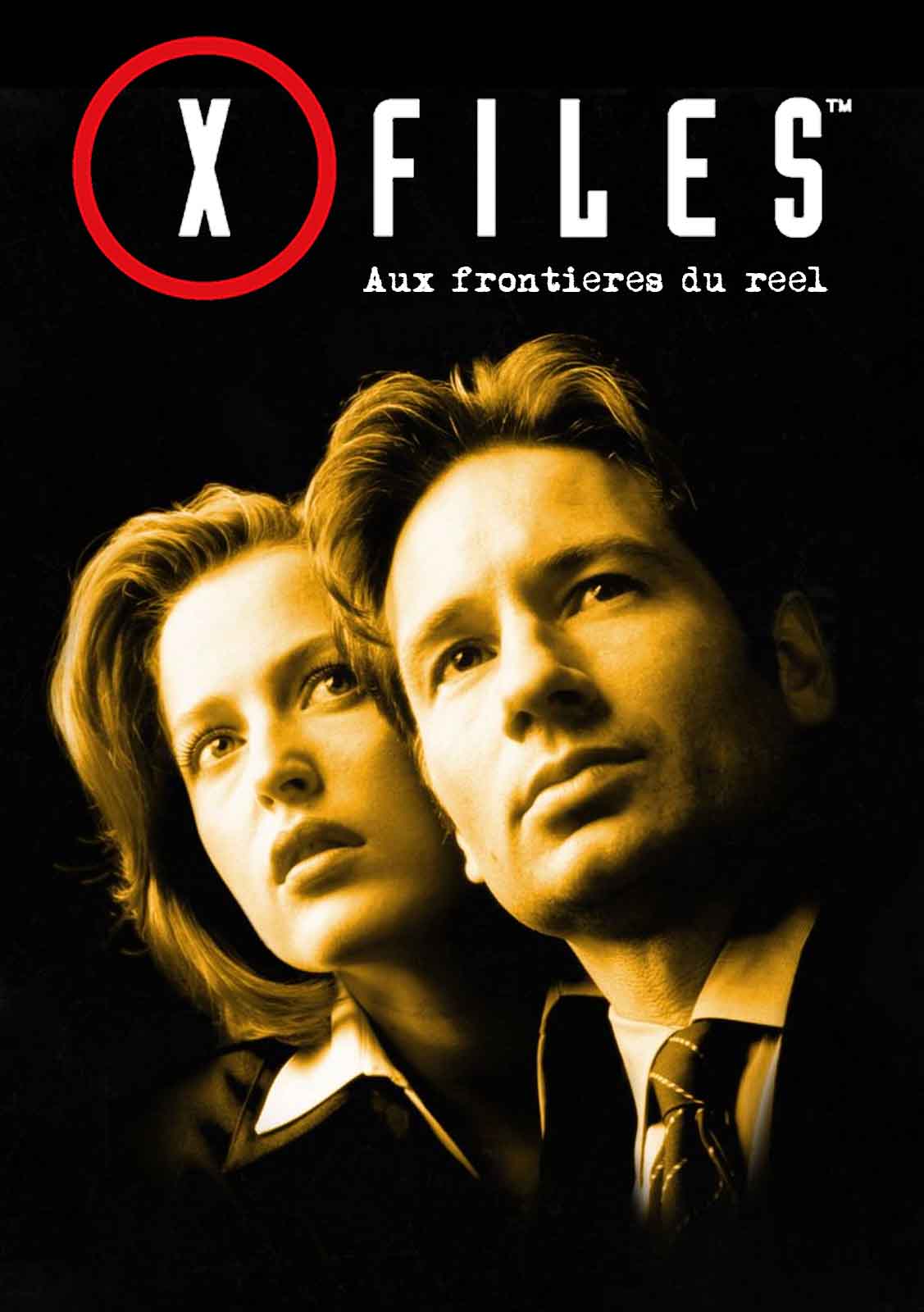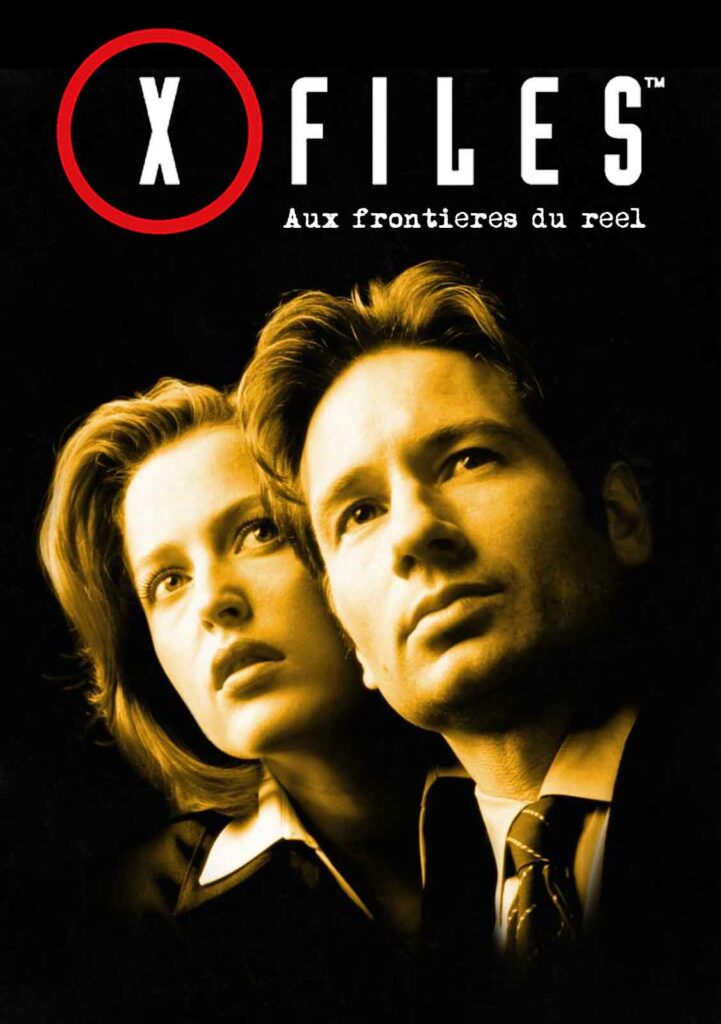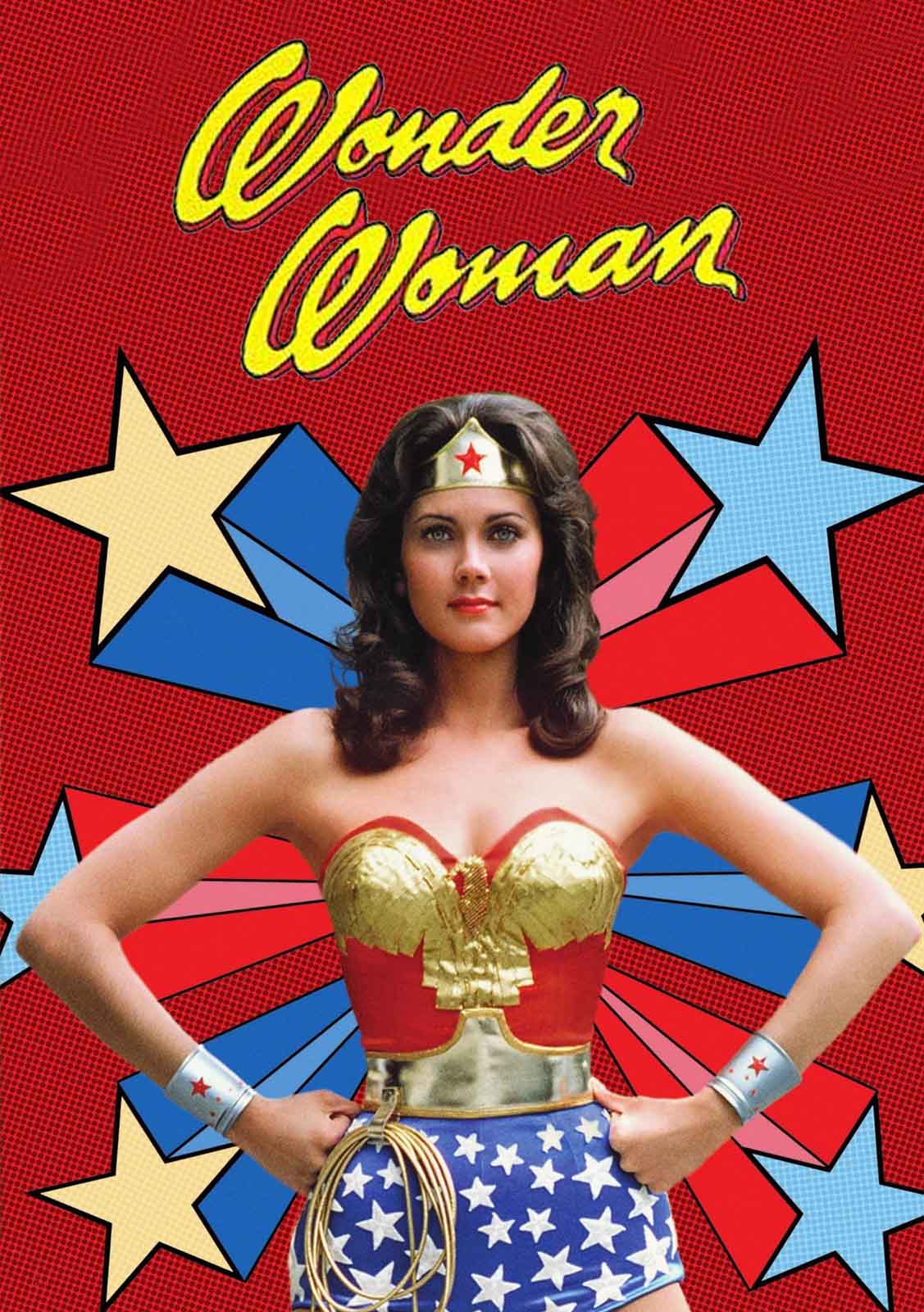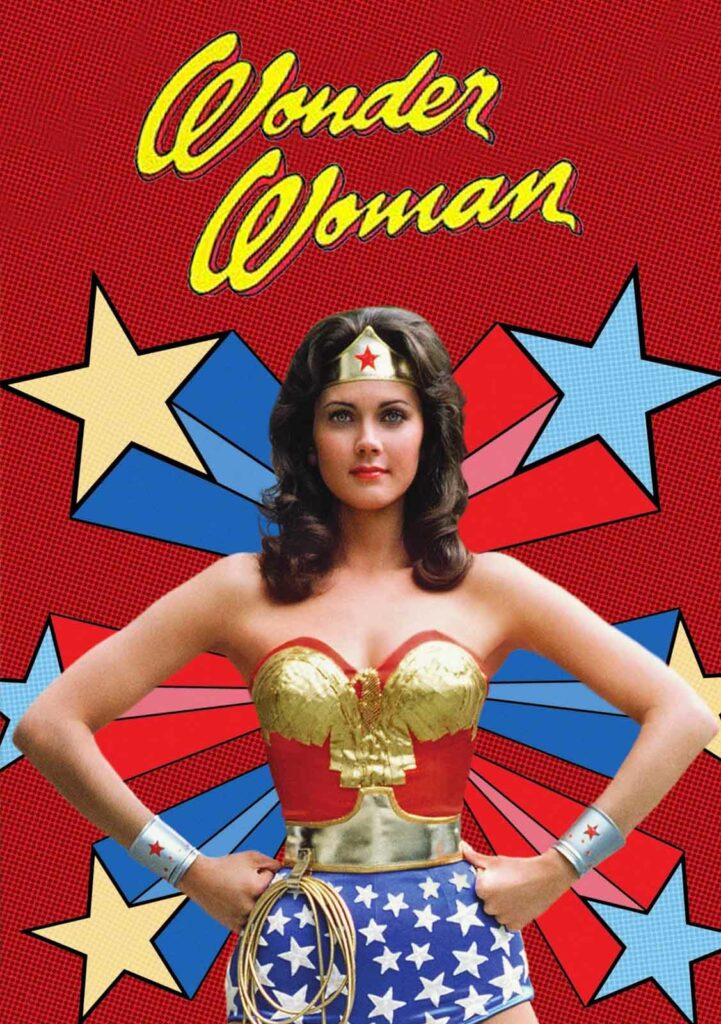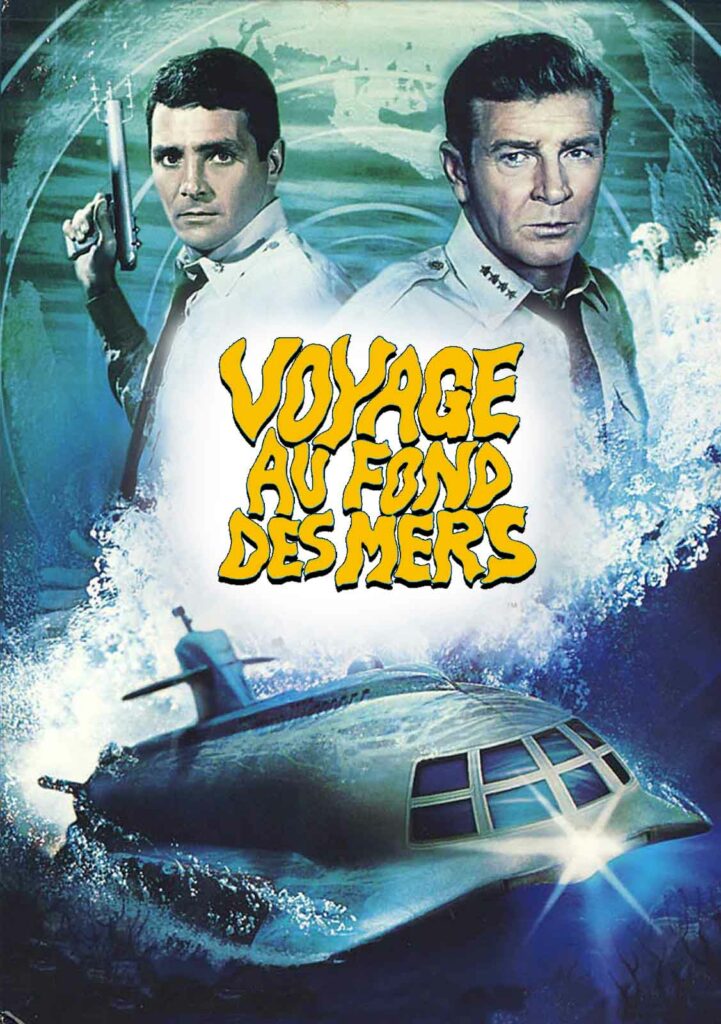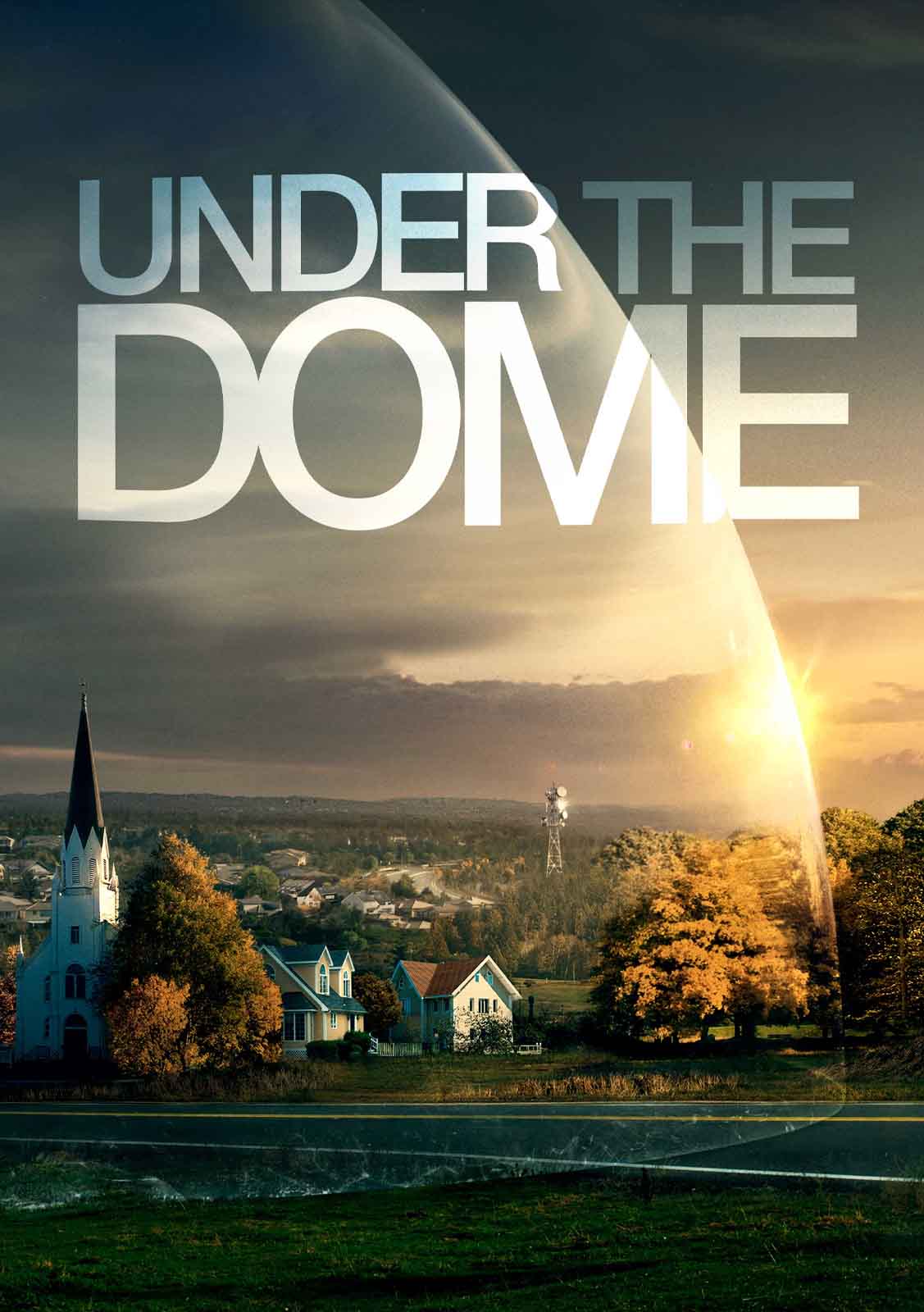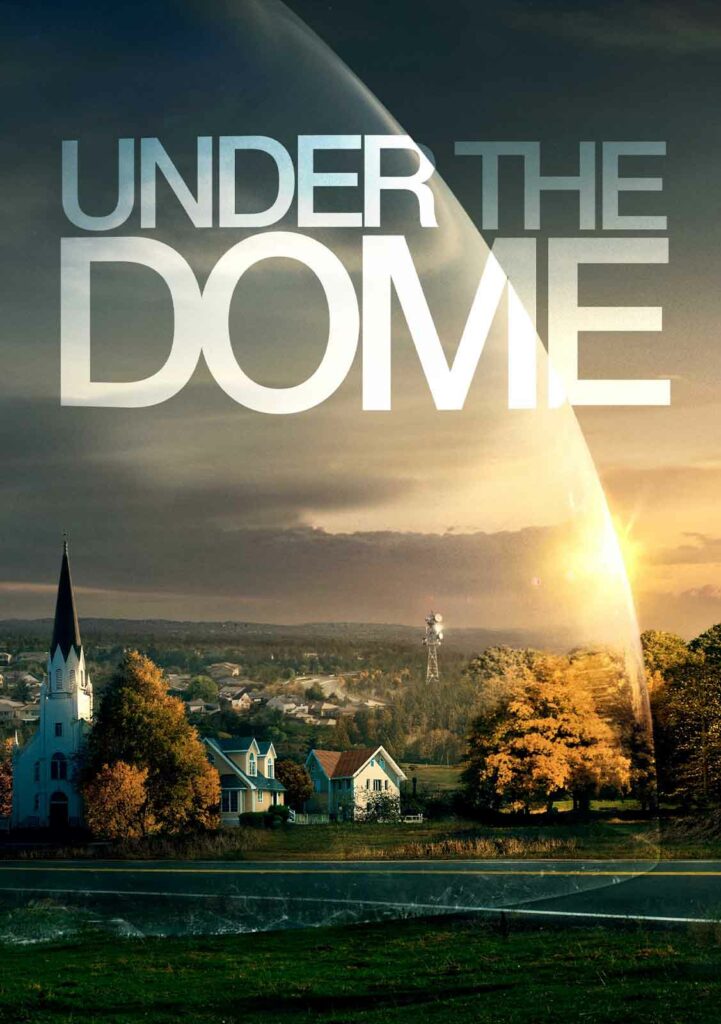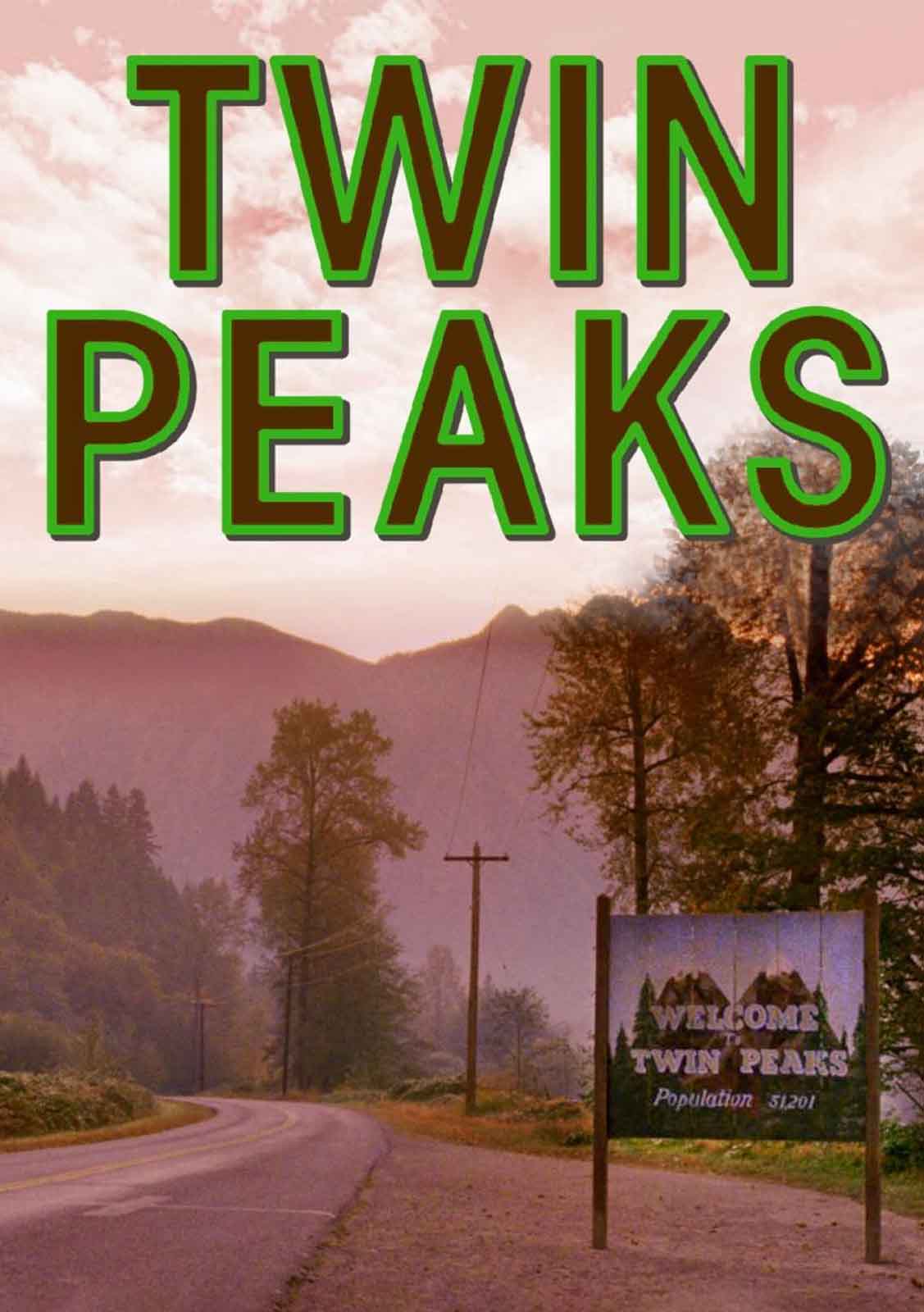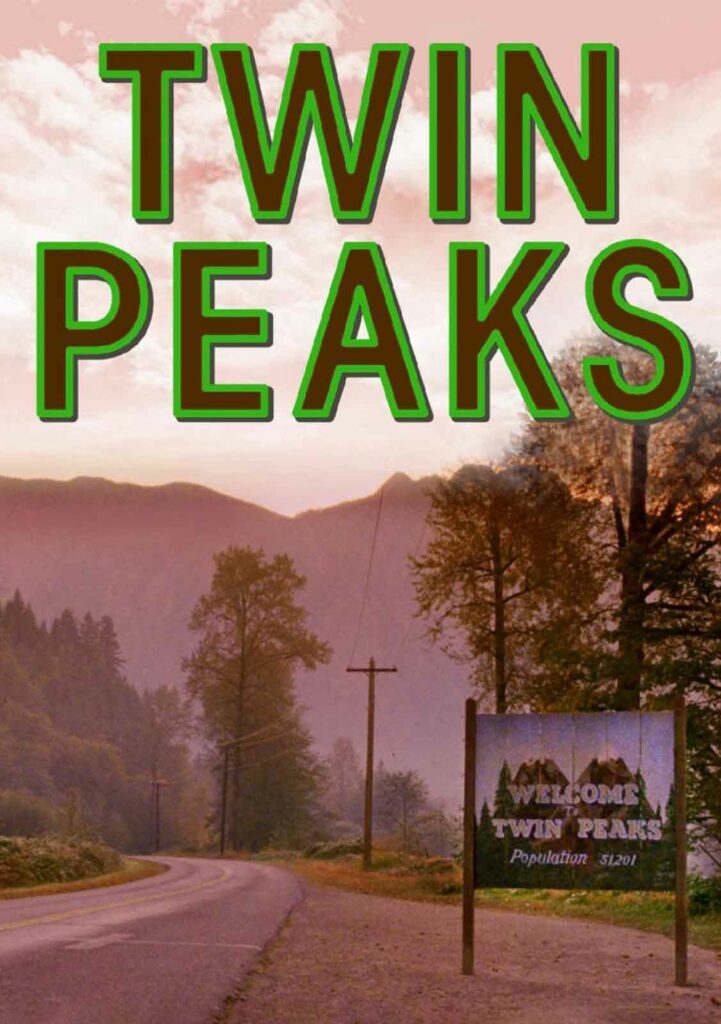Le roman classique de H.G. Wells se voit offrir une adaptation soignée qui – une fois n’est pas coutume – respecte son cadre historique original…
THE WAR OF THE WORLDS
2019 – USA
Réalisé par Craig Viveiros
Avec Eleanor Tomlinson, Rafe Spall, Rupert Graves, Robert Carlyle, Woody Norman, Jonathan Aris, Nicholas Le Prevost, Susan Wooldridge
THEMA EXTRA-TERRESTRES
Production britannique conçue pour la chaîne BBC, La Guerre des mondes est une des nombreuses adaptations du roman éponyme de H.G. Wells, indiscutable précurseur de la science-fiction contemporaine. Il s’agit ici d’une mini-série créée et écrite par Peter Harness (connu principalement pour avoir écrit des épisodes de séries comme Docteur Who, Jackson Brodie détective privé et McMafia) qui s’inspire beaucoup plus de l’œuvre originale que d’autres versions, cherchant même à en retrouver le contexte historique. L’intrigue se situe donc dans l’Angleterre de 1905, à l’époque du roi Édouard VII. George, journaliste londonien, a quitté sa femme et tente de commencer une nouvelle vie commune avec Amy. Mais son tranquille quotidien est interrompu par l’apparition de plusieurs météorites qui s’écrasent à proximité du village d’Orcel. Accompagnés de leur voisin expert en astronomie, George et Amy se rendent sur le site de l’impact, bientôt suivis par les forces de l’ordre. Or les météorites sont en réalité des sphères extraterrestres venant de Mars. Bientôt, des tripodes géants sortent de terre en détruisant tout sur leur passage, tuant les humains et crachant une fumée noire dévastatrice. L’invasion martienne a commencé…


Contrairement à ce que les téléspectateurs pourraient imaginer, cette Guerre des mondes n’offre pas un florilège de scènes d’action et de rebondissements à foison comme Hollywood sait si bien le faire (et comme ce fut le cas pour le long-métrage de Steven Spielberg). Cette version s’intéresse surtout aux protagonistes, à leurs réactions face aux évènements malheureux qui s’abattent sur la population et aux connotations philosophiques d’un tel cataclysme sur la société… Subdivisée en seulement trois épisodes d’une quarantaine de minutes, cette mini-série se frottait à un gros challenge : celui de faire naître notre intérêt pour chaque personnage en si peu de temps. Il n’était pas simple de les rendre rapidement attachants pour nous confronter à leurs sentiments, leurs émotions et leurs destinées… Eh bien, challenge réussi ! La définition des personnages est suffisamment fouillée pour que chacun se soucie rapidement de leurs mésaventures. Revers de la médaille : ce travail de caractérisation se fait parfois au détriment de l’action qui peine souvent à pointer le bout de son nez. C’est un choix délibéré de la part du réalisateur/scénariste Craig Viveiros qui plaira ou non aux spectateurs.
Mars attaque !
La qualité d’écriture des personnages s’accompagne d’une belle brochette de guest-stars comme comme Eleanor Tomlinson (The Nevers), Rafe Spall (Jurassic World : Fallen Kingdom), Rupert Graves (V pour Vendetta), Nicholas Le Prevost (Affaires non classées), Harry Melling (Harry Potter et l’Ordre du Phénix), Jonathan Aris (Churchill) ou encore Robert Carlyle (28 semaines plus tard). Tous défendent avec talent les êtres qu’ils incarnent, pauvres humains soumis à une menace extra-terrestre qui semble invincible. Carlyle est bien sûr excellent, comme toujours, mais aucune des autres prestations ne démérite. Et même si la mise en scène reste volontairement à échelle humaine, la qualité des effets visuels reste excellente et quelques passages très impressionnants parsèment ces trois épisodes. Bref, malgré un format court et quelques faiblesses scénaristiques, La Guerre des mondes est une mini-série passionnante qui rend un bel hommage à l’œuvre de H.G. Wells. Par un étrange hasard des calendriers, une autre série titrée La Guerre des mondes est sorti quasi-simultanément sur les petits écrans, une co-production franco-américano-anglaise créée par Howard Overman.
© Grégory
Partagez cet article