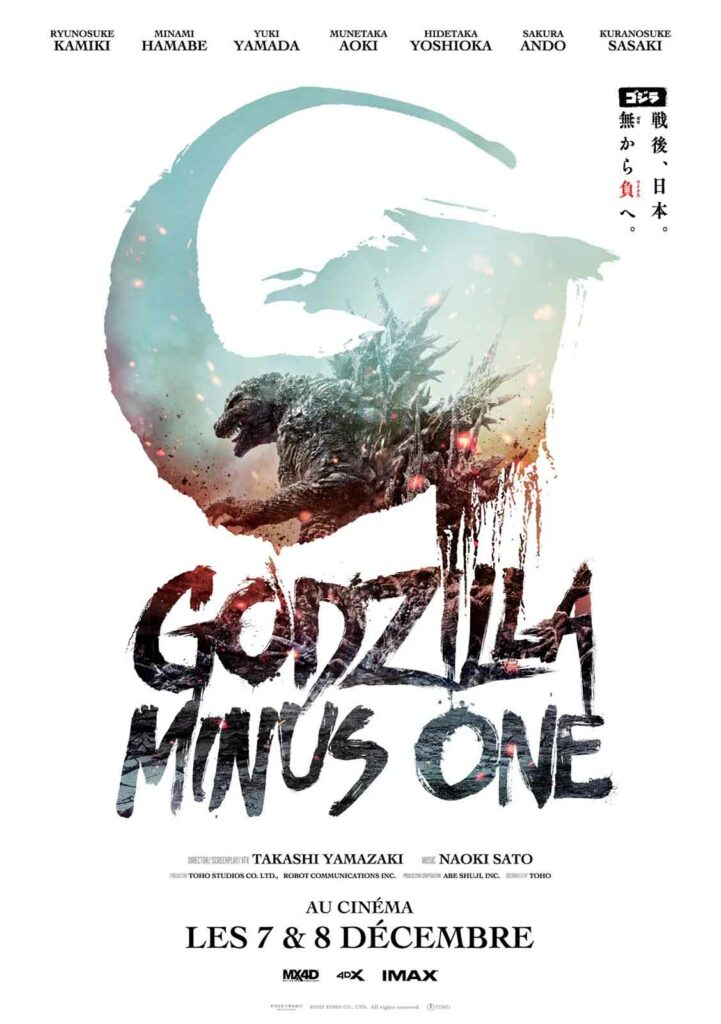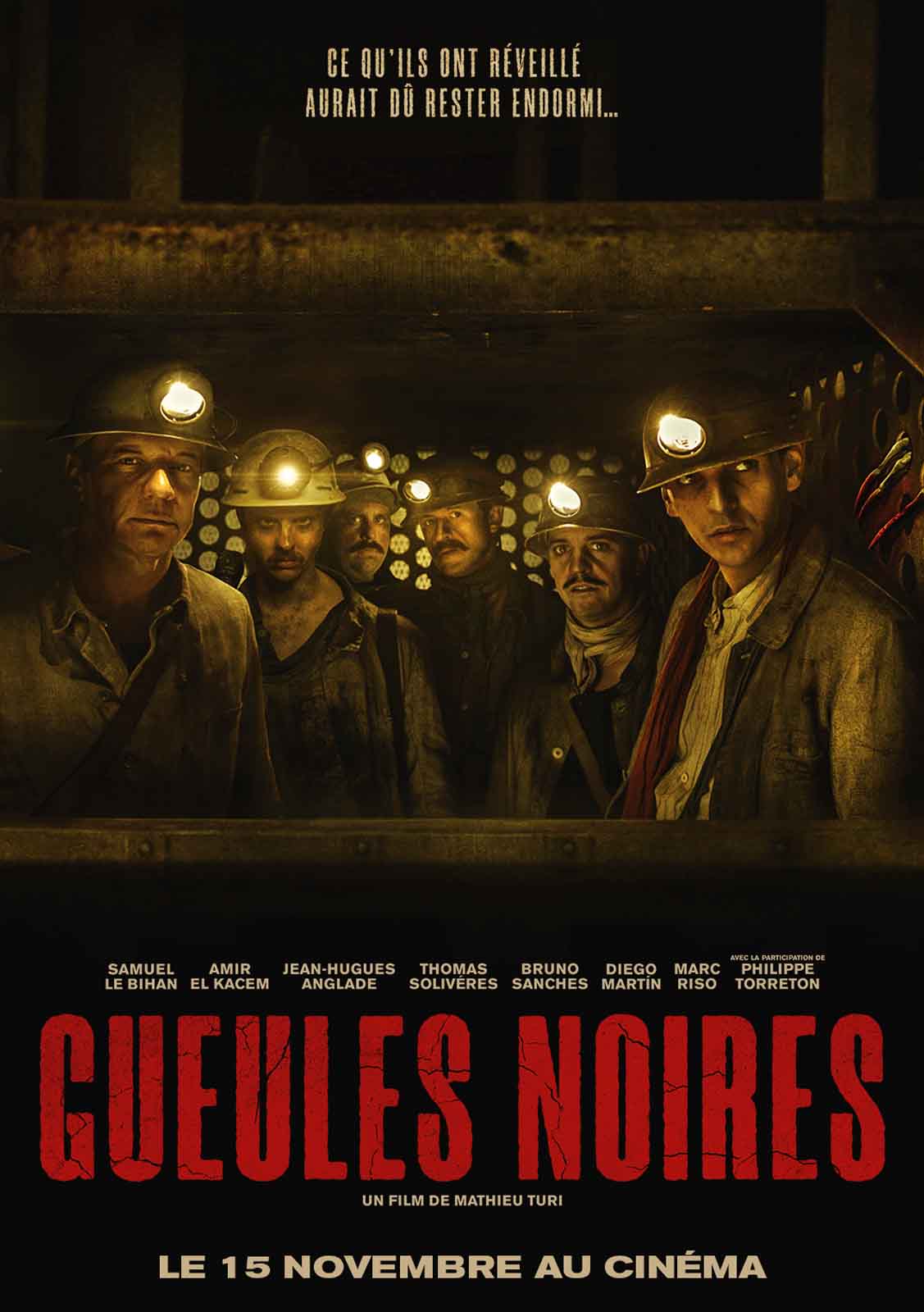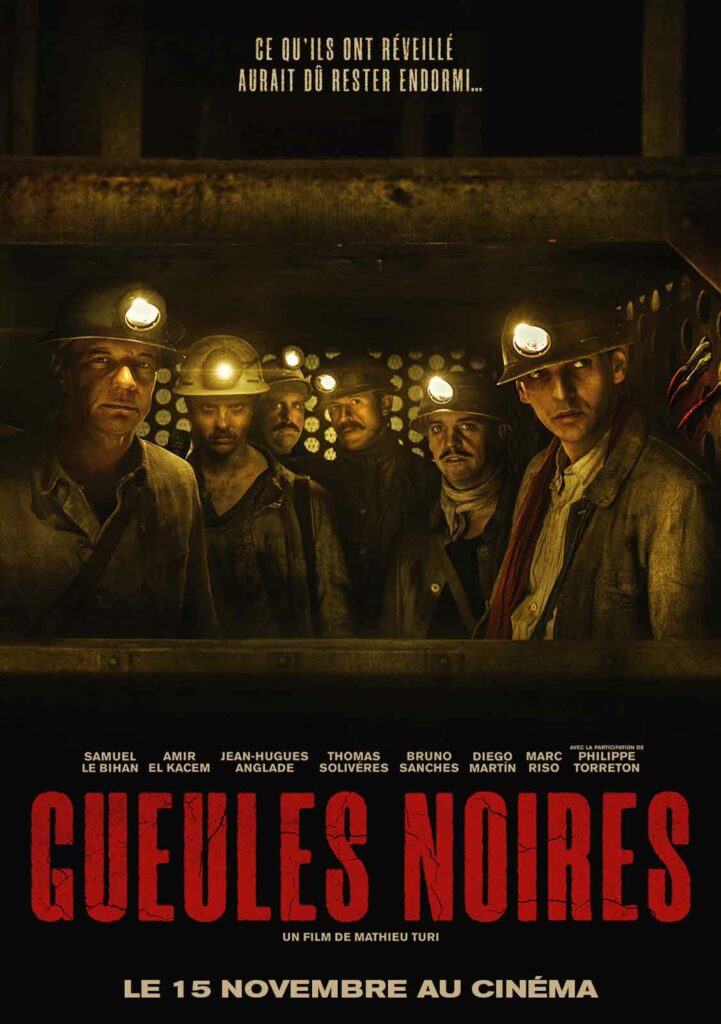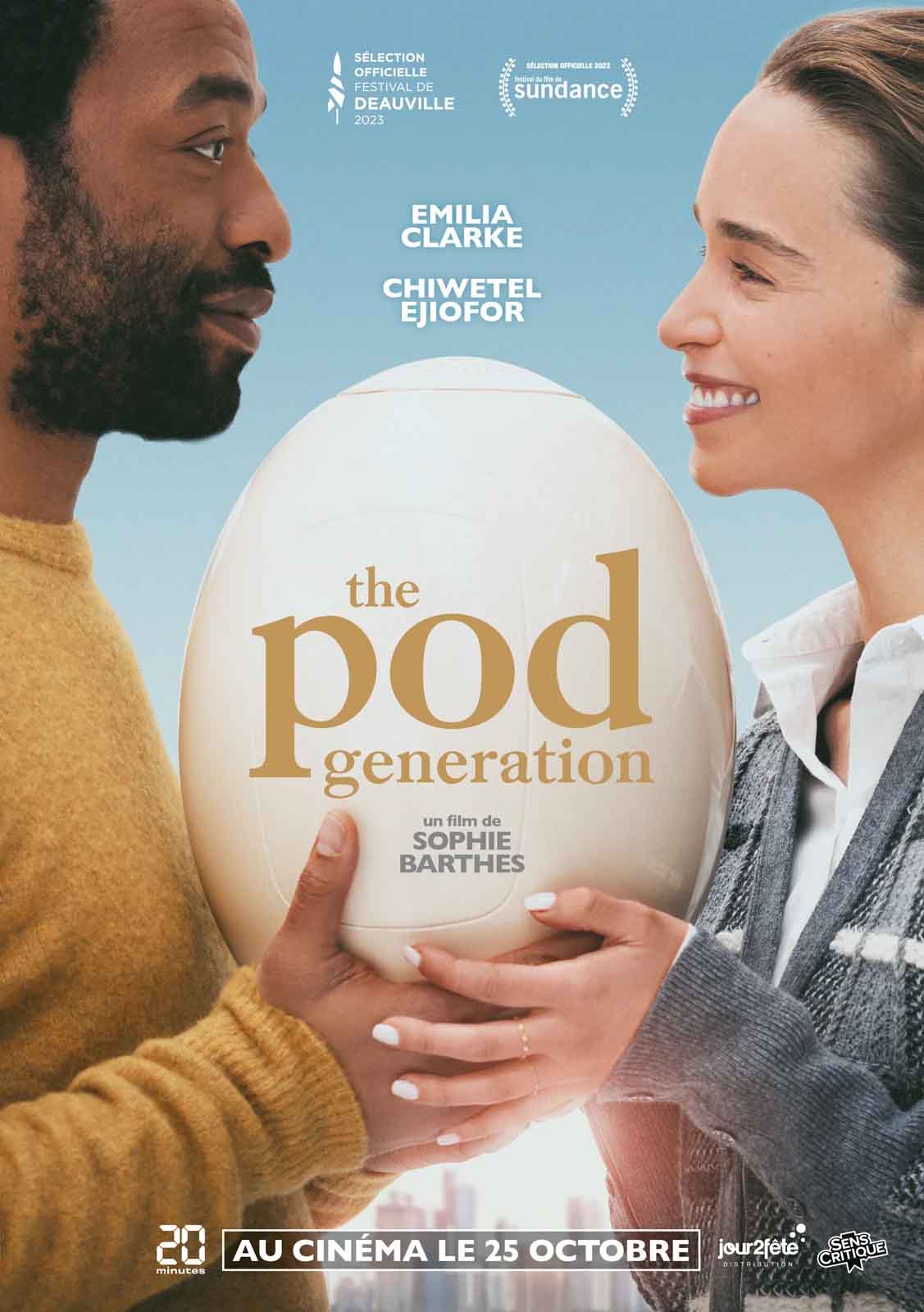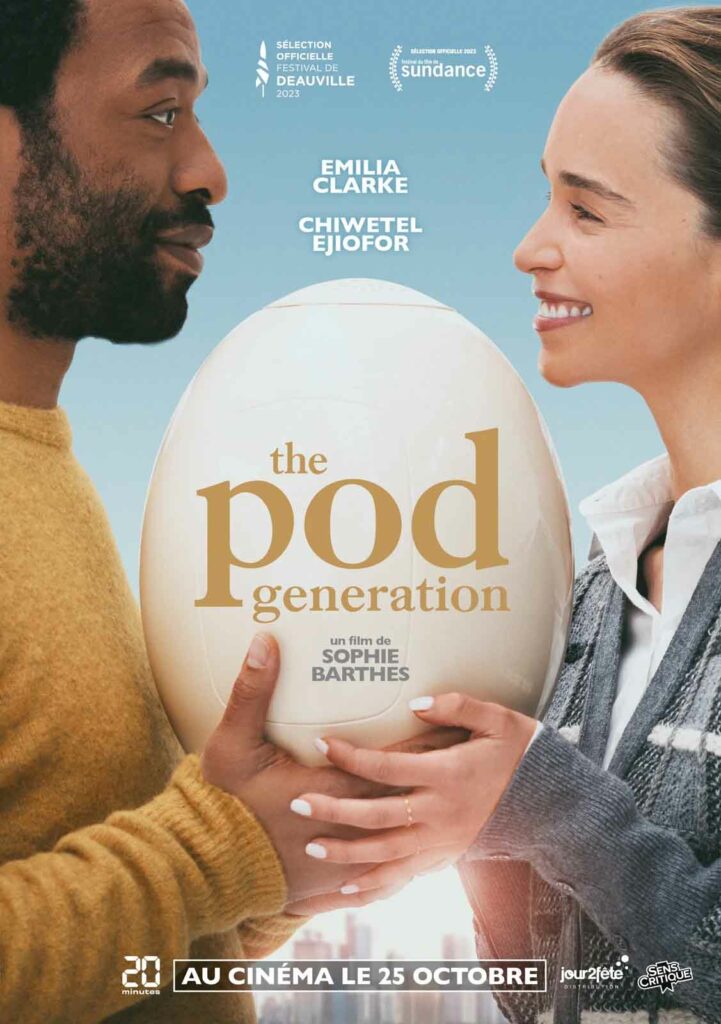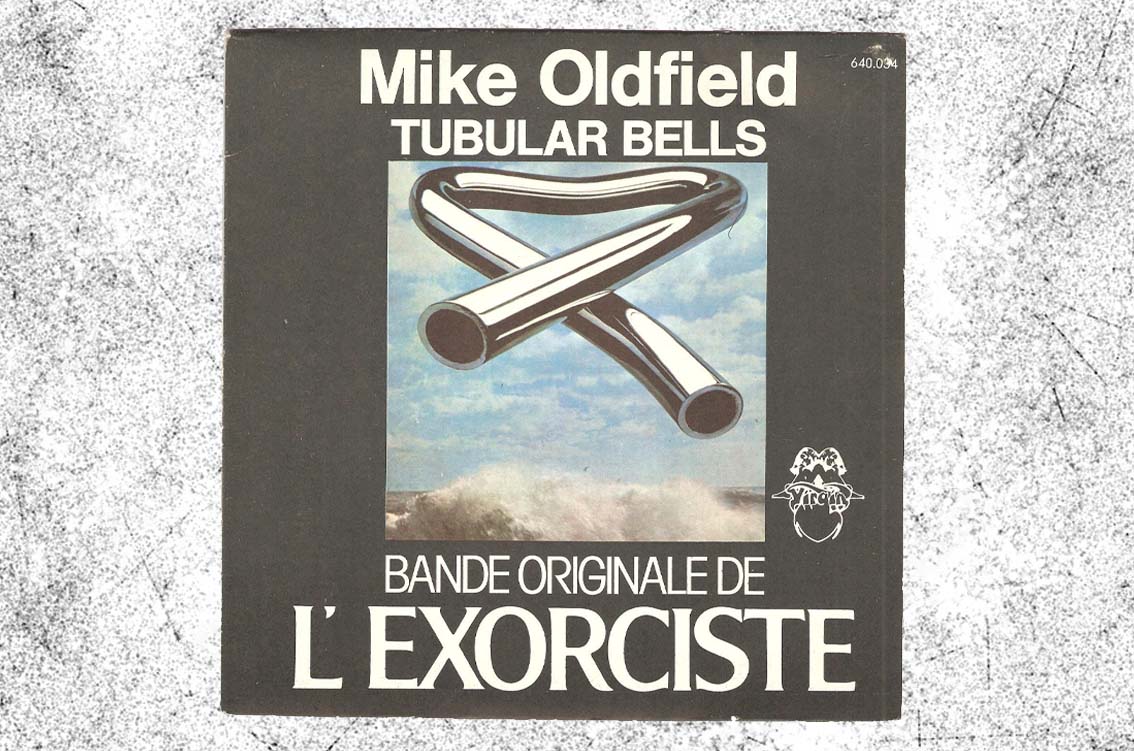Éric Judor et Ragnar le Breton inversent leurs corps dans cette comédie aux gros sabots qui détourne les codes des contes de Noël…
UN STUPÉFIANT NOËL
2023 – FRANCE
Réalisé par Arthur Sanigou
Avec Eric Judor, Matthias Quiviger, Lison Daniel, Alex Lutz, Paul Deby, Jonas Dinal, Kim Higelin, Théodore Le Blanc, Catherine Hosmalin, François Vincentelli
THEMA CONTES
Réalisateur de sketches pour l’émission « Clique » et d’un téléfilm parodique pour Canal + (La Vengeance au triple galop), Arthur Sanigou se lance avec Un stupéfiant Noël dans une comédie déjantée conçue pour égayer les programmes de fin d’année sur la plateforme d’Amazon Prime. Le concept ? Faire partager le haut de l’affiche à un acteur comique populaire (Éric Judor) et à un humoriste/sportif apprenti-comédien (Matthias Quiviger plus connu sous son sobriquet de « Ragnar le Breton ») pour les plonger au cœur d’une aventure fantastique s’appuyant sur un concept saugrenu. Quiviger incarne Greg, un policier spécialisé dans les opérations musclées qui sacrifie sans cesse sa vie de famille à cause de son métier. Ce Noël encore, il va devoir laisser tomber sa petite fille pour une opération d’infiltration dans un gang de trafiquants de drogue. Facétieux, le Père Noël (Guy Lecluyse) décide alors d’intervenir en exauçant le vœu de la fillette : faire ressembler son père à Richard Silestone (Éric Judor), héros d’une série télévisée américaine sirupeuse et bourrée de clichés. Soudain, les deux personnages échangent leurs corps et se retrouvent chacun plongé dans l’univers de l’autre. Leur seul moyen d’entrer en contact est une montre talkie-walkie qui émet le même bruit que les communicateurs de Star Trek…


L’effet comique principalement recherché dans ce Stupéfiant Noël est donc le décalage. Son principe même veut que deux protagonistes aux antipodes (le flic brutal dur à cuire et le père de famille gentiment niais) inversent leur rôle et vivent chacun la vie de l’autre. Par conséquent, les situations de « poisson hors de l’eau » s’accumulent abondamment : Judor qui prépare de la drogue en croyant être sollicité pour ses talents de pâtissier, Quiviger qui prend des cours de patinage artistique… Voilà pour le moteur principal du film. À l’unisson, les « vedettes invitées » jouent elles aussi ce jeu permanent du décalage, notamment Monsieur Poulpe en « gros bras » aussi maladroit que Pierre Richard, Alex Lutz en vieux milliardaire américain, Bruno Sanches en ancien militaire passablement dérangé ou Philippe Lacheau en assistant gaffeur du Père Noël.
Vis ma vie
Pour fonctionner pleinement, il aurait déjà fallu que le film puisse s’appuyer sur des performances d’acteur solides. Or si Éric Judor sait nous dérider avec son look improbable (moustache, grosse mèche et bronzage excessif) et son jeu puéril devenu une véritable marque de fabrique, Matthias Quiviger a bien du mal à faire exister son personnage. Car il ne suffit pas d’être un humoriste des réseaux sociaux spécialisé dans les paires de baffes pour être un comédien digne de ce nom. La mise en scène elle-même ne fait pas beaucoup d’éclats, jouant la carte prudente du fonctionnel, sauf peut-être au moment du climax qui, par la grâce d’un montage très habile, alterne une bataille mouvementée contre les trafiquants et une chorégraphie sur glace endiablée aux accents d’un morceau de hard rock. Le problème majeur du film reste son scénario pataud qui ne sait que faire de son postulat absurde et laisse donc traîner en longueur chaque scène supposément comique dans l’espoir d’atteindre le plus vite possible les 90 minutes réglementaires. Les dialogues sont médiocres, la caricature est le mot d’ordre général, bref, voilà clairement une fausse bonne idée qui aurait sans doute pu donner lieu à un sketch amusant mais certainement pas un long-métrage digne de ce nom.
© Gilles Penso
Partagez cet article