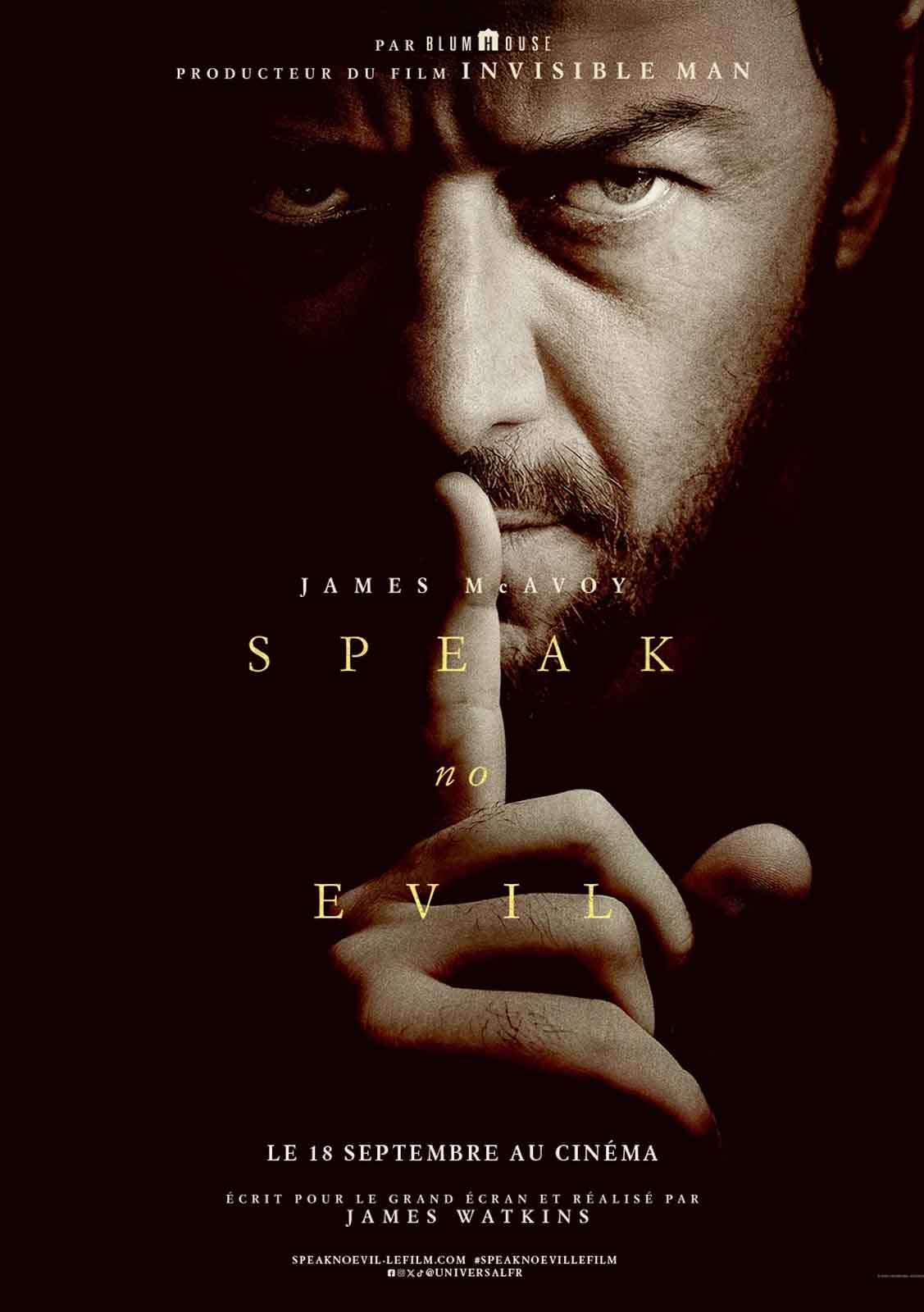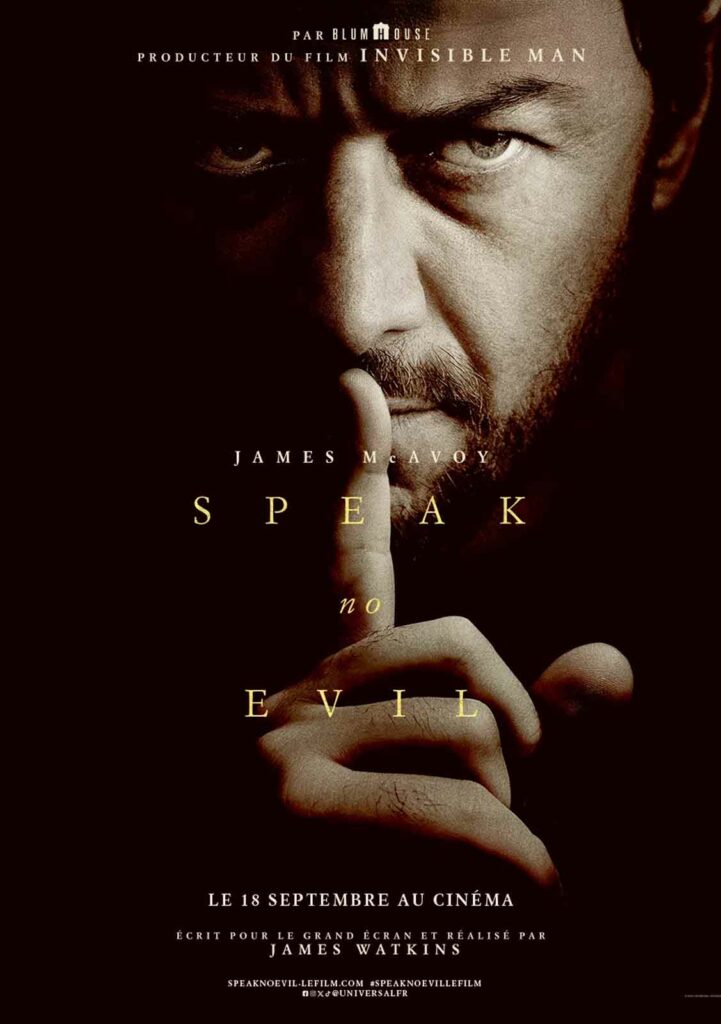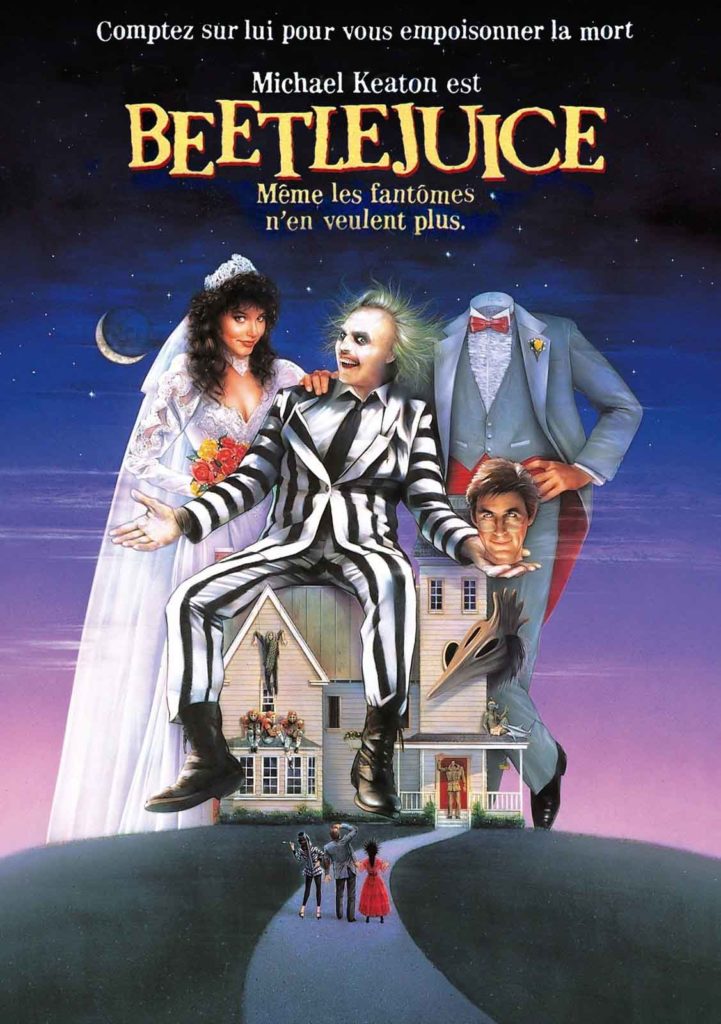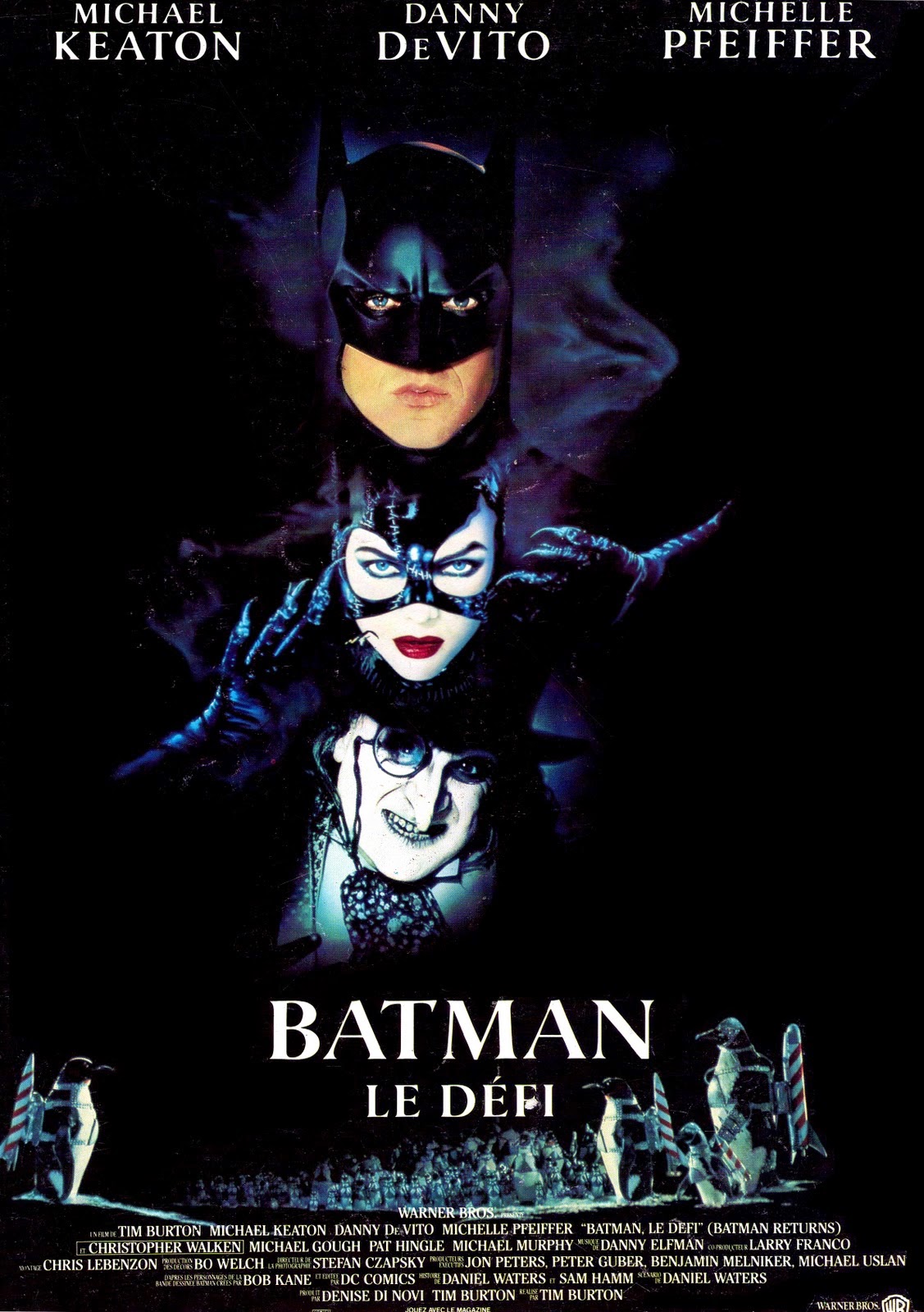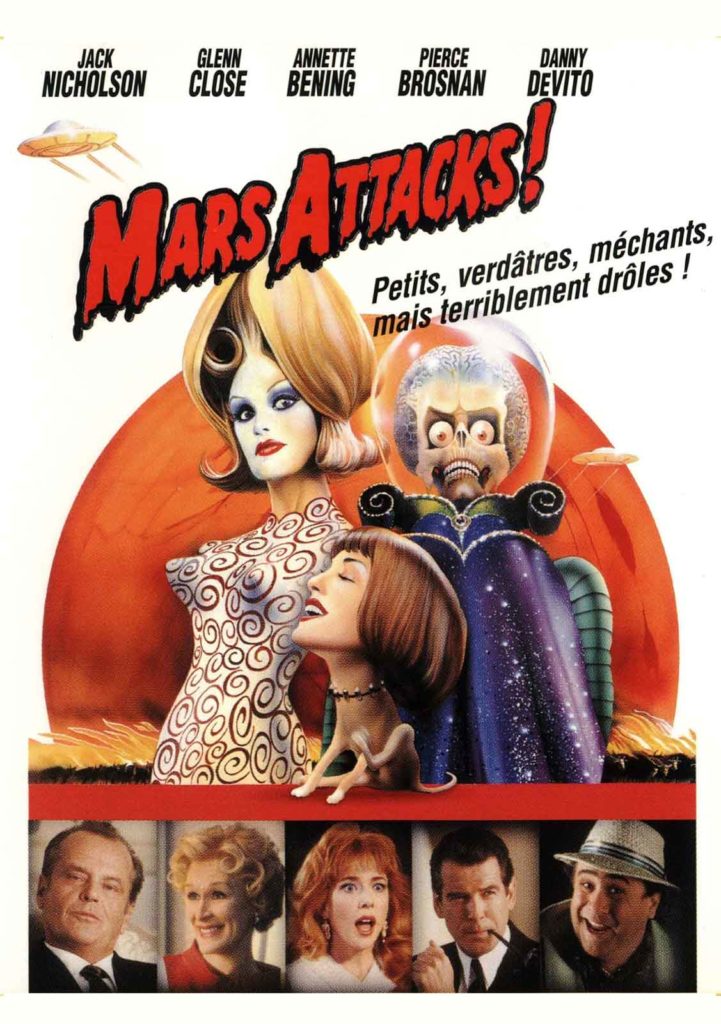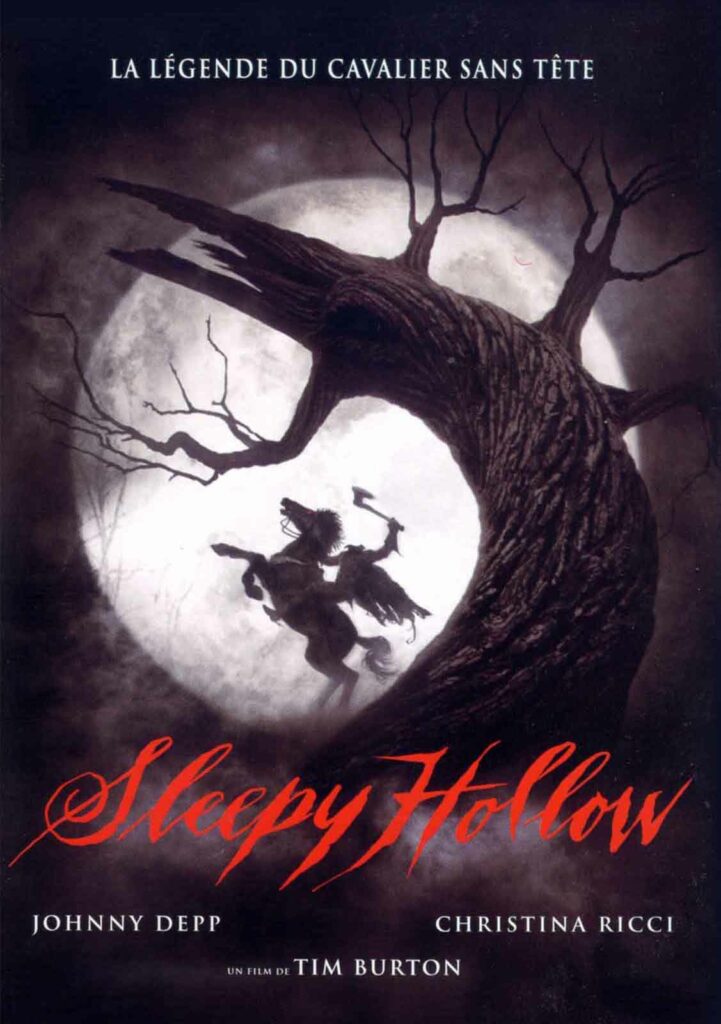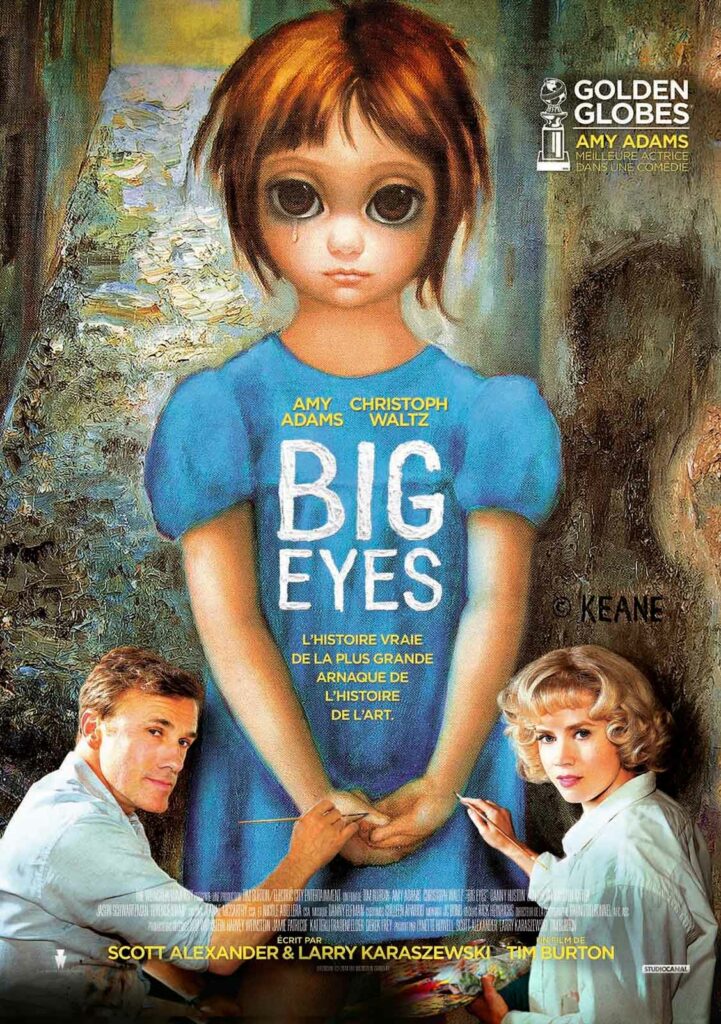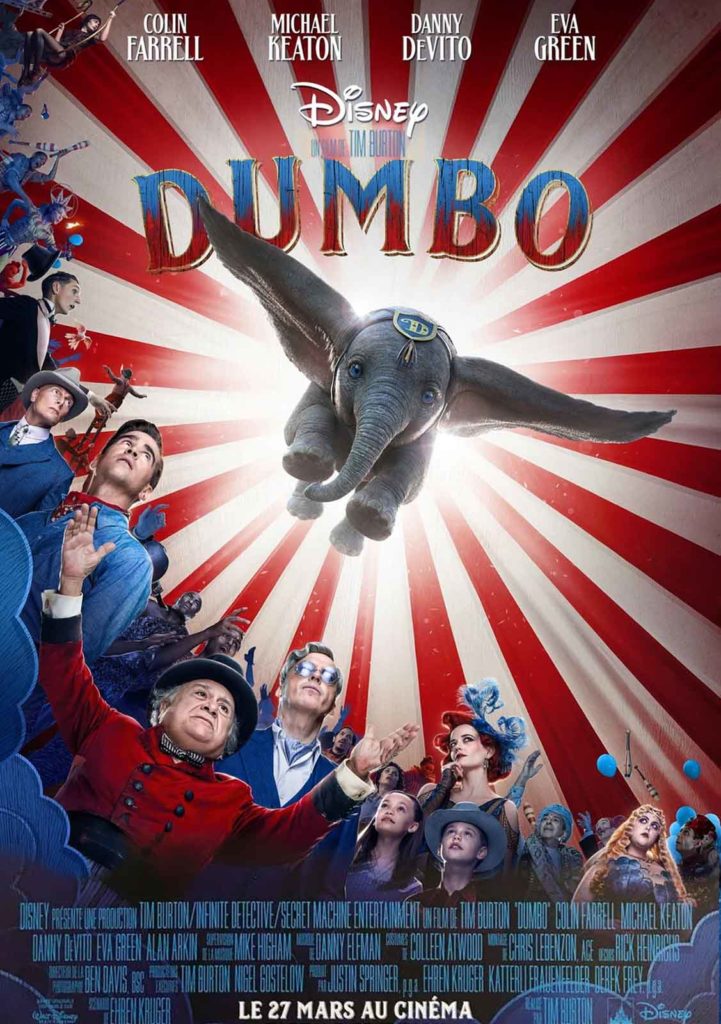Passé complètement inaperçu, ce quatrième Hellboy oublie la fantasy et les grands monstres au profit d’une ambiance de « folk horror » glauque…
HELLBOY : THE CROOKED MAN
2024 – USA
Réalisé par Brian Taylor
Avec Jack Kesy, Jefferson White, Leah McNamara, Adeline Rudolph, Joseph Marcell, Hannah Margetson, Martin Bassindale, Carola Colombo, Nathan Cooper
THEMA SORCELLERIE ET MAGIE I DIABLE ET DÉMONS I ZOMBIES I ARAIGNÉES I REPTILES ET VOLATILES I SAGA HELLBOY
Si le Hellboy de Neil Marshall n’a pas soulevé beaucoup d’enthousiasme, souffrant de la comparaison avec le diptyque très apprécié de Guillermo del Toro, ce quatrième opus – sorti à peine cinq ans après le précédent et jouant une fois de plus la carte du « reboot » – est quasiment passé sous les radars. Pourtant, c’est celui que Mike Mignola, auteur de la bande dessinée originale, apprécie le plus. Notre homme ne s’est jamais privé de clamer haut et fort sa déception face aux premiers longs-métrages trahissant selon lui sa création. Ici, il met la main à la pâte, participant personnellement au scénario qui s’appuie sur la série de comics « The Crooked Man » dessinée par Richard Corben. Co-réalisateur de Hyper Tension, Ultimate Game et Ghost Rider 2, Brian Taylor hérite de la mise en scène et affirme à son tour une volonté de rupture avec les autres adaptations. « Les films de Guillermo del Toro étaient des space operas à grande échelle », dit-il. « Mais certaines des bandes dessinées que Mike réalisait à l’époque étaient très différentes. Il s’agissait plutôt d’horreur folklorique et effrayante. Un Hellboy plus jeune, errant dans les coins sombres du monde. Pour moi, l’intérêt était de revenir à cet esprit et de proposer une version de Hellboy que, selon moi, nous n’avons pas encore vue. » (1) D’où un film sombre et violent, classé R (interdit aux mineurs non accompagnés d’un adulte), et produit pour un budget beaucoup plus restreint que celui de ses prédécesseurs.


Cet Hellboy là se déroule en 1959 et démarre dans un train lancé à vive allure. Agent débutant du BDRP (Bureau for Paranormal Research and Defense, autrement dit Bureau de recherche et de défense sur le paranormal), la parapsychologue Bobbie Jo Song (Adeline Rudolph) est chargée de livrer une araignée géante aux capacités surnaturelles qu’elle a fait enfermer dans une caisse. Cette mission ayant un caractère potentiellement très dangereux, elle est escortée par Hellboy (Jack Kesy). Or à mi-parcours, le monstre s’affole et s’échappe. En partant à sa recherche, Bobbie Jo et Hellboy se retrouvent au fin fond des Appalaches, dans une petite communauté rurale où sévissent de nombreuses sorcières dirigées par un démon local qui répond au doux nom de Crooked Man, « l’homme tordu » (Martin Bassindale). Bien décidé à défaire la forêt et ses habitants de ce monstre collecteur d’âmes tourmentées, Hellboy va se retrouver confronté à son propre passé…
Fanboy
Chapitré en trois parties (« La boule de sorcière », « L’os porte-bonheur » et « L’Ouragan »), le film se distingue clairement des trois autres par son approche frontalement horrifique. L’atmosphère est anxiogène, l’humour relégué à l’arrière-plan et l’intrigue prend vite la tournure d’un cauchemar. A l’avenant, Brian Taylor concocte une série de séquences bizarres et perturbantes, comme le corps d’une femme qui se regonfle à la manière d’un ballon de baudruche pour reprendre sa forme humaine, ce cheval qui se transforme en vieil homme agonisant, ce serpent géant qui sort de sous une jupe pour entrer dans une bouche ou encore la résurrection en série de tous les cadavres enterrés dans le sol d’une église. Face à tant de diableries, Hellboy conserve son flegme brutal tandis que sa partenaire joue les Dana Scully cartésiennes, même lorsque le paranormal lui saute au visage. On ne peut s’empêcher de saluer l’audace de tels partis pris. Jack Kesy fait le job, les maquillages sont réussis, l’esprit des comic books les plus sinistres de la série est respecté. Mais honnêtement, le résultat est loin d’être concluant. Ce film froid et pesant suscite beaucoup plus d’ennui que d’intérêt et donne presque l’impression de visionner un « fan movie » réalisé certes avec passion mais sans dramaturgie, sans finesse, sans vision de mise en scène. Le risque encouru par l’équipe de cet Hellboy n’aura d’ailleurs pas été payant, si l’on considère ses bien maigres retombées financières.
(1) Extraits d’une interview parue dans Collider en février 2023
© Gilles Penso
Partagez cet article