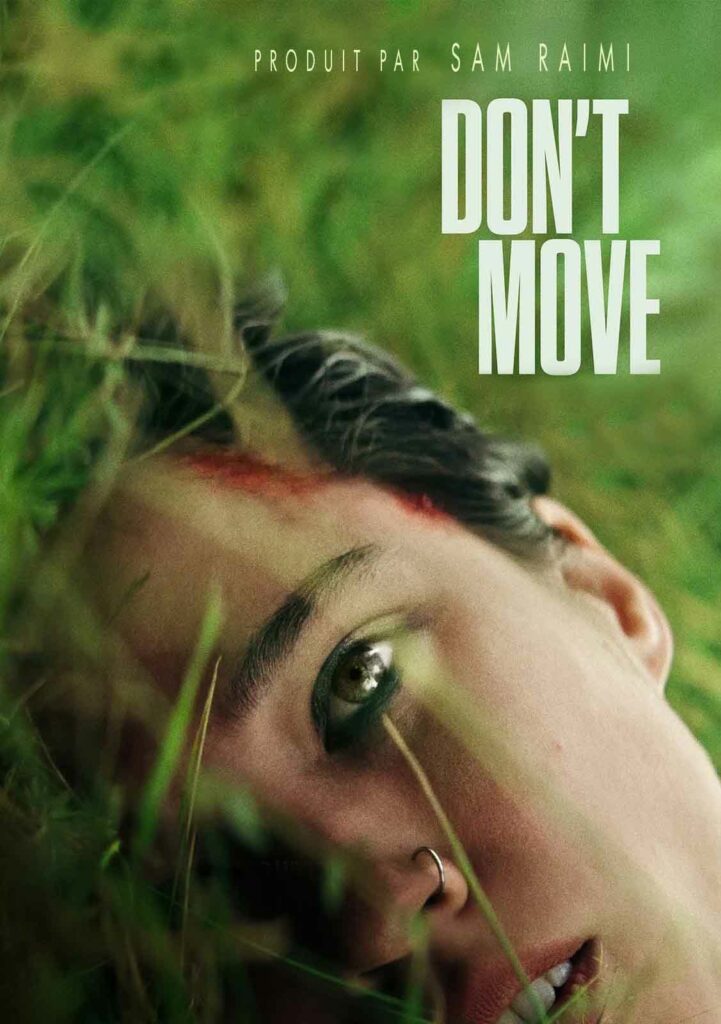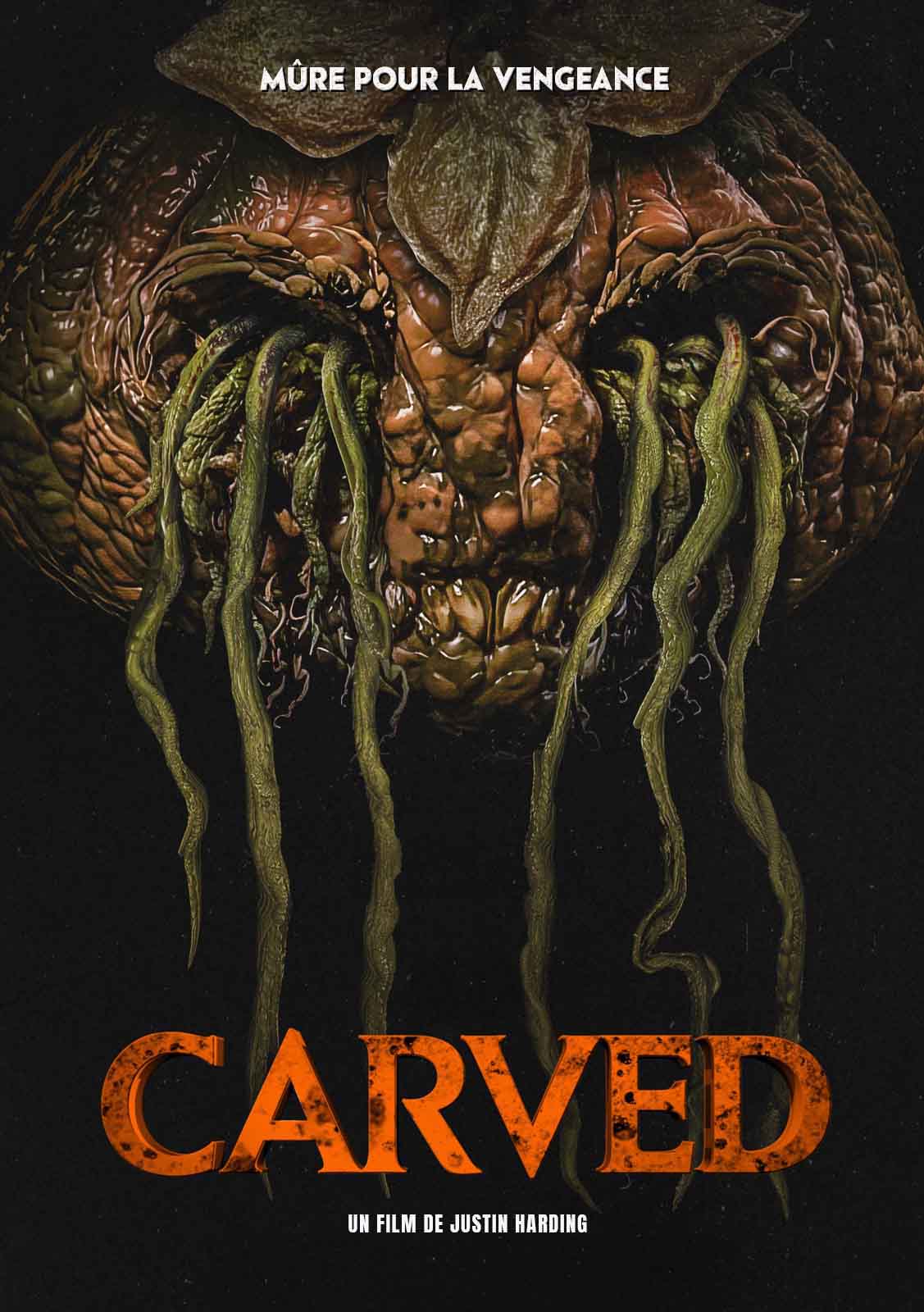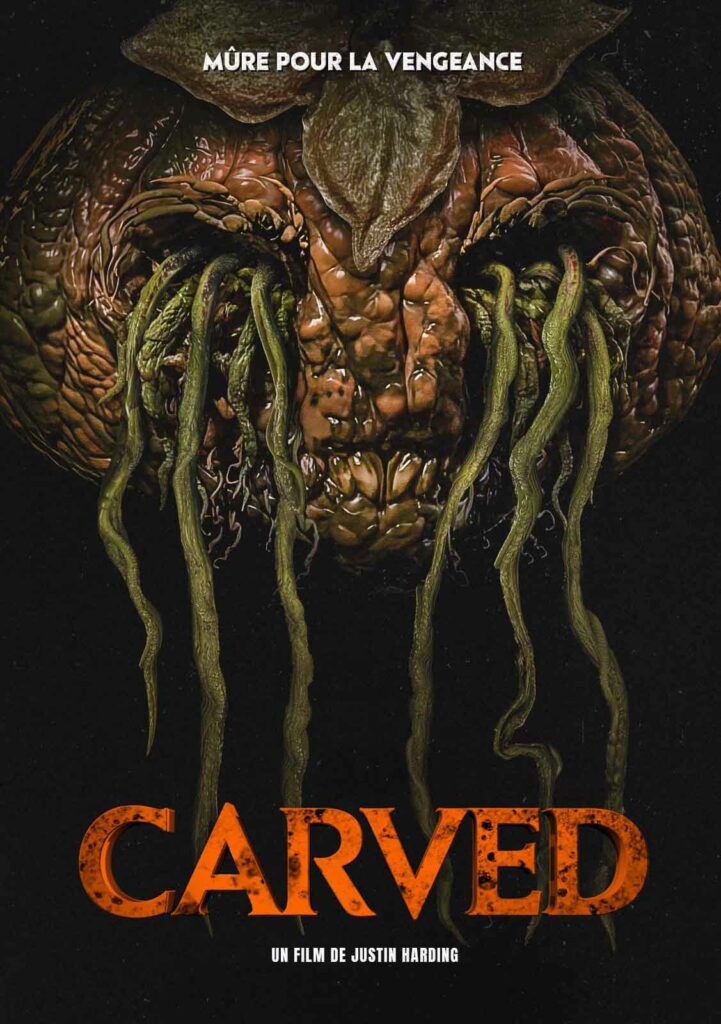Eddie Brock et son alter-ego dégoulinant sont pris en chasse par des créatures extra-terrestres voraces et par des soldats armés jusqu’aux dents…
VENOM : THE LAST DANCE
2024 – USA
Réalisé par Kelly Marcel
Avec Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans, Stephen Graham, Peggy Ku, Clark Backo, Alanna Ubach, Cristo Fernandez, Jared Abrahamson
THEMA SUPER-HÉROS I SAGA MARVEL COMICS
Certains succès hollywoodiens échappent à toute logique. Objectivement, comment expliquer que le public ait répondu aussi favorablement à un film aussi mal fagoté que le premier Venom ? Admettons qu’il s’agissait de l’effet de surprise. Mais sa suite calamiteuse, Venom Let There Be Carnage, provoqua un enthousiasme tout aussi invraisemblable. Allez comprendre. La mayonnaise prenant aussi bien, il n’y avait aucune raison de s’arrêter en si bon chemin. Andy Serkis, réalisateur du second opus, se prépare donc à rempiler pour un troisième épisode. Mais la pré-production de sa version de La Ferme des animaux lui prend beaucoup de temps et le contraint à céder sa place. C’est donc la scénariste Kelly Marcel (Dans l’ombre de Mary, Cinquante nuances de Grey, Cruella et les deux premiers Venom) qui prend le relais, effectuant du même coup ses premiers pas derrière la caméra. Avec à sa disposition un budget de 120 millions de dollars (l’enveloppe a encore augmenté depuis les deux films précédents), l’apprentie-réalisatrice peut se faire plaisir. Au détour du casting, on retrouve deux visages ayant déjà payé leur tribut aux adaptations Marvel en endossant d’autres rôles : Chiwetel Ejiofor (Mordo dans Doctor Strange) et Rhys Ifans (Curt Connors alias Le Lézard dans The Amazing Spider-Man).


Co-scénariste du film avec Kelly Marcel, Tom Hardy a visiblement trouvé une rente juteuse avec Venom. Le Mad Max de Fury Road semble pourtant se traîner sans la moindre conviction d’une scène à l’autre, comme s’il s’acquittait de mauvaise grâce de ce boulot routinier en attendant de pouvoir toucher son chèque. Comment interpréter autrement ses regards hagards, sa mine défaite et son jeu désincarné en pilote automatique ? Si le post-générique de Let There Be Carnage promettait un crossover avec le Marvel Cinematic Universe et notamment avec les Spider-Man interprétés par Tom Holland, cette suite se débarrasse des multiverses en quelques secondes. En vérité, le récit se résume à peu de choses : Eddie Brock et son alter-ego quittent le Mexique pour les États-Unis, traînent à Las Vegas puis dans la zone 51, tandis que des militaires veulent leur peau et que le Xenophage, un vilain monstre extra-terrestre en images de synthèse qu’il nous semble avoir déjà vu dans une centaine de films, cherche à se les mettre sous la dent. Voilà, c’est à peu près tout. Le film dure à peine un peu plus de 90 minutes, c’est une qualité indiscutable à mettre à son compte. L’une des seules, hélas.
« Nous ne sommes pas les méchants »
Kelly Marcel et Tom Hardy ne prenant même plus la peine de bâtir un semblant d’histoire, Venom : The Last Dance prend les allures d’un road movie erratique aux péripéties sans intérêt et aux enjeux inexistants. Certaines idées sont à peine explorées (un drame survenu dans le passé de la scientifique incarnée par Juno Temple) puis abandonnées aussitôt. Pour ne pas réclamer trop d’efforts de la part des spectateurs, on prône la simplicité : les militaires et les Xenophages sont vilains, les savants et Venom sont gentils. Et pour ceux qui seraient un peu distraits, l’un des symbiotes juge utile de dire au soldat belliqueux incarné par Ejiofor : « nous ne sommes pas les méchants ». Le principal objectif de ce scénario anémique semble être de multiplier les situations les plus ridicules possibles dans l’espoir de faire rire un public décidément jugé peu exigeant : Venom/Brock qui prépare un cocktail, s’accroche au fuselage d’un avion en plein vol, chante en chœur avec une famille de hippies, dépense tout son argent dans une machine à sous, fait des chorégraphies sur « Dancing Queen »… Nous avons aussi droit à des clins d’œil à Thelma et Louise et Rain Man, à un cheval-Venom, un piranha-Venom, une grenouille-Venom et tout un tas d’autres variantes pour le grand final pétaradant. Le succès de ce troisième opus ayant été très modéré, la formule semble enfin s’être épuisée…
© Gilles Penso
Partagez cet article