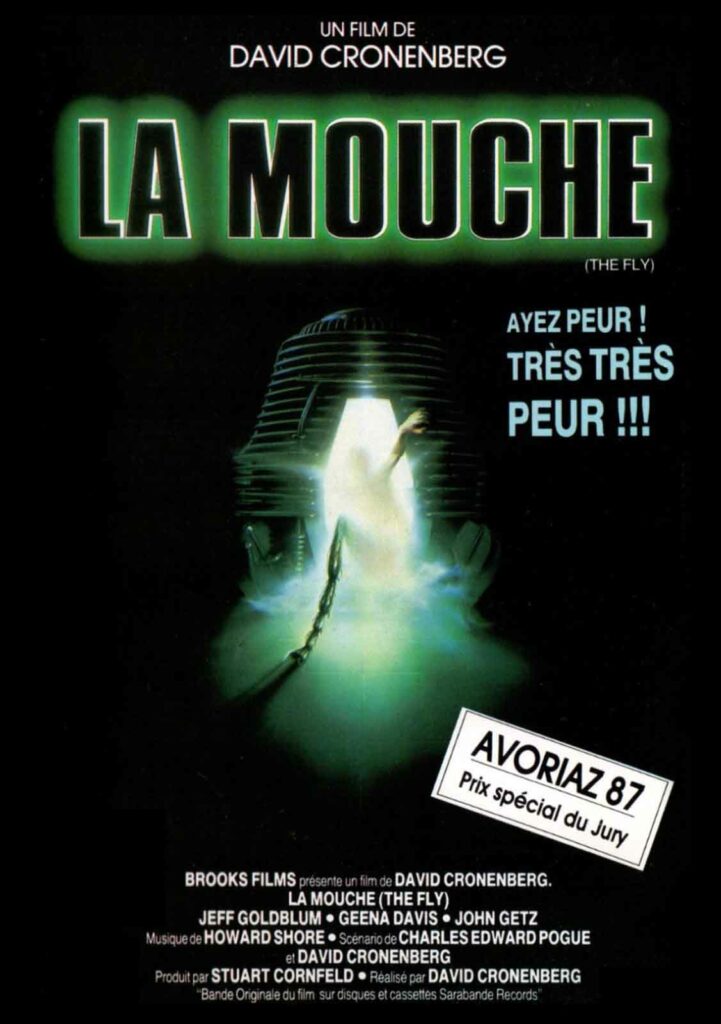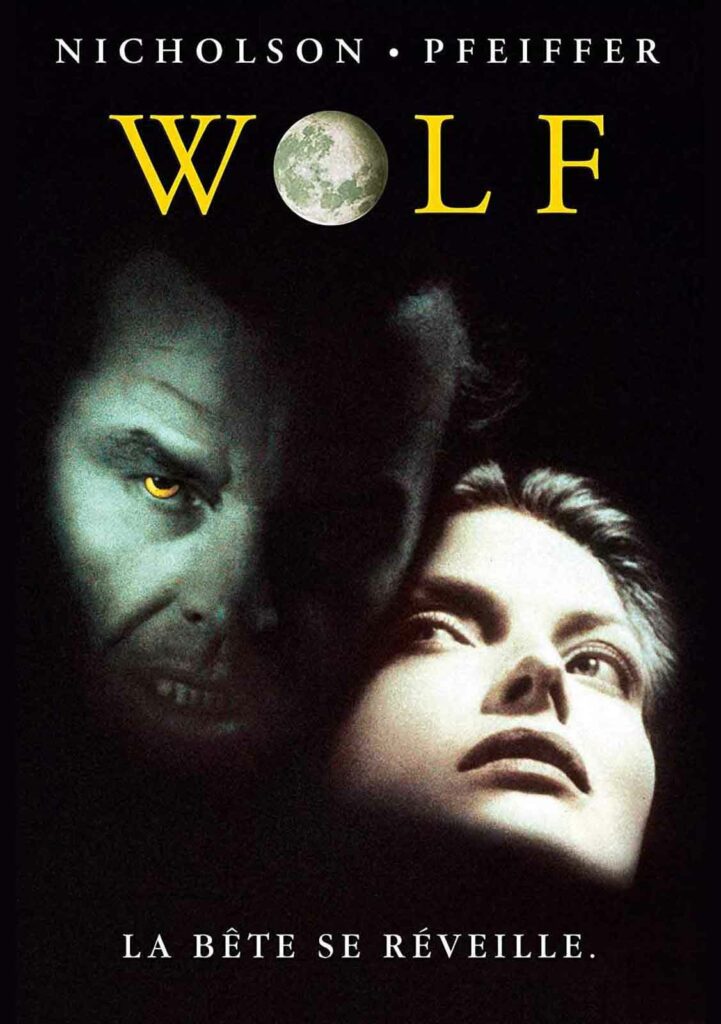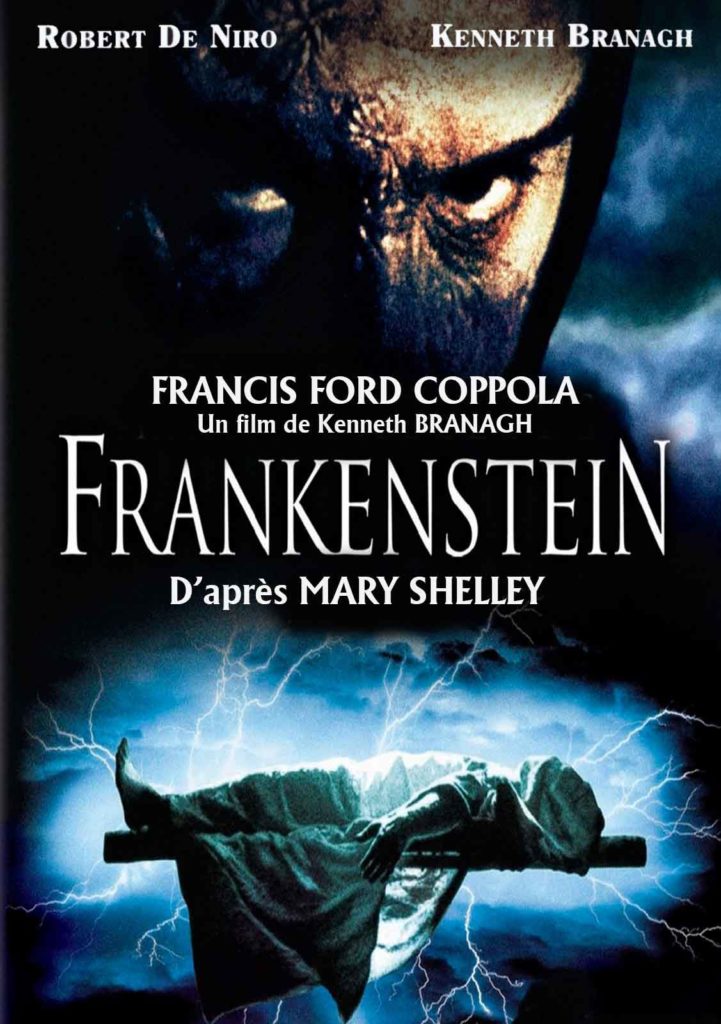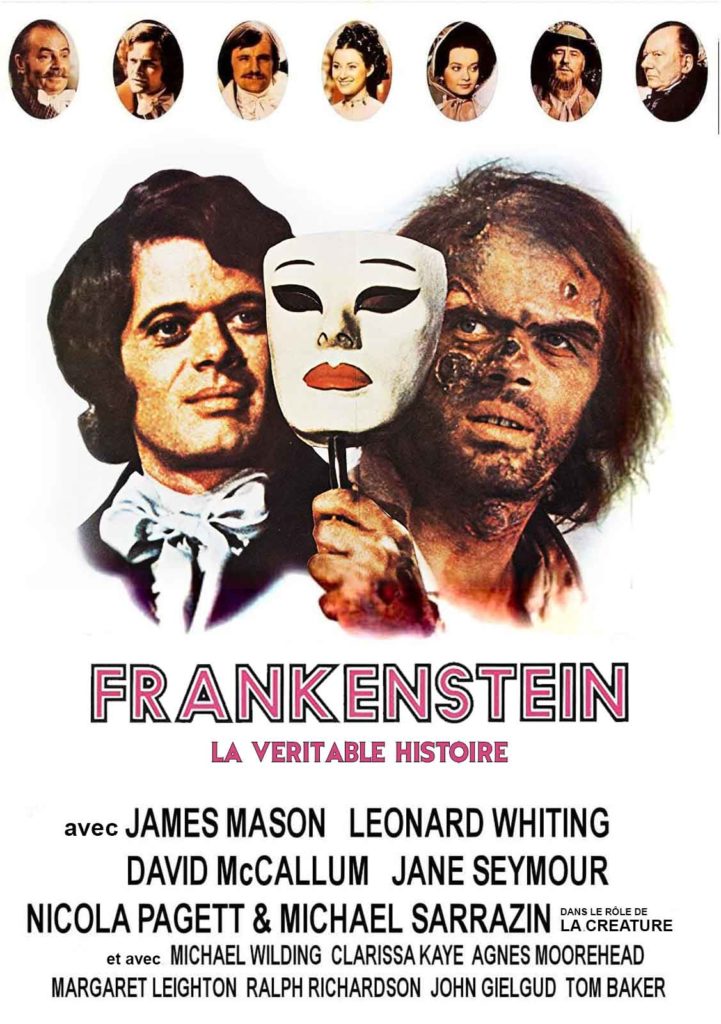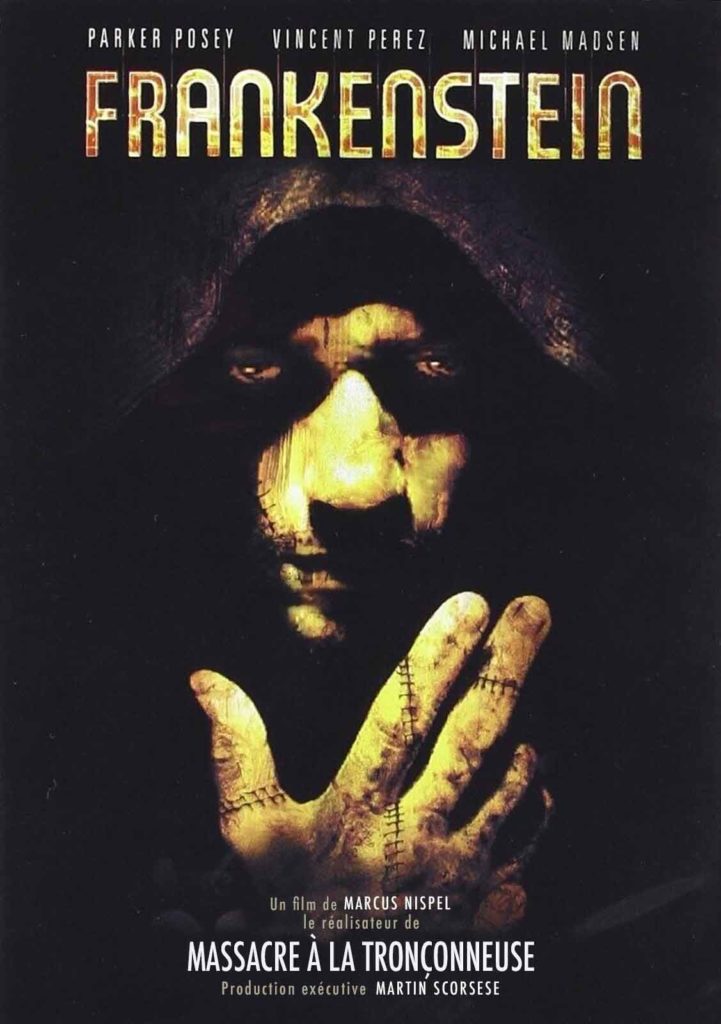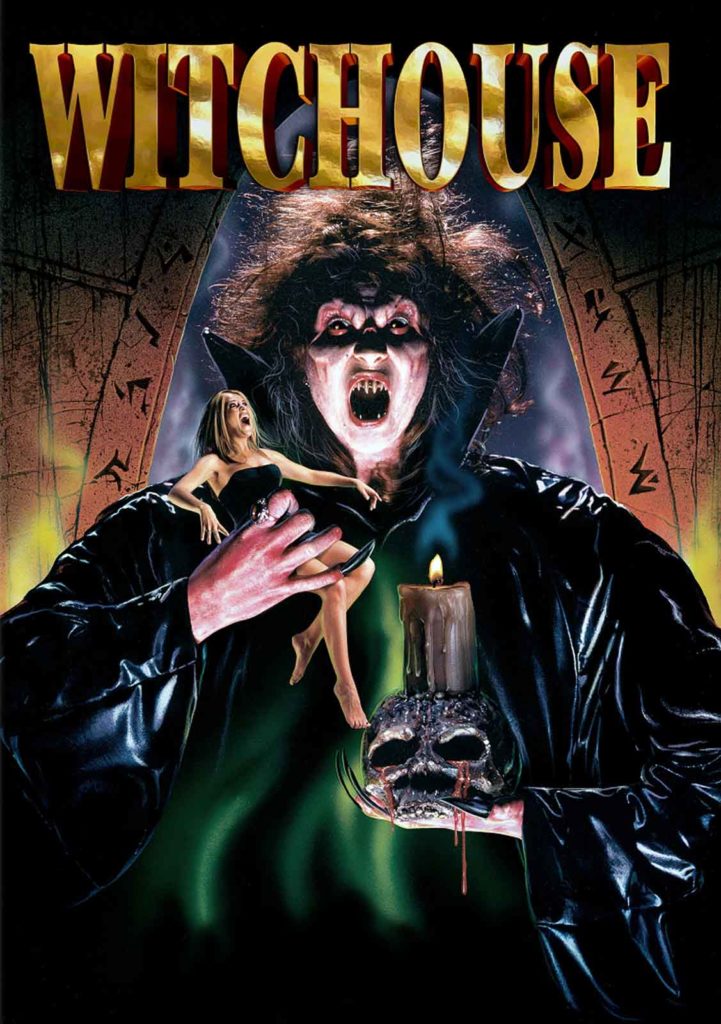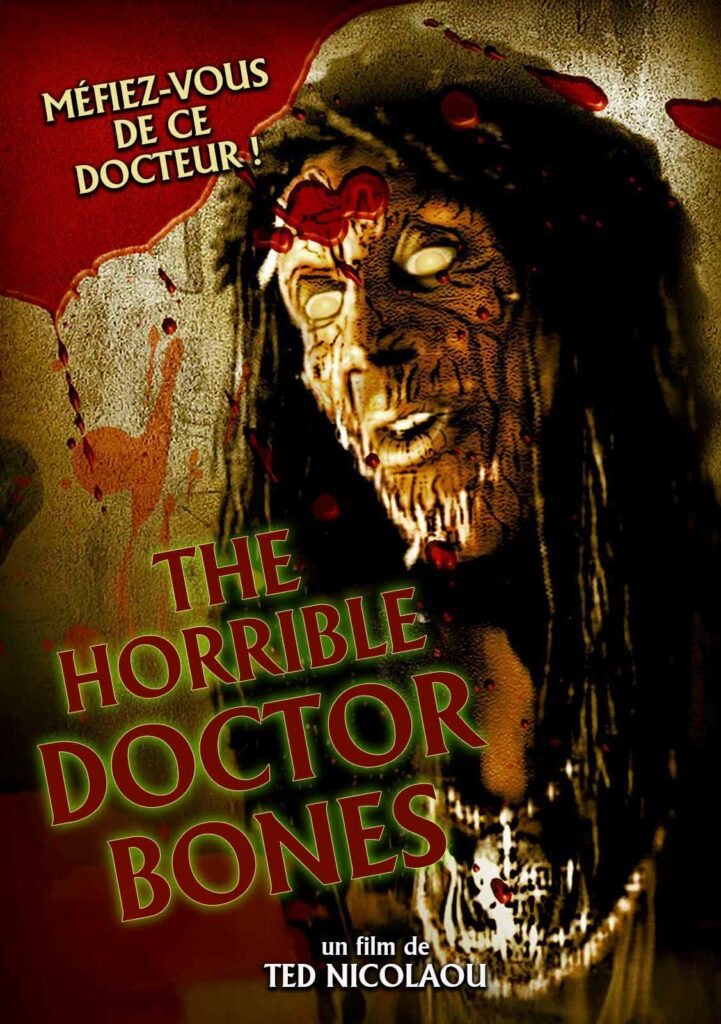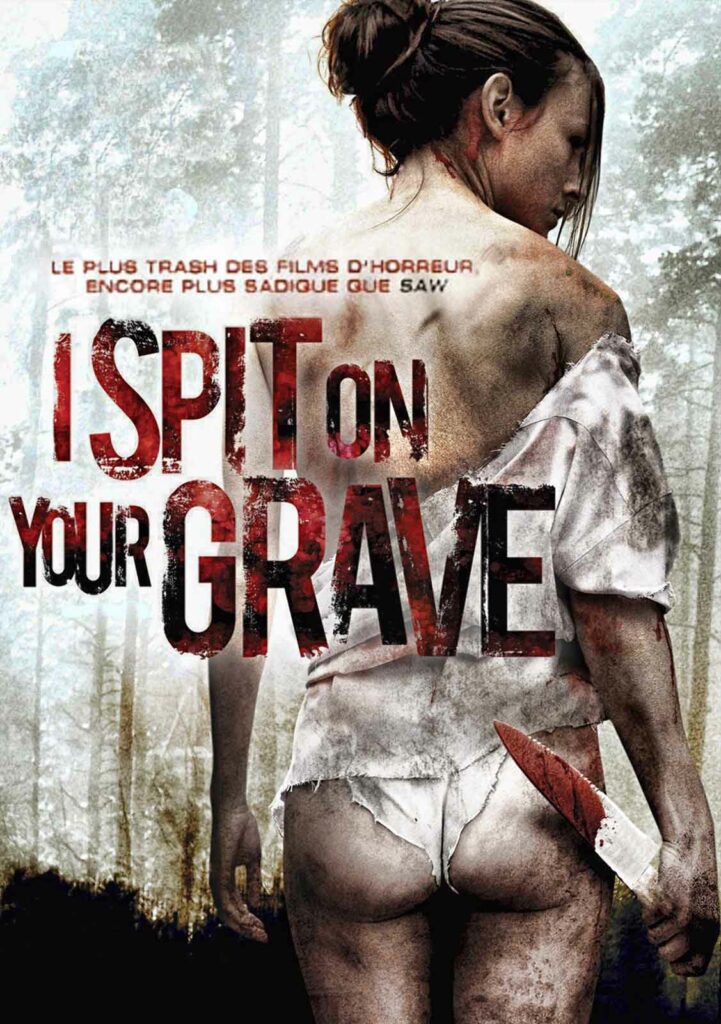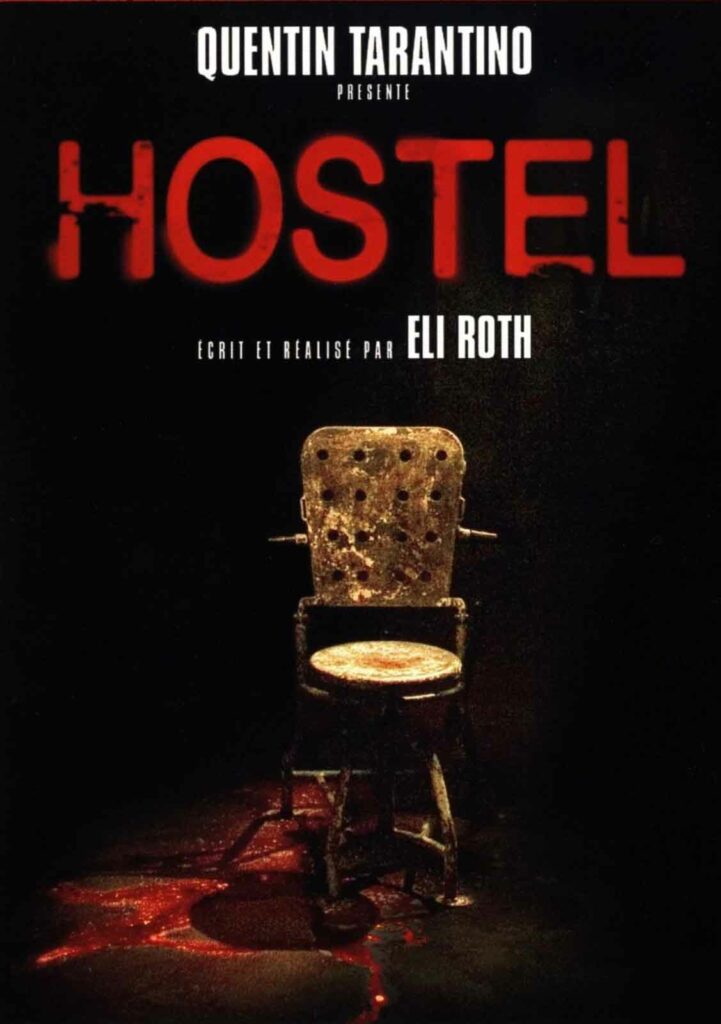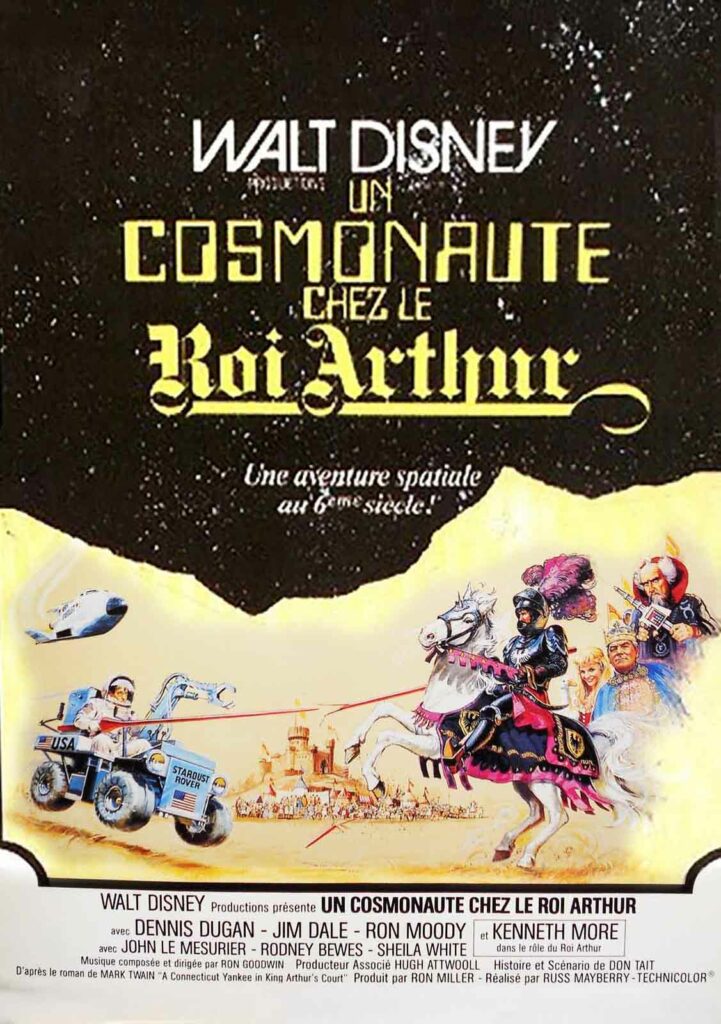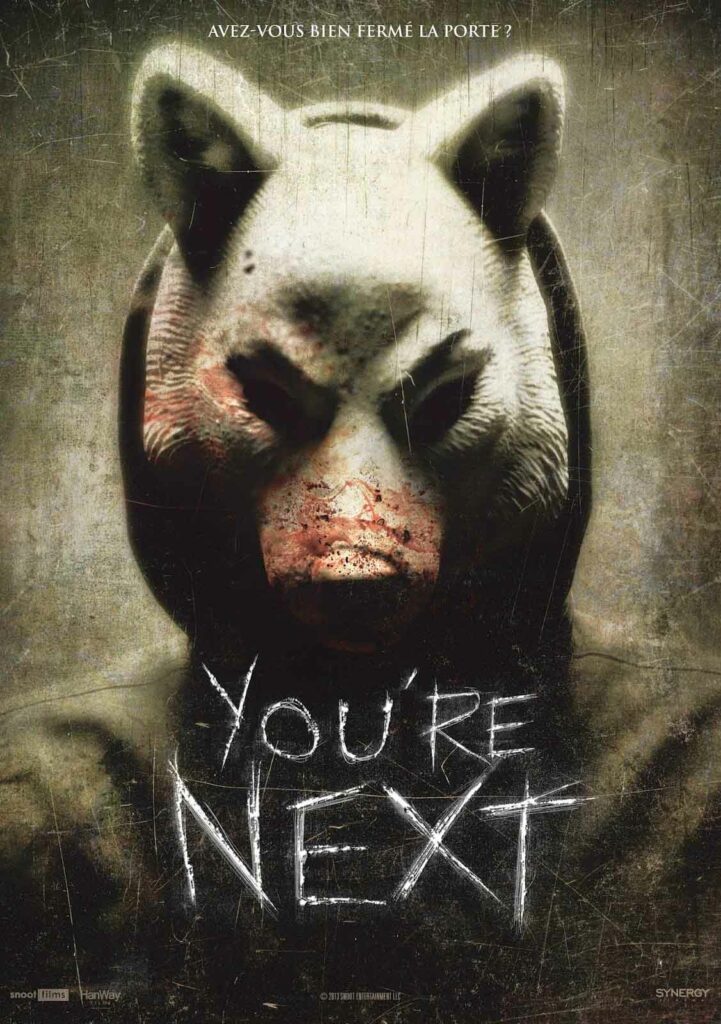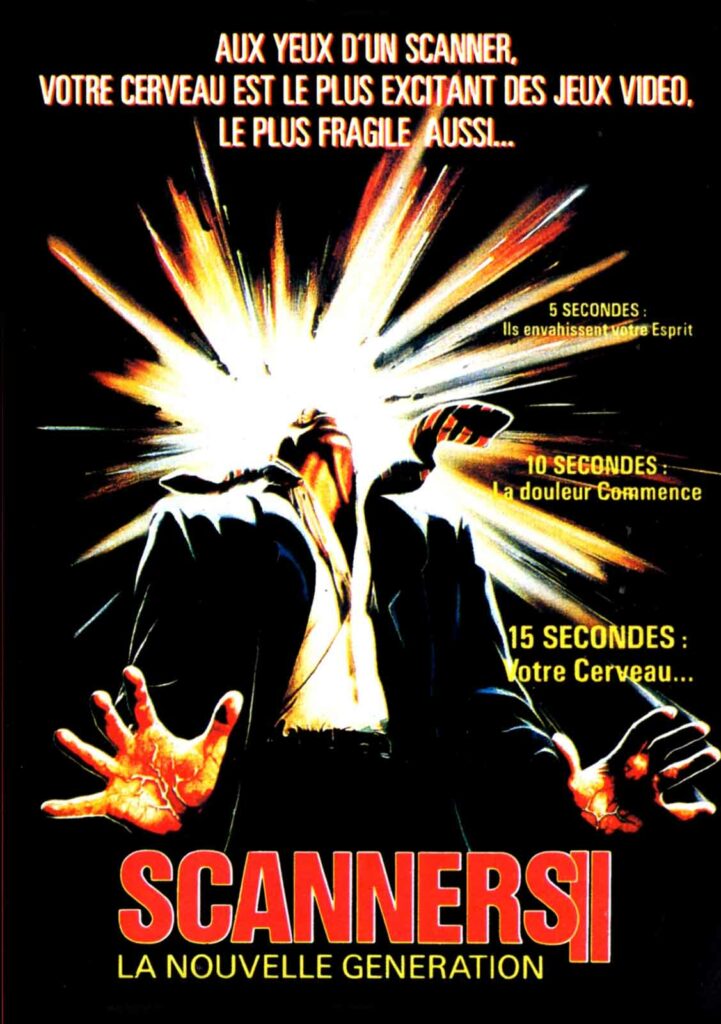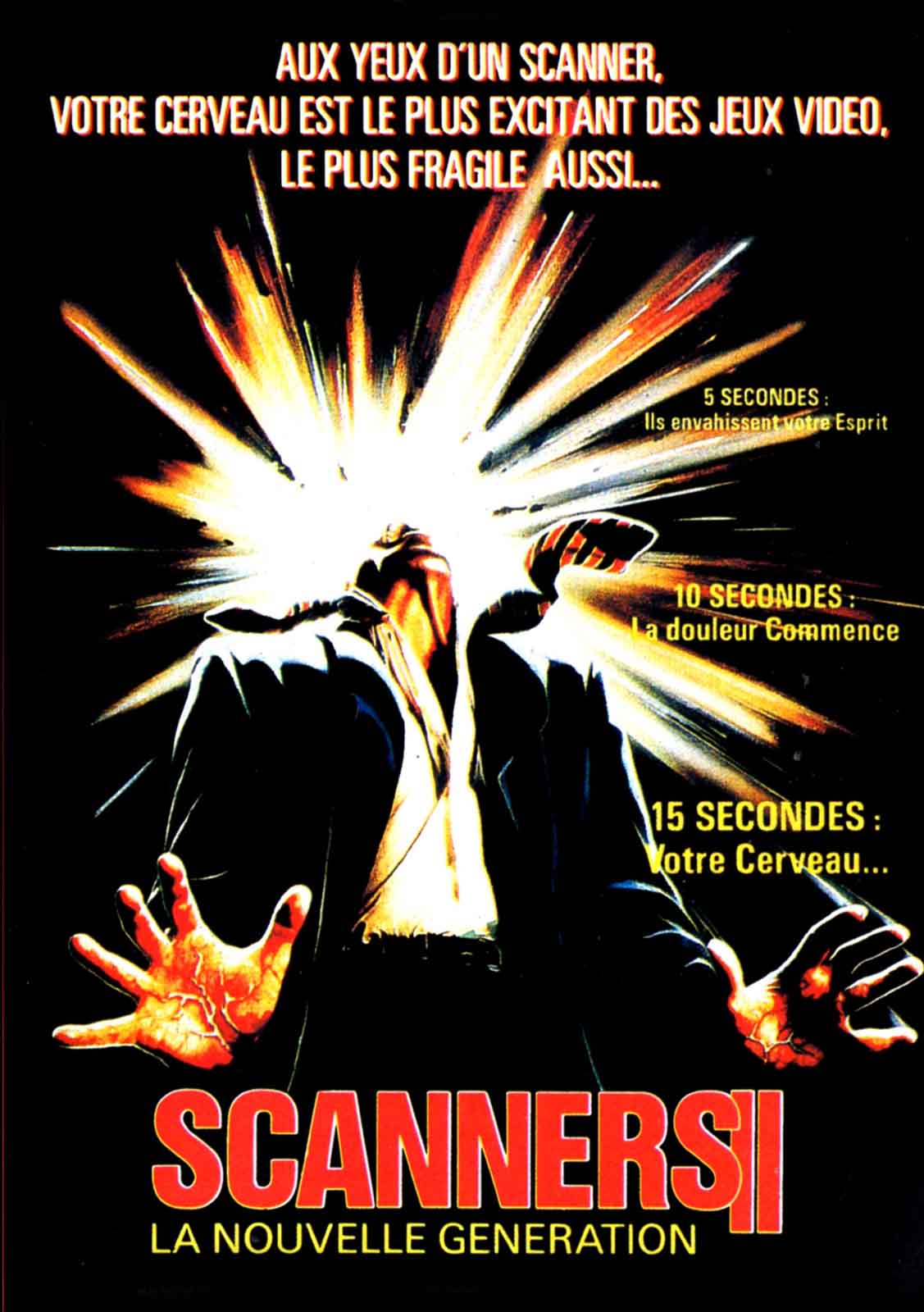En se frottant à l’univers trouble et hallucinogène de William S. Burroughs, David Cronenberg réalise l’un de ses films les plus étranges…
THE NAKED LUNCH
1991 – CANADA / GB / JAPON
Réalisé par David Cronenberg
Avec Peter Weller, Judy Davis, Ian Holm, Julian Sands, Roy Scheider, Monique Mercure, Nicholas Campbell, Michael Zelniker, Robert A. Silverman
THEMA INSECTES ET INVERTÉBRÉS
Il était impossible d’adapter littéralement Le Festin nu de William S. Burroughs. Ce roman non linéaire, écrit sous influence de drogues hallucinogènes, fait de collages surréalistes qui abordent pêle-mêle le sexe, la politique et le délire paranoïaque, est résolument anti-cinématographique. De nombreux cinéastes s’y sont penchés depuis sa première publication avant de jeter prudemment l’éponge. Mais David Cronenberg veut tenter sa chance. Après les deux coups d’éclat que sont La Mouche et Faux semblants, alors qu’il est en train de jouer dans le Cabal de Clive Barker, il se lance dans l’écriture en se fixant une règle : ne pas chercher à retranscrire directement le livre à l’écran. Son travail d’adaptation est donc une réinvention libre, puisant autant dans le texte nébuleux de Burroughs que dans la vie privée de l’écrivain. L’épisode de la mort accidentelle de sa femme suite à un jeu stupide sous emprise de la drogue, par exemple, est bien réel, tout comme l’escapade de Burroughs à Tanger pour tenter d’écrire ce qui allait devenir Le Festin nu. Le film se vit certes comme une sorte de trip hallucinogène au sein duquel il devient de plus en plus difficile de distinguer la réalité de l’illusion. Mais Cronenberg cherche surtout à explorer les méandres du processus créatif. Le Festin nu s’affirme donc moins comme une transposition du livre que comme une exploration des conditions bizarres dans lesquelles il fut écrit.


« Je pars toujours du principe que tout ça n’est qu’un jeu », raconte Cronenberg pour évoquer ses méthodes de travail. « Quels que soient les budgets ou les pressions que nous pouvons subir, faire un film, c’est redevenir enfants, se déguiser, porter des faux noms, des fausses moustaches et s’amuser. Lorsque je demande à un acteur de jouer dans un de mes films, c’est un peu comme si je demandais à un copain de venir jouer dans mon bac à sable ! » (1). Le « copain » en question est ici Peter Weller, acteur cronenbergien par excellence dont le visage taillé à la serpe et le regard perçant s’inscrivent dans la continuité des « gueules » chères au cinéaste, celles de James Woods, Christopher Walken ou Jeremy Irons. L’ex-Robocop entre dans la peau de William Lee, alter-égo de Burroughs. Écrivain junkie, notre homme est réduit à gagner sa vie en exterminant des cafards dans le New York de 1953. Un jour, il découvre que son épouse se drogue avec la poudre jaune censée tuer les insectes. Curieux, il la teste à son tour et commence à ne plus pouvoir distinguer la réalité de l’hallucination, son monde se peuplant peu à peu de créatures bizarres qui lui dictent son comportement au sein d’une trouble affaire d’espionnage qui le pousse à partir s’exiler dans un coin reculé d’Afrique du Nord baptisé « l’Interzone »…
« Rien n’est vrai, tout est permis »
La citation en exergue du film (« Rien n’est vrai, tout est permis »), la musique entêtante d’Howard Shore détournant les sonorités jazzy des années 50, les répliques désabusées de William Lee (« Il faut exterminer toute pensée rationnelle ») nous permettent très tôt de comprendre que Le Festin nu va nous transporter sur un terrain inconnu, ses allures de film noir classique n’étant évidemment qu’un faux semblant. Les bêtes kafkaïennes s’invitent très tôt dans le film, du cafard géant s’exprimant avec son abdomen vaginal aux mille-pattes aquatiques géants dont on extrait une drogue nommée « viande noire », en passant par les machines à écrire-cancrelats biomécaniques ou l’incroyable « Mugwump » aux allures de grand bipède gluant dont les antennes laissent échapper un liquide séminal. Pour donner corps à ce bestiaire inédit, le créateur d’effets spéciaux Chris Walas réalise un travail remarquable. Redoublant d’inventivité à l’aide de marionnettes animatroniques complexes, de prothèses et de maquillages spéciaux, Walas retrouve Cronenberg après La Mouche et s’autorise tous les délires. Y compris cette scène impensable dans laquelle Roy Scheider émerge du corps d’une femme qui s’ouvre en deux pour le laisser sortir ! Aux côtés de Peter Weller, Judy Davis, Ian Holm et Julian Sands nous offrent des prestations troubles et ambiguës en accord avec la tonalité insaisissable du film. Échec financier lors de sa sortie en salles – mais comment pouvait-il en être autrement ? – , Le Festin nu acquerra par la suite un statut de film culte et sera reconnu comme l’un des opus majeurs de l’œuvre de Cronenberg.
(1) Propos recueillis par votre serviteur en octobre 2005
© Gilles Penso
À découvrir dans le même genre…
Partagez cet article