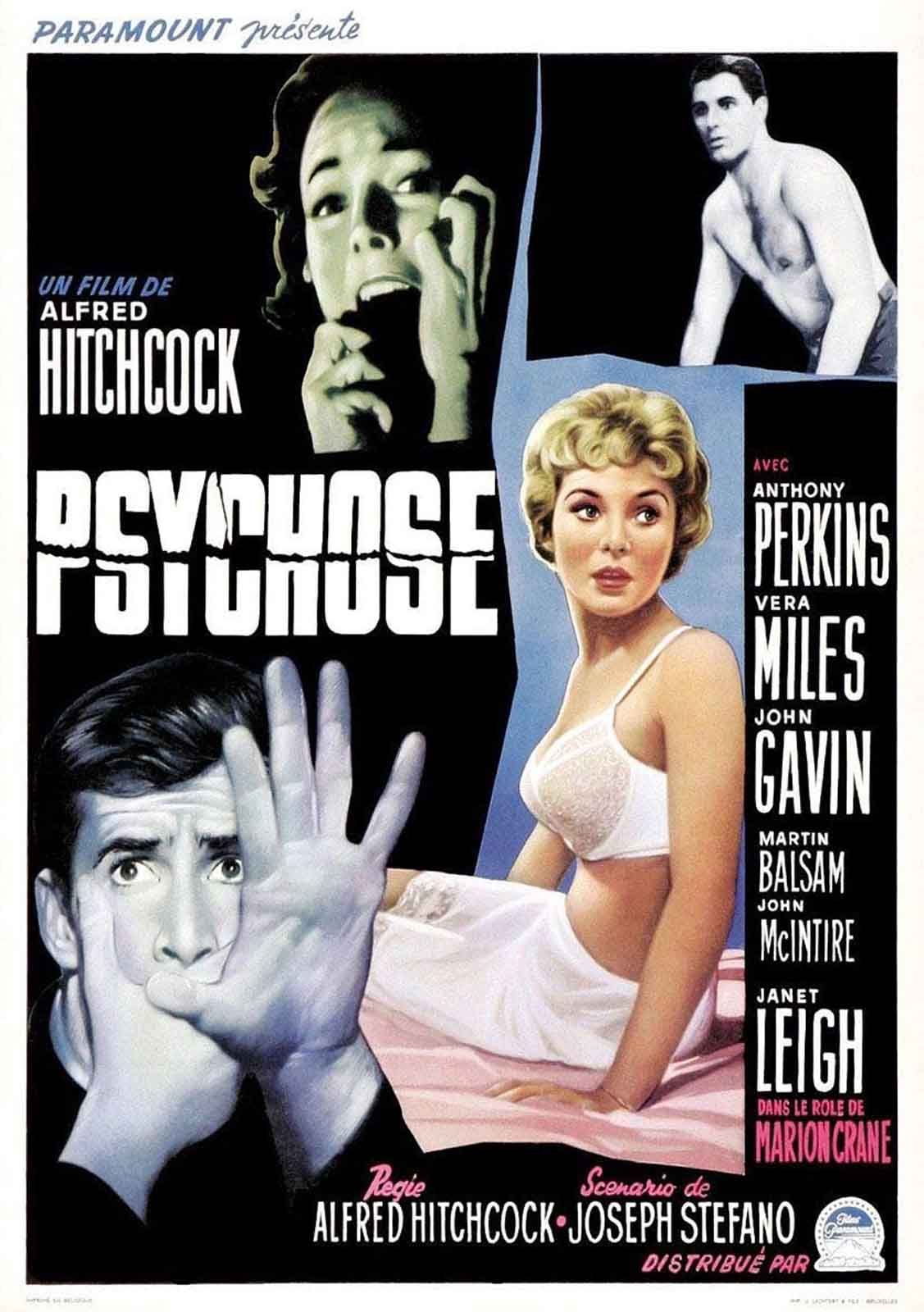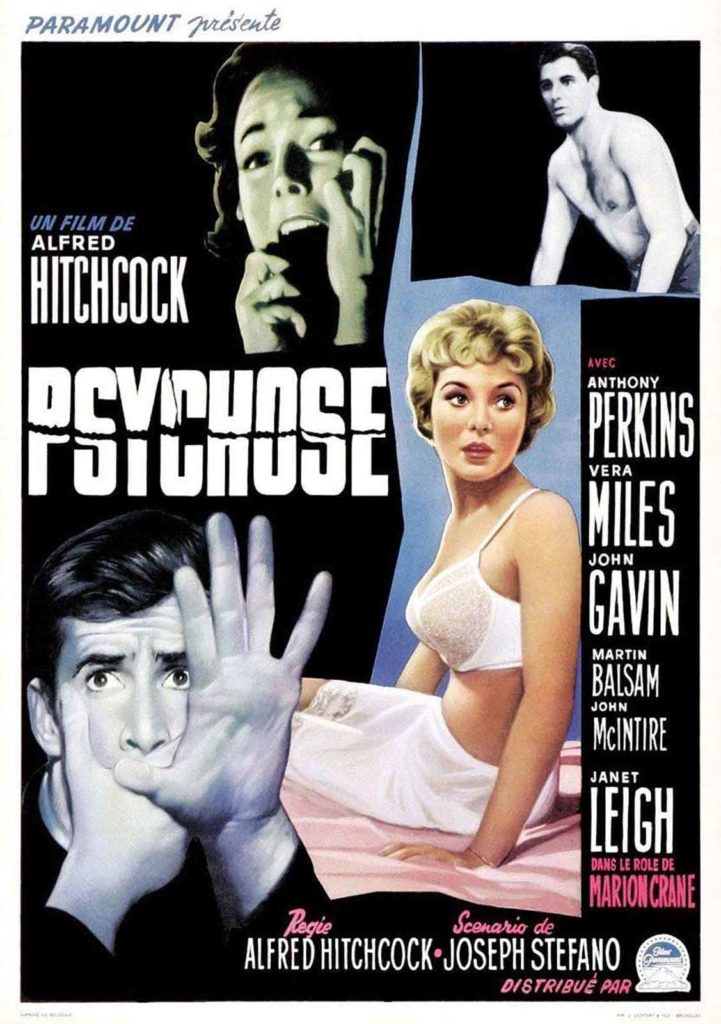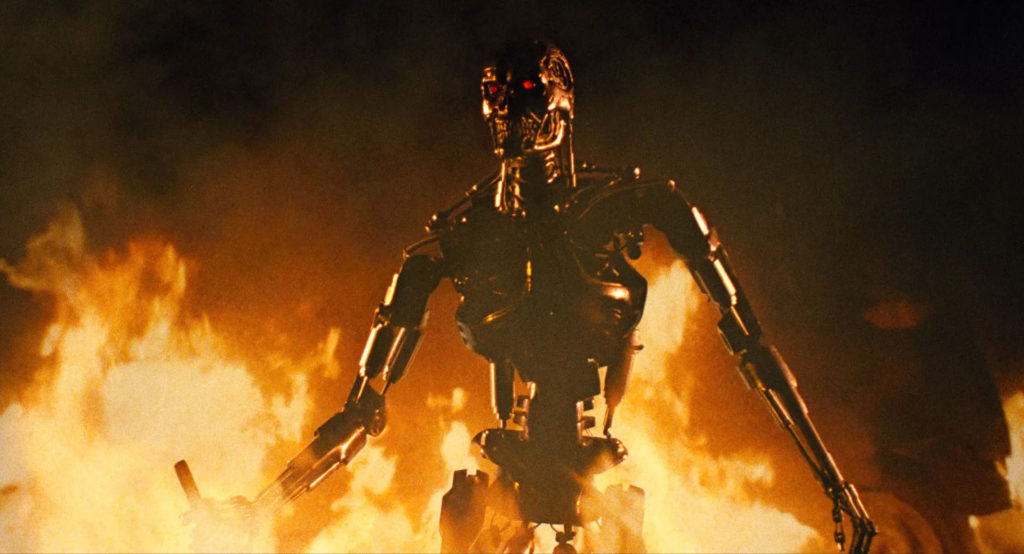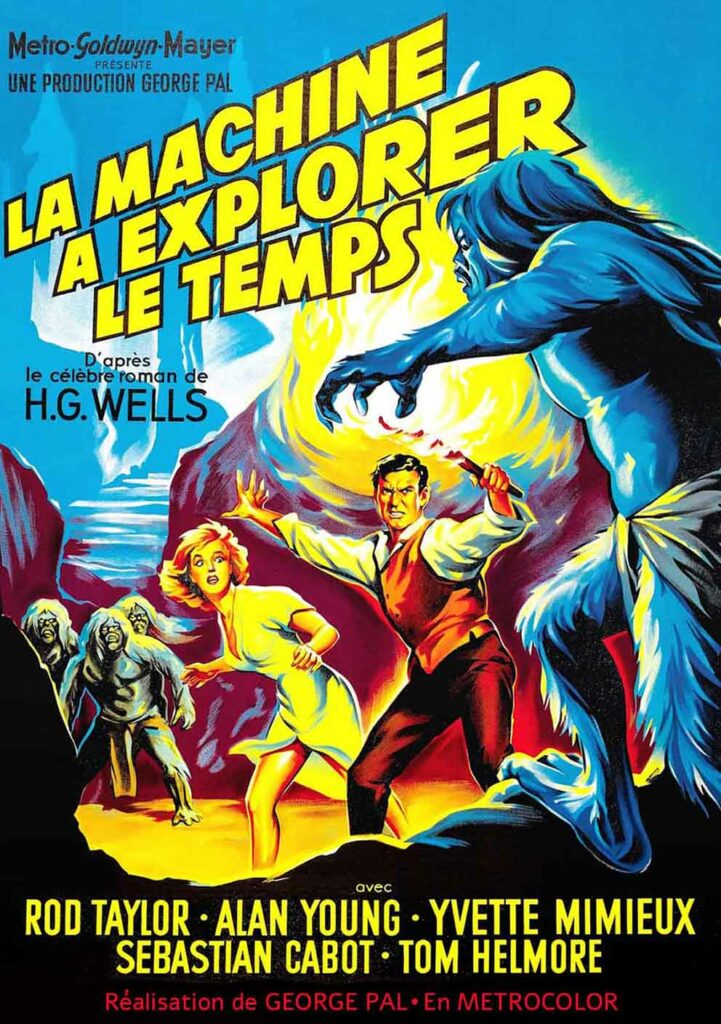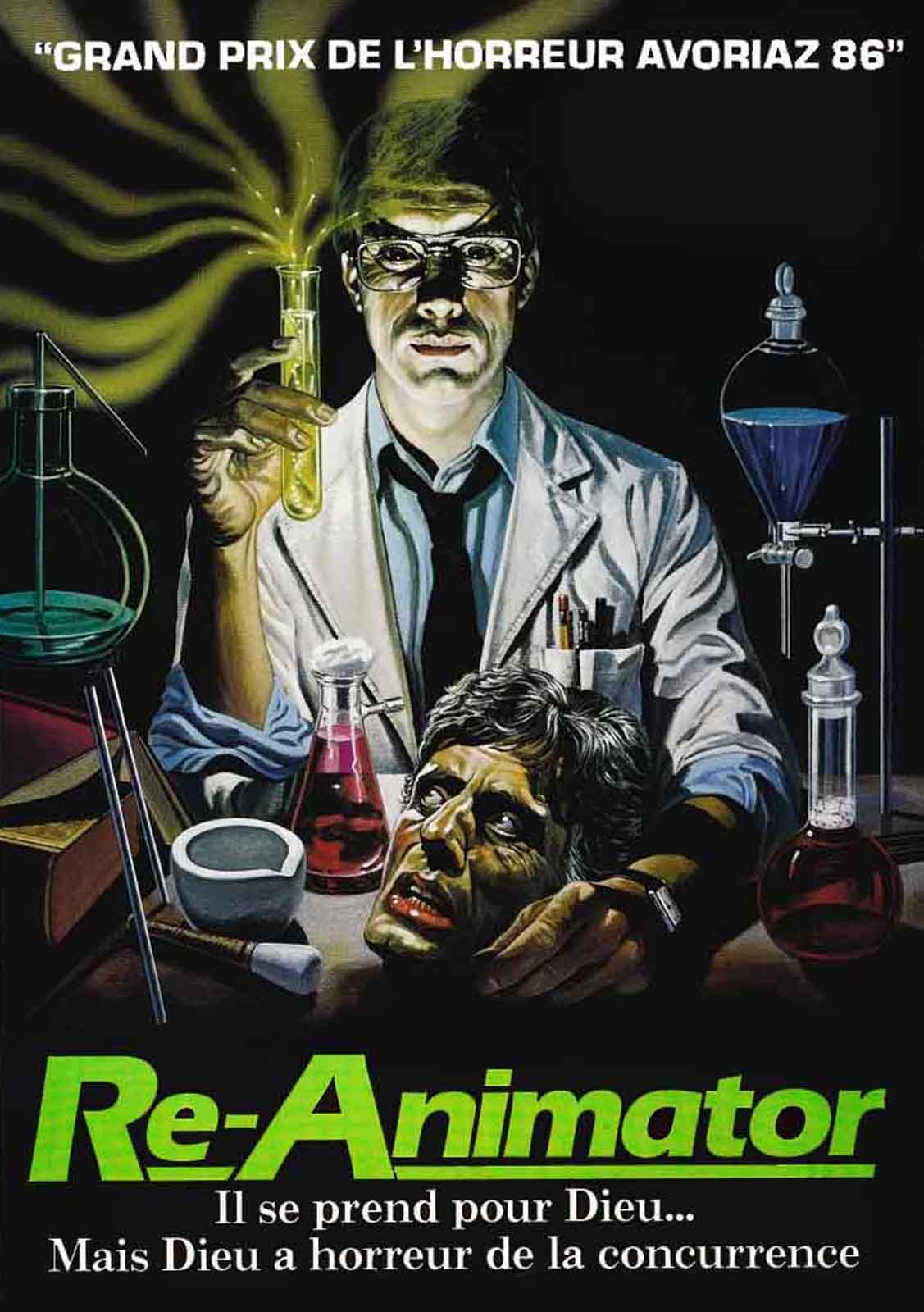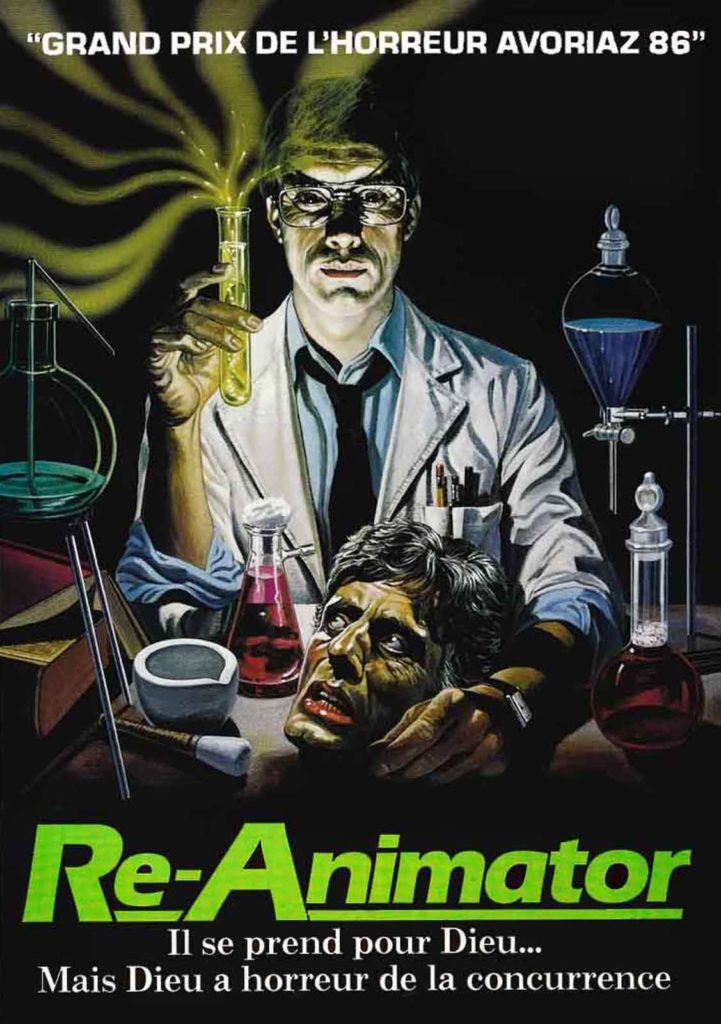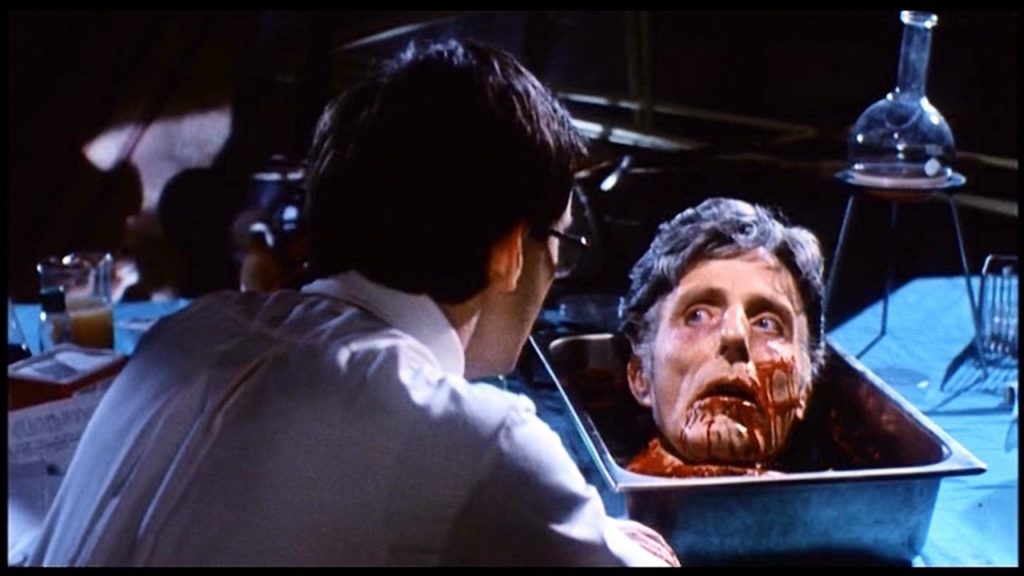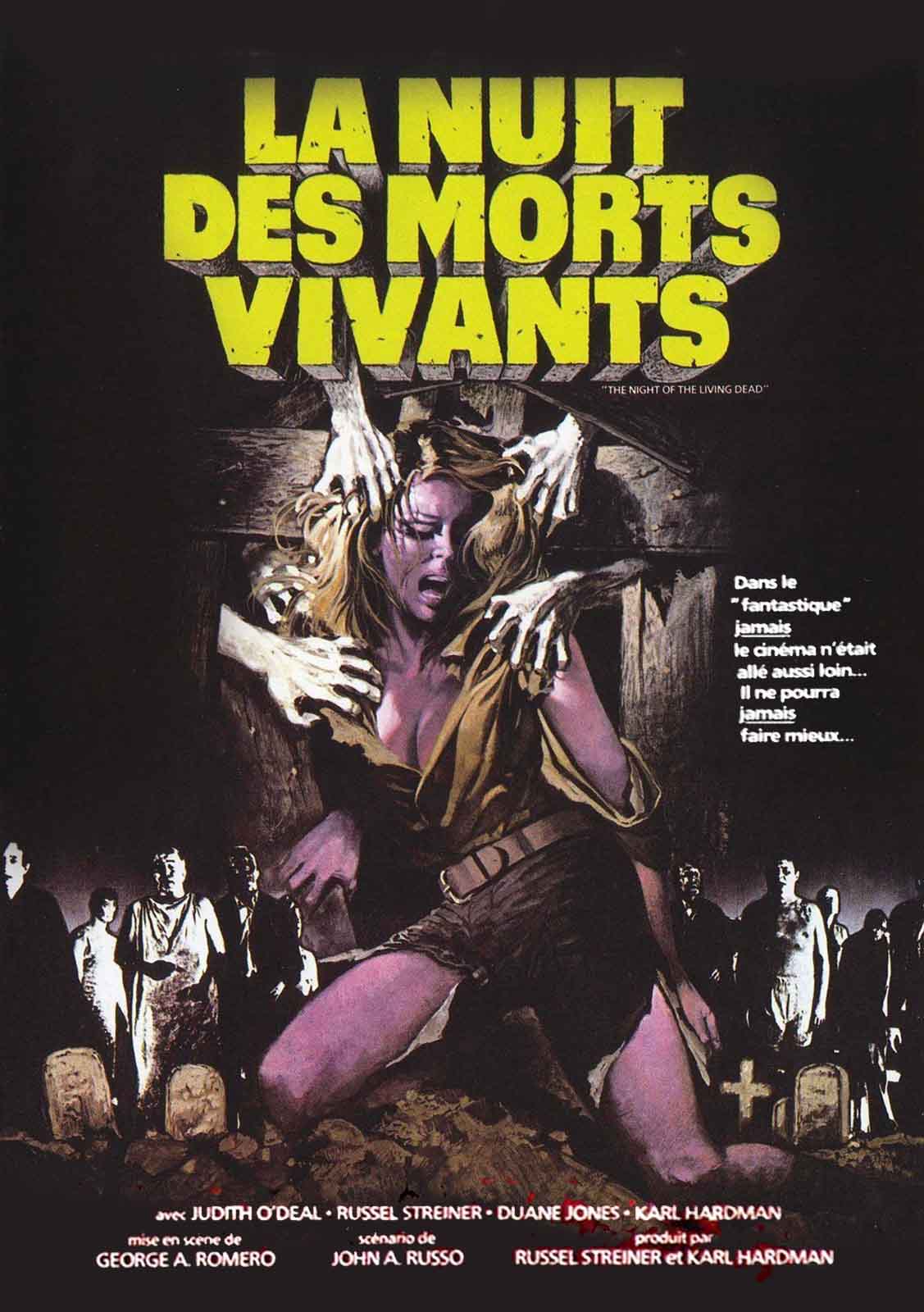Le petit Joshua est-il un enfant maléfique aux sombres desseins, ou tout se passe-t-il dans la tête de ses parents névrosés ?
JOSHUA
2007 – USA
Réalisé par George Ratliff
Avec Sam Rockwell, Vera Farmiga, Jacob Kogan, Celia Weston, Dallas Roberts, Michael McKean, Nancy Giles, Linda Larkin
THEMA ENFANTS
A priori, Joshua Cairn n’a rien d’un monstre. Certes, l’exceptionnelle intelligence de ce garçon de neuf ans, sa passion pour l’antiquité égyptienne, ses dons pour la musique et son manque d’intérêt pour le sport le marginalisent quelque peu par rapport à ses petits camarades, mais rien d’anormal n’est à signaler… Jusqu’à la naissance de Lily, sa petite sœur. Dès lors, l’univers bien ordonné de sa famille new-yorkaise aisée commence à se détériorer. Cette inexorable descente aux enfers est-elle due à un spectaculaire « baby blues » poussant la jeune mère à une dépression paranoïaque ? Ce serait l’explication la plus logique. Mais plus les choses dégénèrent, plus le père soupçonne Joshua de mettre son esprit surdoué au service d’une machination machiavélique…


A la manière d’un Michael Haneke se réappropriant le slasher pour en livrer une vision hyperréaliste débarrassée de ses codes habituels, George Ratliff nous raconte l’enfance diabolique sous un jour étonnamment naturaliste. Empruntant ses effets de style au cinéma américain indépendant plutôt qu’au film d’épouvante, le cinéaste nous brosse le tableau d’une famille crédible, portée par des comédiens sensationnels. Brad, le père, est gestionnaire de fonds dans une compagnie d’investissements à haut risque, un self made man ambitieux et un rien arriviste issu d’un milieu catholique modeste (sa mère est évangéliste et adepte du prosélytisme). L’excellent Sam Rockwell (qui fut un méchant mémorable dans Charlie’s Angels et La Ligne verte) prête son charisme et son bagout à ce personnage pivot sur le point de basculer.
Un petit air du Damien de La Malédiction
Abby, la mère, a coupé les ponts avec ses parents et frôle dangereusement la crise de nerfs lorsque les cris de son bébé deviennent trop insistants. Bouleversante, à fleur de peau, Vera Farmiga (Un Crime dans la tête, Les Infiltrés) nous livre là une prestation proprement habitée. Quant à Joshua, dont la froideur, les cheveux bien peignés et le costume impeccable évoquent irrésistiblement le Damien de la trilogie La Malédiction, il prend les traits du quasi-débutant Jacob Kogan, dissimulant soigneusement ses émotions sous un masque glacial. Toute la subtilité du film consiste à bâtir un environnement réaliste et identifiant (les scènes de crise postnatales sentent le vécu !) pour mieux le bousculer au fil de l’intrigue. La terreur que ressentent les adultes est insidieuse, palpable, d’autant que nous ne savons jamais vraiment si l’inquiétude est justifiée ou le fruit d’une imagination trop fertile. Le chien de la maison est-il mort par hasard ? Les cris incessants du bébé sont-ils provoqués par une cause extérieure ? La panique croissante d’Abby est-elle sciemment déclenchée ? La jalousie supposée de Joshua va-t-elle aboutir au drame tant redouté ? Toutes ces interrogations trouvent leur réponse dans un dénouement saisissant, sans tambours ni trompettes mais avec quelques notes de piano, une chansonnette « innocente » et une subtilité qui nimbe le film tout entier. Joshua est un film d’horreur élégant, en quelque sorte, échappant si bien aux étiquettes qu’il fut primé non pas à Gerardmer mais au Festival du Film Indépendant de Sundance.
© Gilles Penso
Partagez cet article