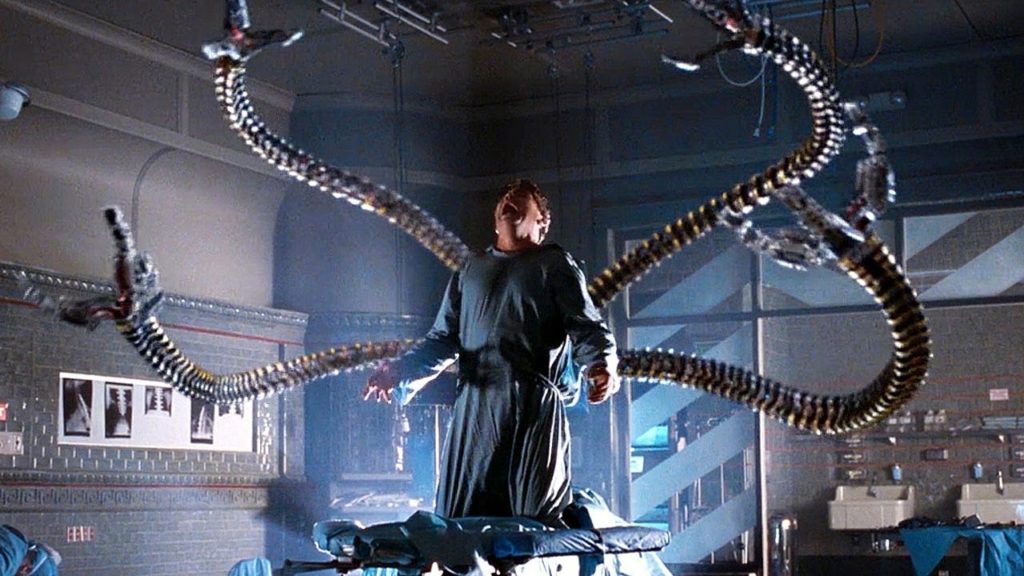Toutes époques et générations confondues, c'est l'épisode préféré des amateurs de la saga Star Wars
THE EMPIRE STRIKES BACK
1980 – USA
Réalisé par Irvin Kershner
Avec Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford, David Prowse, Frank Oz, Anthony Daniels, Kenny Baker, Billy Dee Williams
THEMA SPACE OPERA I SAGA STAR WARS
L’Empire contre-attaque est probablement le plus riche des trois épisodes de la première trilogie Star Wars. Situé au cœur même du combat entre le bien et le mal, il narre la partie la plus complexe, une espèce d’Acte II au cours duquel les personnages gagnent en profondeur. Luke a perdu de sa naïveté, Solo de son ironie, Leïa de sa froideur. Même Chewbacca semble moins sauvage. Quant à la terrible malfaisance de Vader, elle devient ambiguë, et se relativise à l’annonce d’une entité plus grande, plus puissante et plus maléfique encore. Chassés de la planète Yavin par les forces impériales après la destruction de l’Etoile Noire dans La Guerre des étoiles, les rebelles se sont réfugiés sur Hoth, la planète de glace. Darth Vader les attaque avec les monstrueux robots At-At, et ils doivent à nouveau prendre la fuite. Leïa, Han Solo, Chewbacca et C3P0 abandonnent le quartier général à bord du Faucon Millenium et se dirigent vers Bespin, la planète dans les nuages, où ils sont capturés par l’Empire. Pendant ce temps, Luke Skywalker et R2D2 se rendent sur la planète Dagobah pour y rencontrer Yoda, le maître Jedi, suivant les conseils d’Obi Wan Kenobi. Yoda forme Luke et lui enseigne la force. Mais Luke perçoit l’appel de ses amis et part les retrouver sur Bespin avant la fin de sa formation. Là, Darth Vader l’attend pour lui faire une terrible révélation, l’une des plus marquantes de l’histoire du cinéma.


Le travail conjugué d’Irvin Kershner et George Lucas, respectivement directeur d’acteurs et conteur d’histoire, est prodigieux. Les trois comédiens vedettes, dominés par le talent d’Harrison Ford, parviennent sans peine à sensibiliser des spectateurs pourtant sollicités par des effets spéciaux encore plus spectaculaires que ceux du film précédent. A ce titre, la traversée du champ d’astéroïdes, à couper le souffle, ou l’attaque des At-At, vertigineuses machines de guerre quadrupèdes, font désormais figure de scènes d’anthologie. Cette dernière séquence semble avoir été conçue comme un vibrant hommage aux effets spéciaux de Ray Harryhausen. « Nous tenions absolument à utiliser l’animation image par image de manière inédite par rapport à ce que les spectateurs avaient déjà pu voir par le passé » nous confie l’animateur Phil Tippett. (1)
L'entrée en scène de Yoda
Toute la richesse de cette incroyable saga, portée en germe dans La Guerre des étoiles, s’affirme vraiment au cours de ce second volet. Et si L’Empire contre-attaque n’a rien perdu de sa modernité, contrairement au film précédent qui a pris entre-temps un petit coup de vieux, c’est sans conteste grâce à la mise en scène d’Irvin Kershner, parée d’une direction artistique exceptionnelle, au scénario écrit à quatre mains par Lawrence Kasdan et Leigh Brackett, écrivain de science-fiction en vogue depuis les années 40 et auteur du script de Rio Bravo, et à des séquences inoubliables, comme la formation de Luke par l’incroyable maître Yoda, qui permet à Lucas de développer le concept de la Force et de ses deux penchants. Et pour couronner le tout, L’Empire contre-attaque se paie le luxe d’évacuer tout happy-end, s’achevant sur une note sombre et ouvrant la voie au Retour du Jedi.
(1) Propos recueillis par votre serviteur en avril 1998.
© Gilles Penso
Partagez cet article