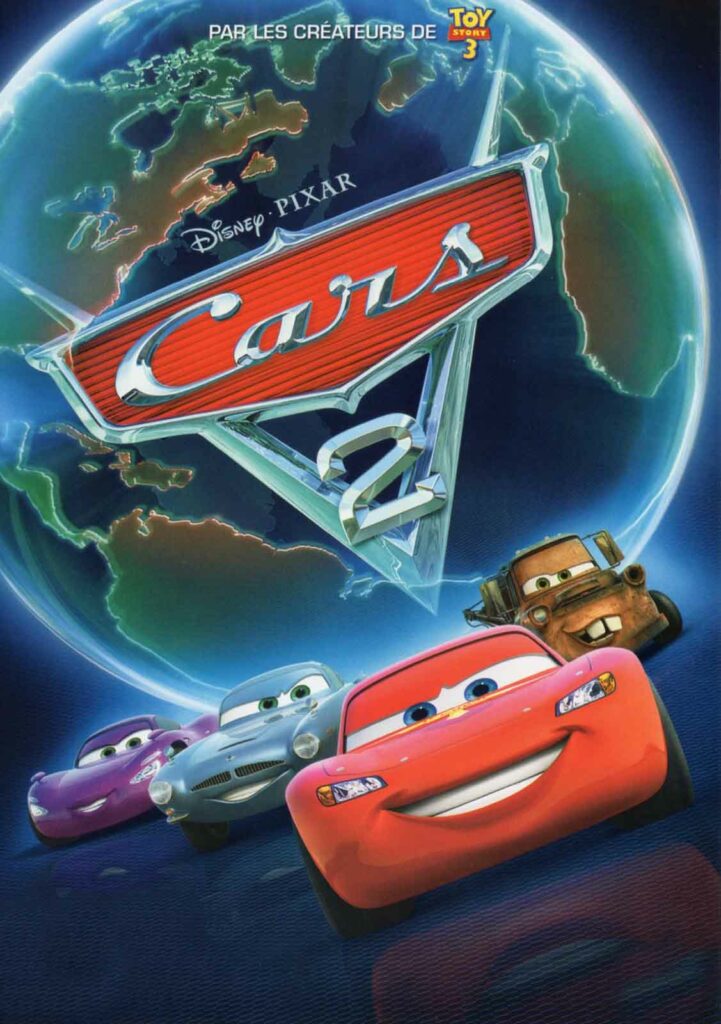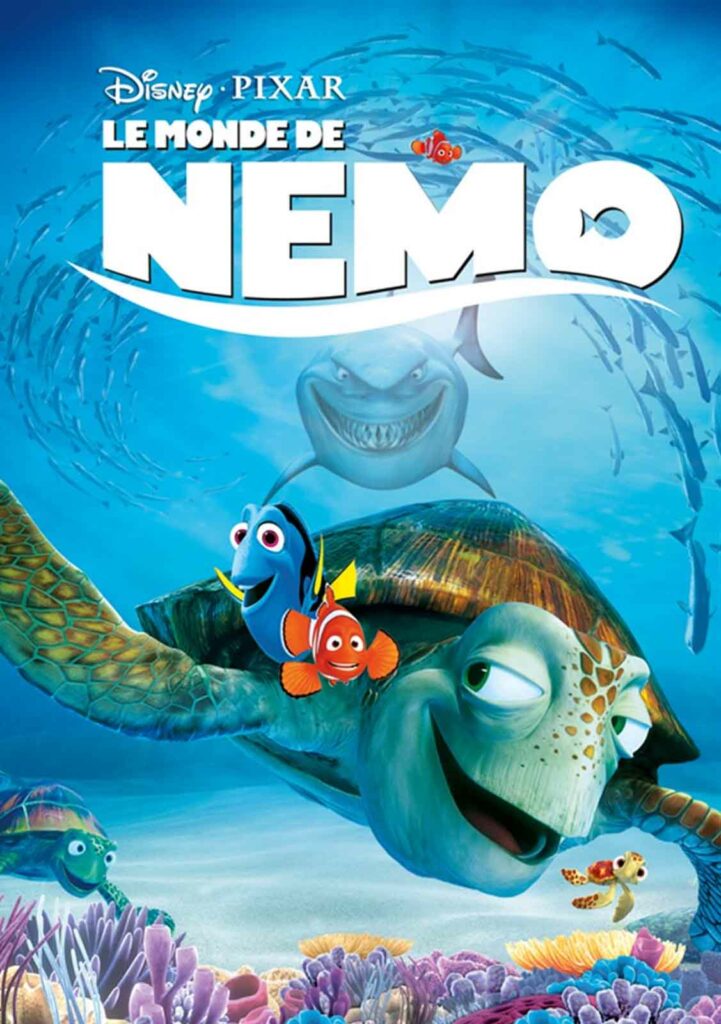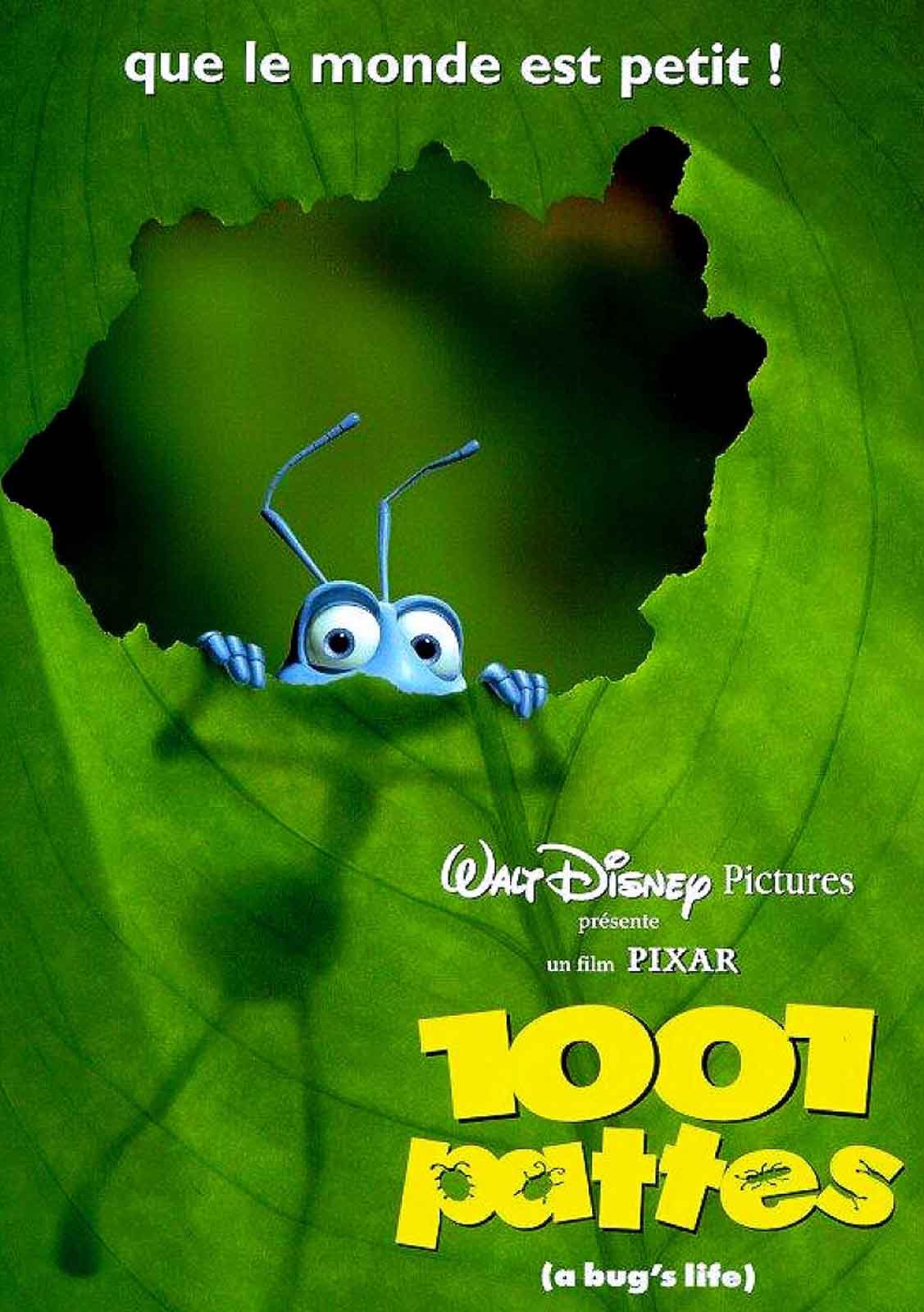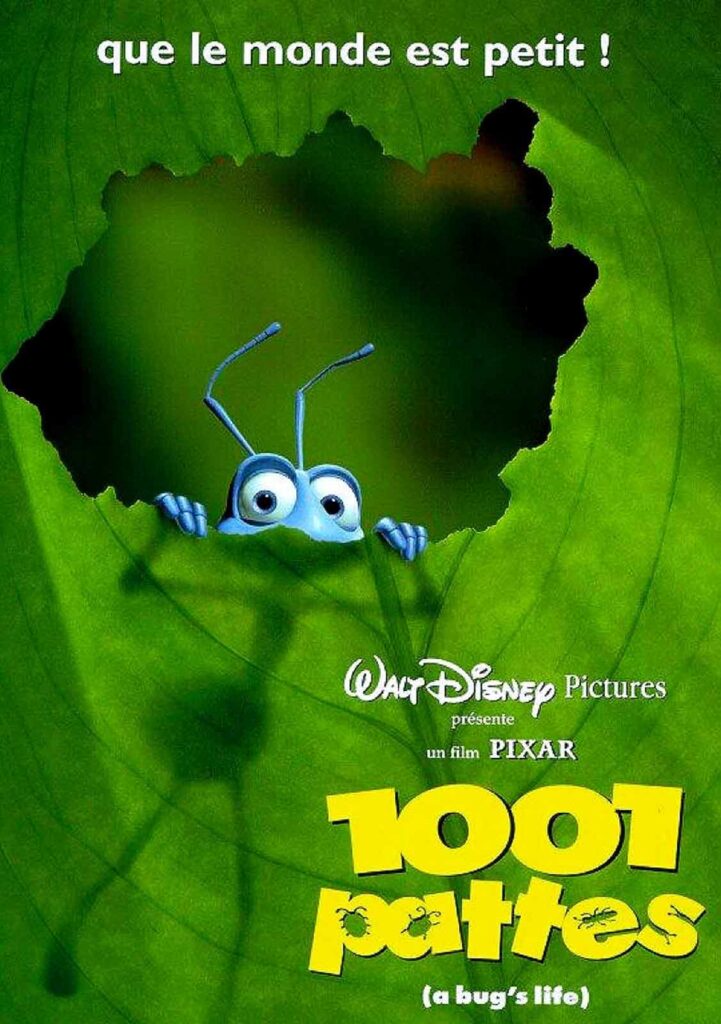Après le succès de La Grande aventure Lego, la version « petite brique » du Dark Knight a droit à son propre film…
THE LOGO BATMAN MOVIE
2017 – USA
Réalisé par Chris McKay
Avec les voix de Will Arnett, Zach Galifanakis, Michael Cena, Rosario Dawson, Ralph Fiennes, Jenny Slate, Hector Elizondo, Ellie Kemper, Mariah Carey
THEMA SUPER-HÉROS I JOUETS I SAGA BATMAN I DC COMICS
Le triomphe de La Grande aventure Lego n’était pas gagné d’avance, mais Phil Lord et Chris Miller surent trouver le ton juste pour ravir les publics de tous âges en cachant derrière leur grain de folie débridé une réflexion sur le pouvoir de l’imagination et sur la nécessité de ne pas réfréner la pulsion créative de l’enfance. Parmi la multitude de « vedettes invitées » venues faire leur numéro dans ce film choral, Batman avait marqué les esprits dans un exercice d’auto-dérision désopilant. L’idée de consacrer un long-métrage à part entière au Dark Knight dans sa version Lego est donc née dans la foulée. Réalisateur et co-producteur du programme télévisé Robot Chicken, monteur de La Grande aventure Lego, Chris McKay se voit offrir la mise en scène de Lego Batman, le film, qui sera son premier long-métrage. Féru d’humour parodique et grand amateur du trio Zucker, Abrahams et Zucker, McKay cherche à retrouver l’esprit de Y’a-t-il un pilote dans l’avion ? et de la « saga » des Y’a-t-il un flic… ? avec Leslie Nielsen. Voilà qui s’annonce prometteur. Un casting vocal prestigieux le rejoint dans cette aventure : Zach Galifanakis, Michael Cena, Rosario Dawson, Ralph Fiennes ou encore Mariah Carey. Quant à Will Arnett, il reprend la voix rauque du super-héros masqué qu’il interprétait déjà dans La Grande aventure Lego.


Pour jouer la carte de la rupture, McKay décide de donner la vedette à un Batman sombre, grincheux et dépressif (dans la mouvance de ceux incarnés par Christian Bale et Ben Affleck) et de lui adjoindre un Robin coloré, fougueux et immature (inspiré de celui que jouait Burt Ward dans la série TV des années 60). Lego Batman, le film s’amuse ainsi à mélanger toutes les époques et à entrechoquer les différentes itérations du Chevalier Noir à l’écran, celles du show des sixties, de Tim Burton, Joel Schumacher, Christopher Nolan, Zack Snyder, sans oublier un certain nombre de séries animées. Cette approche « patchwork » annonce en quelque sorte les choix postmodernes délirants qu’adoptera Spider-Man New Generation. Mais si l’homme-araignée mis en scène en 2018 par Peter Ramsey, Bon Persischetti et Rodney Rothman parvient miraculeusement à conserver sa cohérence et même à nous émouvoir, l’homme-chauve-souris de Lego Batman ne quitte jamais son statut de pantin caricatural et monolithique.
Patchwork
Car à trop vouloir jouer la carte de l’humour visuel mené sur un tempo d’enfer et de l’enchaînement de gags référentiels en cascade, le film de Chris McKay finit par se noyer dans ses propres excès. La richesse se confond bientôt avec l’accumulation et le rythme avec la précipitation. Tout va trop vite, tout est trop fort, tout nous saute aux yeux sans laisser au cerveau le temps d’enregistrer ce trop-plein de données, ce qui laisse peu de place pour s’attacher aux personnages et à leurs problèmes – fussent-ils des Legos. On s’amuse donc face aux multiples guest-stars échappées de moult blockbusters populaires (principalement ceux des studios Warner), de King Kong à Gremlins en passant par Le Seigneur des anneaux, Doctor Who, Le Magicien d’Oz, Harry Potter et même Le Choc des Titans (avec une version « briques » du Kraken de Ray Harryhausen) sans pour autant s’impliquer pleinement dans cette épopée mouvementée qui confine à l’hystérie. Le miracle de La Grande aventure Lego n’aura donc pas été réitéré, d’autant que la géniale trouvaille du film de Phil Lord et Chris Miller (tout ce que nous venons de voir est le fruit de l’imagination d’un enfant) n’a plus cours dans Lego Batman, qui n’offre donc qu’un seul niveau de lecture. Le succès sera certes au rendez-vous, mais la suite envisagée sera annulée après le rachat de la franchise Lego par Universal Pictures.
© Gilles Penso
Partagez cet article